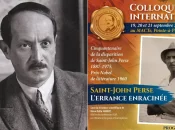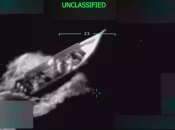Depuis 2018, de grands chantiers de politique publique ont été lancés dans les territoires des Outre-mer pour une restructuration et une homogénéisation des moyens humains, financiers et structurels des territoires ultramarins. Six ans plus tard, où en sommes-nous ? C’est ce que nous vous proposons de découvrir à travers différentes grandes thématiques. Alors que la 60ème édition du Salon International de l’Agriculture a clôturé ses portes le 3 mars dernier, l’heure est au bilan. Les agriculteurs ultramarins, de retour dans leurs territoires respectifs se retrouvent confrontés à la réalité de leur quotidien : éloignement, normes européennes souvent difficiles à faire appliquer sur place, intempéries… À Paris, ils ont eu l’occasion de faire remonter leurs doléances. Ont-ils été entendus ? Où en sont les politiques publiques mises en place pour les accompagner ?
« Les dispositifs mis en place actuellement doivent être adaptés à nos territoires. Nous avons besoin qu’il y ait un réflexe Outre-mer » ; « Le problème que nous rencontrons concerne la lourdeur de l’administration » ; « La montée des prix nous impacte » ; « Nous sommes sur des territoires où la pluviométrie est très difficile et nous avons besoin de véhicules costauds, or lorsqu’un jeune agriculteur doit investir sur un véhicule et qu’avec le malus celui atteint près de 100 000 euros, il nous est impossible d’avoir un outil de travail. Nous demandons l’exonération de malus sur les véhicules agricoles et de garder le statut de véhicule utilitaire pour le pick-up »... C’est à l’occasion du déplacement du Premier ministre, le 27 février dernier, au stand de l’ODEADOM, lors du Salon International de l’Agriculture, que de nombreux acteurs du monde agricole des Outre-mer ont directement pu interpeller Gabriel Attal afin d’évoquer leurs difficultés. En toile de fond de ces échanges, les questions de souveraineté alimentaire et de changements climatiques, qui ont fait l’objet de nombreuses tables rondes et débats. L’objectif, fixé par le président de la République, d’atteindre la souveraineté alimentaire dans les Outre-mer à l'horizon 2030 a également été rappelé, alors que celui-ci a donné les grandes orientations, lors de son discours du 28 février dernier: protéger les exploitations face aux dérèglements climatiques, renouveler les générations agricoles et l’attractivité des métiers et renforcer la production.
Ne pas confondre souveraineté et autonomie alimentaire
Cela fait quelques années maintenant que la reconquête de la souveraineté alimentaire a été mise en avant, comme enjeu national. En 2024, toujours avec cet objectif de souveraineté à atteindre en 2030 dans les Outre-mer, voici ce que les services de l’État dressent comme bilan. « Le gouvernement a nommé un délégué interministériel à la transformation agricole des outre-mer (DITAOM) à la suite du discours du président de la République de 2019. Les préfets ont réuni des comités locaux de transformation agricole en 2020 et 2021 avec une synthèse en juin 2021. Le COPIL national a été réuni le 5 novembre 2020 avec les deux ministres agriculture et outre-mer. Les plans de souveraineté alimentaire ont été signés en 2023 (En Martinique, la collectivité qui a signé sa stratégie agricole n’a pas signé le document établi en préfecture.). Une task force a été constituée en septembre 2022 avec la DITAOM, la DGOM, la DGPE, l'ODEADOM et le CGAAER pour identifier les projets structurants concourant à l'attente des objectifs et les appuyer dans leurs demandes de financement. Le POSEI pour 2024 inclut de nouvelles aides dès lors qu'elles permettent l'augmentation de la production, financées au travers de l'augmentation des crédits nationaux complémentaires au POSEI de 45 millions d’euros par an à 60 millions, soit une augmentation de 15 millions ».

À Paris, quelques spécificités ultramarines, à l’instar du foncier limité, les conditions pédoclimatiques et climatiques de manière générale, la prédominance des petites exploitations, semblent intégrées. D'autres problématiques communes à l'Hexagone sont également soulignées : l’enjeu du renouvellement des générations, l’attractivité du métier d'agriculteur, la nécessité de développer l'agroécologie et de réduire l'utilisation de produits phytosanitaires. Néanmoins, malgré tous ces freins, l’enjeu de la souveraineté alimentaire demeure un objectif réaliste à atteindre pour les acteurs publics. « La souveraineté ne signifie pas l'autonomie alimentaire. Il ne peut y avoir de production de céréales dans les outre-mer en raison du foncier limité et des conditions pédoclimatiques. Ainsi les outre-mer resteront dépendantes des importations pour certaines productions. Cependant, l'objectif est bien de couvrir plus de besoins locaux avec la production locale, donc il faut plus de production et une meilleure compétitivité vis-à-vis des importations », peut-on entendre auprès de ces mêmes acteurs. Concernant les réglementations à adapter aux spécificités locales, des pistes sont avancées. « Il convient de trouver le bon équilibre entre le respect des normes et exigences européennes, et françaises (en matière environnementale, sociale etc) et les besoins d'adaptation. Les préfets sont les relais des demandes d'adaptation et celles-ci sont prévues dès que possible. L'alinéa 3 de l'article 73 de la Constitution permet aux collectivités de fixer elles-mêmes des réglementations dans plusieurs domaines. La rédaction des règles au plus proche des territoires est un des enjeux de la décentralisation. L'ODEADOM est en charge de réfléchir à une meilleure manière de répondre aux demandes des professionnels pour intégrer de nouvelles aides et supprimer celles devenues obsolètes ».
Plus de fonds et de réactivité pour répondre aux besoins sur le terrain
Les urgences à prendre en compte dans les territoires des Outre-mer ont été listées :
- La nécessité d’augmenter la production dans un contexte de déstabilisation des marchés. Pour cela, une augmentation des crédits nationaux complémentaires au POSEI a été actée dès le projet de loi de finances 2024. Des aides pour faire face aux surcoûts d'approvisionnement liés à la guerre en Ukraine ont également été validés avec 10 millions d’euros pour la filière animale et 10 millions d’euros pour la filière fruits & légumes.
- La transition vers l'agroécologie qui s’accompagnera d’une enveloppe outre-mer du programme Ecophyto, afin d’atteindre 1 million d’euros. L’installation d'une task force « cultures ultramarines » pour anticiper les retraits d'usages des produits phytosanitaires, ainsi que le soutien à l'adoption du règlement NGT (nouvelles techniques génomiques) de la Commission européenne et du Conseil sont également prévus.
- L’amélioration de la structuration des filières qui pourrait se faire grâce à une nouvelle aide, à hauteur de 1 million d’euros par an, dans le cadre du POSEI, afin de pouvoir rémunérer l'intégration d'une organisation de producteurs. Est également indiqué qu’il y aura le doublement des crédits territorialisés, passant ainsi de 3 à 6 millions d’euros par an, notamment pour le bénéfice de l'animation par les organisations de producteurs et le bien-être des agriculteurs.
Parmi ces nouvelles aides, il ne faut pas oublier celle spécifiquement créée pour les planteurs de bananes vulnérables, à hauteur de 11 millions d’euros, ainsi que celles qui existent déjà et qui sont consultables sur le site de l’ODEADOM.
La prochaine étape incontournable sera la notification du POSEI pour 2025 à la Commission européenne, le 31 juillet 2024 au plus tard. Tout au long de ce premier semestre, l'ODEADOM aura d'ailleurs la responsabilité de soumettre des propositions au gouvernement sur les modifications structurelles et conjoncturelles nécessaires à l'atteinte de ces objectifs.
Pour en savoir plus :
L’Odeadom fête ses 40 ans de présence au Salon international de l’Agriculture
Le fonds de garantie en faveur de l’agriculture et de la pêche (FOGAP) en Outre-mer rénové en 2024