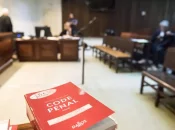Outremers 360 poursuit sa série «Les Outremers et leurs régions», et met le cap dans l'océan Atlantique avec le Suriname, territoire frontalier avec la Guyane française, le Brésil et le Guyana. Au carrefour de l’Amazonie et de l’Atlantique, le Suriname, plus petit État d’Amérique du Sud, incarne à la fois une exception culturelle et écologique et un laboratoire politique fragile. Fort de ses forêts préservées, de sa diversité humaine et d’un sous-sol riche en or et en pétrole, ce pays de 647 000 habitants se trouve à l’aube d’une nouvelle ère. Mais derrière les promesses d’un boom énergétique, il doit relever des défis majeurs : changements climatiques, pressions sociales, criminalités transnationales et gouvernance des ressources. Retour sur l’histoire et les enjeux d’une nation en quête d’équilibre.
Indépendant des Pays-Bas depuis le 25 novembre 1975, le Suriname est le plus petit État d'Amérique du Sud par sa superficie. Il se compose d'une étroite plaine littorale au nord — où se concentre l'essentiel des habitants — et d'un vaste arrière-pays de forêts tropicales sur le bouclier des Guyanes. Son point culminant est la Julianatop qui culmine à 1 286 m. Près de 90 % de la population vit sur la bande côtière, dont environ deux tiers à Paramaribo, ce qui rend le pays particulièrement vulnérable aux inondations et à la montée du niveau de la mer.

Une mosaïque démographique et linguistique
Héritière de l'histoire coloniale et des migrations sous contrats, la société surinamaise est l'une des plus diverses du continent. Hindoustans (descendants d'Indiens), Marrons (descendants d'esclaves fugitifs), Créoles, Javanais, Amérindiens, Chinois et minorités européennes y cohabitent. Le néerlandais est la langue officielle, mais le sranan tongo (créole à base anglaise) sert de lingua franca, aux côtés du sarnami (hindi caribéen), du javanais et de langues marronnes (ndjuka, saramaka…). La population compte environ 647 000 habitants (2024), avec des communautés chrétiennes, hindoues et musulmanes de taille comparable.
_located_at_Abraham_Crijnssenweg_1_paramaribo%2C_suriname.jpg)
Des forêts et des fleuves au cœur du modèle de développement.
Le Suriname figure parmi les pays les plus boisés du monde (environ 93 % de couvert forestier). Le Central Suriname Nature Reserve, site UNESCO de 1,6 million d'hectares (≈ 11 % du territoire), symbolise cette richesse écologique. Historiquement, l'économie s'appuyait sur la bauxite ; aujourd'hui, l'or et le pétrole dominent les exportations, aux côtés du riz et de la banane. L'essor attendu de l'offshore est structurant : TotalEnergies et APA ont approuvé en octobre 2024 un investissement d'environ 10,5 milliards de dollars sur le Block 58 (projet « Gran Morgu »), avec une production visée à l'horizon 2028.

Après 1975 (gouvernement Henck Arron), un coup d'État militaire mené par Dési Bouterse en 1980 installe une dictature marquée par les « meurtres de décembre » (1982). La transition démocratique reprend à la fin des années 1980. Bouterse revient par les urnes en 2010 et 2015, mais la justice surinamaise confirme en décembre 2023 sa condamnation à 20 ans de prison pour les exécutions de 1982. En juillet 2020, Chandrikapersad (Chan) Santokhi devient président. À l'issue des législatives du 25 mai 2025, le Parlement élit, le 6 juillet 2025, Jennifer Geerlings-Simons (NDP) première femme présidente du pays ; elle est investie le 16 juillet 2025 après un accord de coalition.

L'économie du Suriname repose largement sur l’exploitation de ses ressources naturelles, en particulier l’or, le pétrole, et les anciens revenus liés à la bauxite/alumine. Selon la Banque mondiale, les secteurs des ressources minérales et énergétiques constituent environ 30 % du PIB Banque mondiale. D’après Moody’s Analytics, ces mêmes secteurs génèrent environ 85 % des exportations et 27 % des revenus publics, soulignant une forte vulnérabilité aux fluctuations des prix des matières premières. Le secteur pétrolier est promis à une transformation majeure avec le projet offshore « GranMorgu » (Block 58), issu d’un partenariat entre TotalEnergies, APA Corp. et Staatsolie. Par ailleurs, des coopérations en matière de gaz, notamment avec ExxonMobil autour des frontières maritimes avec le Guyana, tendent à renforcer le rôle du Suriname comme futur hub énergétique régional.
Sur le plan des échanges internationaux, le Suriname exporte principalement vers la Suisse, les Émirats arabes unis, les États-Unis, la Belgique et Trinidad-et-Tobago. Ses importations proviennent surtout des États-Unis, des Pays-Bas, de Trinidad, de la Chine et du Japon. Les États-Unis demeurent un partenaire commercial clé, tant en matière d’investissements que de commerce bilatéral. Sur le plan régional, le Suriname renforce ses liens économiques grâce à des initiatives comme la Chambre de Commerce Suriname–Guyana, créée en février 2024, qui vise à stimuler les échanges bilatéraux et à promouvoir la coopération notamment lors d’événements internationaux (ex : Offshore Technology Conference à Houston en mai 2024). Il appartient aussi aux réseaux économiques régionaux tels que la CARICOM, l’Unasur et Mercosur (en qualité de membre associé), et participe à l’Accord de Partenariat Économique entre l’UE et les pays CARIFORUM — bien que l’accord ne soit pas encore ratifié formellement par le Suriname.
Lire aussi : Le Suriname et la Chine signent un accord de restructuration de la dette de 475 millions de dollars
Confronté à une forte inflation, à une dette insoutenable et à la dépréciation du dollar surinamais, le pays a conclu en 2021 un programme FMI (EFF), achevé avec la neuvième et dernière revue approuvée le 24 mars 2025. Les réformes (subventions, fiscalité, dette) ont amélioré les équilibres, mais au prix de tensions sociales.
Lire aussi : Suriname : Affrontements à l'issue d'une manifestation contre la vie chère à Panamaribo
Vulnérabilité côtière, orpaillage illégal, fragilités sociales, de multiples faiblesses
Avec près de 30 % du territoire à quelques mètres au-dessus du niveau de la mer et l'essentiel des activités dans la plaine littorale, le Suriname est en première ligne face aux submersions marines, érosions et pluies extrêmes. Des études et reportages récents documentent le recul du trait de côte autour de Paramaribo et des villages côtiers. Les autorités et les bailleurs comme la Banque mondiale financent des projets de gestion des risques d'inondation et d'adaptation urbains.
L'or — vital pour les recettes — alimente l'orpaillage légal et illégal (y compris transfrontalier depuis la Guyane française et le Brésil), entraînant déforestation et pollutions au mercure. Des enquêtes pointent les chaînes logistiques alimentant ces sites et les impacts sanitaires sur les bassins fluviaux habités.
Les mesures d'austérité et la flambée des prix ont déclenché de violentes manifestations en février 2023 avec le Parlement brièvement envahi). La défiance perdure, dans un contexte de pouvoir d'achat dégradé et de déséquilibres encore sensibles malgré le programme FMI.
Le Suriname se situe sur des routes de trafic (cocaïne, armes) vers l'Europe et la Caraïbe, ce qui mobilise les forces de sécurité et pèse sur la perception de risque. Par ailleurs, la vieille dispute frontalière avec le Guyana sur la zone du Tigri/New River Triangle a ressurgi fin 2024 autour de projets d'infrastructures, sans dégénérer.
Une coopération active sur le fleuve Maroni avec la Guyane
La Guyane et le Suriname partagent une frontière de plus de 500 kilomètres de long sur le fleuve Maroni et ses affluents. Avec plus de 1000 traversées transfrontalières en pirogue par jour entre Saint-Laurent du Maroni et Albina, cette frontière est une réelle zone de vie, concentrant de nombreux échanges.
Les deux territoires entretiennent une coopération transfrontalière active. Elle s’appuie sur l’accord-cadre de 2018 et sur le Conseil du fleuve Maroni, qui réunit régulièrement les deux rives autour de la gestion environnementale, du développement durable et des enjeux sociaux. La sous-préfecture de Saint-Laurent du Maroni coordonne la coopération bilatérale avec le Suriname, qui passe notamment par l’organisation du « Conseil du fleuve Maroni » et par l’accompagnement des collectivités. Elle travaille en étroite collaboration avec la Collectivité Territoriale de Guyane (CTG), les mairies, la Communauté de Communes de l’Ouest Guyanais et les chambres consulaires. Elle entretient également des relations privilégiées avec l’Ambassade de France au Suriname et au Guyana située dans la capitale surinamaise Paramaribo, qui accueille en son siège des attachés de sécurité intérieure et de défense, l’Agence française de développement (AFD) et une antenne de la CTG.
Lire aussi : Guyane : Rencontre bilatérale entre la Guyane et le Suriname, des discussions sur des enjeux stratégiques
Lire aussi : Une convention pour renforcer la coopération en matière de santé entre la France et le Suriname signée
L’Agence Française de Développement (AFD) finance plusieurs projets structurants, dont la réhabilitation de l’East-West Link reliant Albina à Saint-Laurent-du-Maroni, ainsi que des partenariats hospitaliers qui permettent aux habitants de bénéficier de soins spécialisés, comme la chimiothérapie ou la dialyse, de part et d’autre de la frontière.
Sur le plan sécuritaire, les deux territoires coopèrent pour lutter contre les trafics et les migrations irrégulières. Cette collaboration s’est renforcée avec la signature, en mai 2024, d’un plan de sécurité commun avec le Guyana. En outre, un accord de délimitation partielle de la frontière signé en 2021 a permis d’apaiser certaines tensions, même si des zones demeurent à clarifier. Ces avancées traduisent une volonté partagée de stabiliser et de développer la région.
Entre richesse naturelle exceptionnelle et vulnérabilités structurelles, le Suriname aborde une séquence décisive. L'élection de Jennifer Geerlings-Simons en juillet 2025 et la perspective de recettes pétrolières à moyen terme offrent une fenêtre pour recomposer le contrat social : consolider la stabilisation macroéconomique, canaliser la rente vers l'éducation, la santé et les infrastructures résilientes, endiguer l'orpaillage illégal et protéger les forêts — capital écologique planétaire. La réussite surinamaise se mesurera à sa capacité à transformer l'abondance naturelle en prospérité partagée, tout en sécurisant ses côtes et ses institutions démocratiques.