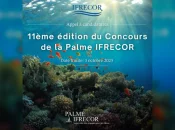Trois ans et demi après sa prise de fonction, Jérôme Le Brière, Directeur Général du Centre hospitalier universitaire de Martinique (CHUM), trace une feuille de route ambitieuse. Restaurer la confiance des patients, obtenir la certification HAS, moderniser les infrastructures, renforcer la coopération caribéenne et accroître l’attractivité notamment par la recherche : les priorités sont claires et se construisent avant tout avec les équipes, au cœur des chantiers menés au quotidien. À l’horizon 2030, il défend la vision d’un hôpital ancré dans son territoire, collaboratif, numérique, ouvert sur le territoire et reconnu à l’international. Entre deux rendez-vous parisiens pour partager sa réalité ultramarine et négocier des soutiens financiers, il a accepté de partager ses perspectives avec Outremers360.
Restaurer la confiance avec les Martiniquais
Lorsque Jérôme Le Brière prend ses fonctions en mars 2022, l’hôpital sort d’une double crise : sanitaire et sociale. Entre le traumatisme du Covid, les grèves et les difficultés d’accès aux soins, la confiance des usagers est fragilisée. « Le gros enjeu pour nous, à la sortie de la période Covid, c’était de restaurer globalement la confiance. Un Martiniquais doit sentir que la qualité des soins et l’accessibilité sont les maîtres mots de notre projet d’établissement. »
Cela se traduit par des mesures concrètes : efforts de désengorgement des urgences, réduction des délais de rendez-vous, accès pour les médecins généralistes à des avis spécialisés, communication transparente avec les représentants d’usagers et associations…. La crédibilité du projet se joue également en interne : organisation, gestion des ressources, amélioration continue des conditions de travail et de la qualité des soins. « Il s’agissait avant tout de rétablir le dialogue social. Un dialogue à la fois exigeant, quotidien et parfois complexe, mais indispensable pour améliorer les conditions d’exercice des personnels et, in fine, la qualité des soins apportés aux patients. Certes, ce travail demande du temps et de l’énergie, mais il permet de faire évoluer les organisations et de corriger nos faiblesses. C’est grâce à cette démarche, en lien notamment avec l’Agence Régionale de Santé de Martinique présente à nos côtés, que nous avons pu, progressivement, inverser la tendance, y compris sur le plan financier et budgétaire ; un point essentiel pour l’avenir de l’établissement. » souligne Jérôme Le Brière.
Cette cohérence est essentielle pour défendre un projet d’ampleur : la reconstruction du bâtiment central de La Meynard construit dans les années 80, avec plusieurs plateaux techniques dédiés à la cancérologie et à l’hospitalisation. Un investissement de plusieurs centaines de millions d’euros, qui doit redonner aux patients et au personnel un cadre convenable et moderne. « Ces locaux ne sont plus dignes de l’accueil que nous devons offrir aux Martiniquais. » souligne Jérôme Le Brière.

La certification HAS : l’aboutissement d’une dynamique collective
Un autre enjeu majeur est la qualité des soins, évaluée par la Haute Autorité de Santé. La qualité des soins est à améliorer. « En 2022, j’ai relancé le processus avec une méthode plus claire, pragmatique, et surtout en associant les équipes de terrain », explique Jérôme Le Brière. Les évaluateurs avaient pointé des failles importantes, en particulier sur la sécurisation du circuit du médicament. « Le principal reproche qui nous était fait concernait la traçabilité et la sécurisation jusqu’à l’administration du traitement », rappelle-t-il. Pour y répondre, l’établissement a investi massivement : des dizaines d’armoires sécurisées ont été déployées, et l’ensemble de la chaîne du médicament a été revu dans le cadre du déploiement d’un Dossier patient Informatisé pour renforcer la sécurité des patients.
Mais au-delà de l’aspect technique, cette certification sous conditions a aussi été le fruit d’un investissement collectif, comme le rappelle son directeur général : « Un hôpital, ça marche grâce aux soignants, médecins et personnels au sens large. Ce sont eux qui tiennent le bateau à flot, parfois dans des conditions difficiles ».
Toutefois les enjeux liés à la cancérologie, la traumatologie ou les conséquences du diabète restent entiers. La direction évoque même la « perte de chance », un concept qui illustre concrètement l’impact des dysfonctionnements. « Quand un appareil est en panne en cancérologie et que la prise en charge d’un cancer est retardée de plusieurs jours, c’est une perte de chance. Quand une personne âgée passe plus de 24 heures sur un brancard aux urgences faute de lits disponibles, c’est aussi une perte de chance. » Pour éviter ces situations, l’hôpital a mis en place des indicateurs précis et intègre désormais les usagers dans ses instances décisionnelles, afin de s’appuyer sur leur expérience vécue pour améliorer les parcours de soins. C’est ainsi qu’« en mai, les experts visiteurs ont reconnu la dynamique positive. Nous attendons les résultats de la certification en 2025. C’est un signal fort : malgré les crises, nous progressons ensemble », souligne avec optimisme Jérôme Le Brière.
Au-delà du tampon administratif qui devrait être délivré dans les prochains jours, cette certification marquerait l’aboutissement d’une dynamique collective de transformation.

Grands chantiers : garantir l’accès des Martiniquais à des soins de pointe sur leur territoire
En parallèle de la réorganisation structurelle, le CHU mène de grands chantiers qui convergent vers un même objectif : à chaque fois que possible qu’aucun Martiniquais n'ait plus besoin de se rendre dans l’Hexagone pour accéder à des soins de pointe.
Les premiers travaux reposent sur le virage numérique, engagé dès 2022, pour rattraper un retard accumulé. De nombreux outils sont alors déployés : dossier patient informatisé territorial, messagerie sécurisée, accès facilité aux avis spécialisés pour les médecins de ville par la téléexpertise, recours à l’intelligence artificielle en imagerie… Cette transformation s’accompagne de l’ouverture, en avril 2024, de l’Institut caribéen d’imagerie nucléaire, désormais doté d’équipements parmi les plus complets de France, permettant à la Martinique de rayonner sur l’ensemble de la Caraïbe. Il est également possible de citer le développement d’une offre de neuroradiologie interventionnelle permettant de renforcer le traitement local de l’AVC et éviter les déracinements vers l’hexagone pour certaines pathologies.
« Le gros enjeu pour nous, c’est que les Martiniquais ne soient contraints de traverser l’Atlantique pour être diagnostiqués et traités », rappelle Jérôme Le Brière. Cela signifie pour les Martiniquais, gagner en temps, en qualité de soins et en qualité de vie.
Par ailleurs deux chantiers structurants doivent marquer la décennie : la reconstruction de l’hôpital de Trinité, le début des travaux est prévu en 2026, et la création d’un Gérontopôle, fédérant l’ensemble des acteurs de la gériatrie autour d’un projet d’organisation des soins.
Parmi les nouveaux projets, figure également la création d’un centre médico-sportif en partenariat avec l’Institut Martiniquais du Sport. Cette collaboration, validée par le ministère, est destinée non seulement aux sportifs et licenciés mais également à l’ensemble de la population martiniquaise, permettant ainsi à chacun de bénéficier de consultations spécialisées, sur orientation médicale.
En cancérologie, l’installation d’un nouvel accélérateur viendra renforcer la résilience du système en reposant sur 3 machines compatibles.

Coopération régionale et recherche scientifique : deux leviers d’attractivité
La Martinique ne peut se penser seule. Avec ses voisins caribéens, le CHU de Martinique s’attèle à développer la coopération territoriale. « Nos populations afro-caribéennes partagent de nombreux points communs en termes d’épidémiologie et de génétique, ce qui ouvre des perspectives de recherche uniques », souligne Jérôme Le Brière. Des partenariats sont déjà actifs avec la Guadeloupe, la Guyane, mais aussi avec Cuba et la Dominique, dans des domaines tels que la pharmacologie ou la cancérologie. L’enjeu est double : améliorer la prise en charge des patients grâce à une mutualisation des compétences, et créer une dynamique régionale de recherche capable d’attirer scientifiques et médecins sur le territoire. « Ce qui nous tient à cœur, c’est de créer une véritable émulation caribéenne et de faire preuve d’audace pour expérimenter de nouvelles solutions adaptées à nos réalités locales. »
Pour attirer et retenir les talents, le CHU mise sur la recherche et l’innovation avec notamment la construction du futur Pôle universitaire de santé qui devrait être livré vers la fin du premier semestre 2026 par la Collectivité Territoriale de Martinique. « Nous devons créer un écosystème attractif pour les chercheurs, les jeunes médecins, mais aussi pour les partenaires industriels. La recherche est un facteur d’excellence et de rayonnement. » souligne Jérôme Le Brière. Le CHUM ne se contente plus de soigner, il ambitionne désormais de devenir un pôle d’innovation et de savoir.

CHUM 2030 : une construction collective et hors les murs
Interrogé sur l’avenir du CHU dans un contexte politique et budgétaire incertain, Jérôme Le Brière se projette avec pragmatisme et conviction. « Le CHU 2030, se doit d’être avant tout un CHU martiniquais, pensé pour et par les Martiniquais », affirme-t-il. Son ambition : un établissement ouvert sur le territoire, avec des consultations avancées déployées au Nord comme au Sud de l’île, en cardiologie, en ophtalmologie, en dentaire ou encore en ORL, afin d’éviter aux patients des déplacements systématiques vers Fort-de-France. « Le CHU doit assumer pleinement sa responsabilité populationnelle, et devenir un CHU hors les murs », insiste-t-il.
Mais au-delà des infrastructures, il rappelle que la réussite du projet repose avant tout sur les femmes et les hommes qui le portent. « Au quotidien, le CHU fonctionne avant tout grâce aux équipes. C’est avec elles et par elles que nous avançons. J’aimerais multiplier encore ces moments d’échanges réguliers, qu’il s’agisse de visites sur le terrain ou de journées inversées. Car, au fond, la réussite ne viendra pas de rapports de force, mais d’un travail main dans la main. Ce n’est pas les uns contre les autres, mais bien les uns avec les autres que nous construirons l’avenir du CHU. » conclut Jérôme Le Brière.
Pour aller plus loin :