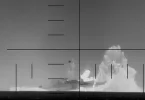Ce mardi 9 mars, Tomas Statius et Sébastien Philippe, avec Interprt et le média d’investigation Disclose, ont publié une enquête sur les essais nucléaires en Polynésie française et leurs conséquences sanitaires sur la population, civile ou militaire. L’enquête révèle notamment une sous-estimation des contaminations ou encore, un cluster de cancers aux îles Gambier, archipel proche des atolls de Moruroa et Fangataufa. Outremers360 a pu interroger Tomas Statius, co-auteur de cette enquête, qui a pour but de « rendre visible des choses qui ne l’étaient pas » et se veut être un outil pour les Polynésiens et leurs élus.
Outremers360 : Quelle a été la genèse de cette enquête ? Qu’est-ce qui vous a poussé à vous lancer dans une telle entreprise de recherches ?
Tomas Statius : Ce projet est né il y a deux ans de la rencontre entre le collectif de chercheurs et d’architectes Interprt et le média d’investigation Disclose. Notre objectif, simple et pourtant inédit à ce jour : écrire les pages manquantes de l’histoire des essais nucléaires en Polynésie française. Pour conduire cette enquête internationale, nous nous sommes associés au chercheur Sébastien Philippe. Membre du programme Science and Global Security de l’Université américaine de Princeton, sa tâche a été d’analyser scientifiquement, une à une, les données émises à l’époque par l’Armée française.
Connaissiez-vous déjà ce sujet épineux dans les relations entre la Polynésie et l’État ?
Oui. Interprt travaille sur des questions de justice environnementale dans le Pacifique. Sébastien Philippe est expert des questions de nucléaire militaire.
Plus précisément, quelles sont les archives que vous avez pu consulter ? À quelles dates et quels types d’essais correspondent-elles ?
Les documents que nous avons pu consulter sont disponible sur le site internet du projet à l’adresse https://moruroa-files.org/.
Ils couvrent majoritairement la période des essais nucléaires atmosphériques de 1966 à 1974. Pour beaucoup ce sont des rapports anciennement secrets ou confidentiel défense produit par les services en charge de la surveillance radiologique et de la contamination de l’environnement pendant les essais.
Si je ne me trompe pas, ces archives ont été déclassifiées en 2013 mais sont-elles facilement accessibles ? Existe-t-il d’autres archives qui restent classées ?
A notre connaissance, elles sont largement inconnues du public. Seulement quelques chercheurs ont pu y avoir accès. Les documents sont aujourd’hui disponibles à tous.
Parmi les grandes conclusions de votre enquête, il y a cette sous-estimation des contaminations en Polynésie française : d’après ce que vous avez pu voir, est-ce que cette sous-estimation était volontaire ?
Nous trouvons en effet qu’il y a eu dans certains cas de contamination, parmi les plus importants pour la population polynésienne, une sous-évaluation possible des doses reçues. C’est important car ces chiffres sont au cœur même du processus d’indemnisation des victimes. Il est difficile de dire si celles-ci sont volontaires ou le fruit d’erreurs. D’un point de vue scientifique, les calculs de ces doses sont, de toute façon, très incertains. Et les incertitudes associées n’ont jamais été évaluées par l’État.
Dans votre enquête, vous parlez notamment de l’essai Centaure de 1974, dont le nuage radioactif n’a pas suivi la trajectoire prévue et est allé en direction de Tahiti, île la plus peuplée de Polynésie française. Avez-vous trouvé dans vos recherches d’autres essais dont le nuage radioactif n’a pas suivi la trajectoire prévue ?
Oui effectivement. En 1966, le nuage du tout premier essai en Polynésie, Aldebaran, du 2 juillet, part dans une direction opposée. Dans les documents déclassifiés, il y a un rapport météorologique, qui date de trois heures avant l’essai, qui indique déjà que le vent se dirigeait vers les Gambier. La justification de la France a toujours été de dire que c’est suite à un changement météorologique imprévu. Or, ce que montre l’analyse des documents, c’est que de la même façon que pour l’essai Centaure, il y avait des prévisions qui indiquaient ce qu’il allait se passer et donc que la France a sciemment décidé, soit de ne pas changer le cours des événements, soit de ne pas mettre à l’abri les populations civiles.

Je vous pose cette question car en 2011 est sorti le recueil « Témoins de la Bombe » réalisé par Bruno Barrillot, Arnaud Hudelot et Marie-Hélène Villierme. Parmi la trentaine de personnes témoins, on retrouve Jacqueline Golaz, ancienne institutrice sur Rikitea, île sur laquelle devait se rendre le Général de Gaulle après avoir assisté à un essai en septembre 1966. Finalement, il est rentré sur Paris pour une urgence… Jacqueline Golaz a finalement découvert plus tard qu’un nuage radioactif se dirigeait sur l’île.
En septembre 1966, il y a eu deux essais : Beltégeuse le 11 septembre et Rigel le 24 septembre. Effectivement, concernant Rigel, il y a des retombées assez importantes sur Tureia et Rikitea. Rigel fait partie des six essais qui ont été réévalués par le rapport du CEA en 2006.
Jacqueline Golaz tenait également un journal de bord dans lequel elle notait ses observations sur la santé de ses élèves. Un journal qui lui a été « emprunté » par des militaires mais jamais rendu. Est-ce que par hasard, vous avez pu en retrouver une trace dans les nombreux documents que vous avez consultés ?
Non. Je connais cette histoire, ce journal de bord où elle notait les maladies des élèves. Pour être honnête, nous nous sommes limités quasiment qu’aux documents de l’armée française. Nous avons décidé de travailler à partir de ces données et documents officiels, comme la note du ministère de la Santé polynésien. Le but était de travailler sur la base de documents qui soient incontestables, produits par des sources officielles.
Est-ce que selon-vous votre enquête remet en cause la loi d’indemnisation des victimes des essais nucléaires de 2010 ?
Non, elle ne remet pas en cause cette loi. Ce que notre enquête montre c’est que depuis 10 ans, le comité d’indemnisation des victimes des essais nucléaires (Civen) a traité le sujet avec une légèreté déconcertante.
Il y a eu des erreurs scientifiques et méthodologiques importantes dans le procédé d’indemnisation. Par exemple, pendant 10 ans, le Civen dit dans sa méthodologie et dans ses réponses aux demandes d’indemnisation que les données de l’État français sur lesquelles il base ses décisions pour la population civile ont été validées par un groupe d’experts internationaux mandatés par l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA). Notre enquête montre que cela n’est pas vrai. Les données officielles n’ont jamais été ni revérifiées, ni validées par qui que ce soit, en tout cas pas à notre connaissance. Le Civen lui répond que ce n’est pas son travail que de vérifier les données sur lesquelles il se base.

©Disclose
En 2017, la loi Égalité réelle Outre-mer a supprimé la notion de « risque négligeable » considéré comme un frein aux indemnisations. Le Civen a depuis adopté une nouvelle méthodologie et un nouveau seuil ouvrant droit à l’indemnisation d’1 mSv. Est-ce que selon-vous, et avec les enseignements de votre enquête, ce seuil est-il pertinent ? Est-ce qu’à l’époque des essais, on prenait ces mesures sur les populations, militaires ou civiles ?
Ce seuil est inscrit dans le code de la santé publique comme seuil de protection pour les populations. Il est issu de recommandation international qui le préconise pour les cas où une exposition aux rayonnements ionisants n’est pas bénéfique à l’individu mais peut l’être pour la société. C’est le cas par exemple pour les applications médicales. Il est difficile d’extrapoler ce principe aux retombées radioactives d’essais d’armes nucléaires.
Lire aussi : Polynésie : Le niveau réel de la radioactivité lors des essais nucléaires sous-évaluée selon une enquête
Dans les documents d’archives nous avons trouvé que les seuils théoriques de protection des populations qui on le sait ont bien été dépassés pour plusieurs essais. Une carte de 1970 nous montre que le seuil acceptable pour les populations est de 0.2 rad/an soit moins de 2 mSv. Cette valeur est aujourd’hui supérieure au seuil d’indemnisation de 1 mSv/an.
Vous révélez également dans cette enquête ce fameux rapport remis au gouvernement polynésien en février 2020, sur « l’existence d’un « cluster de cancer » qui « laisse peu de doute » sur son lien avec les contaminations radioactives ». Comment expliquez-vous que ce rapport n’ait pas été rendu public ?
Ce n’est pas à nous de répondre sur la publicité de ce rapport. Nous l’avons publié parce que nous estimions que cette information était d’utilité publique.
Vous vous êtes rendus en Polynésie pour réaliser cette enquête et vous avez rencontré différents acteurs du sujet tels que les associations. Comment les échanges se sont déroulés entre ces interlocuteurs ?
Nous avons pu nous rendre en Polynésie française effectivement, tant à Papeete qu’à Mangareva dans l’archipel des Gambier. Nos échanges ont été bons avec les représentants des associations. Nous avons échangé bien sûr avec les différentes associations mobilisées sur le sujet, qui nous ont aidé sur ces démarches !
Vous évoquez également le rapport de l’INSERM, qui lui aussi a fait beaucoup de bruits, mettant en lumière le manque de données fiables sur la contamination. Mardi à l’Assemblée nationale, la ministre des Armées expliquait que ce rapport « va permettre d’évaluer la nécessité de conduire une étude épidémiologique ». Qu’en pensez-vous ? Est-ce que, avec le recul de tout le travail d’enquête que vous avez réalisé, on doit encore se poser la question de la nécessité d’une telle étude ?
Le rapport nous dit qu’une étude épidémiologique de cohorte ne pourra pas produire un résultat statistiquement significatif à cause du manque d’information sur la santé de la population polynésienne, sa taille restreinte, les niveaux d’expositions qui sont faibles mais dont les incertitudes associées sont grandes, et le fait que les essais aient eu lieu il y a si longtemps. Le secret et la lenteur administrative ont triomphé de la possibilité de mesurer l’impact des essais.
Qu’on ne puisse pas mesurer cet impact n’est ni la faute des polynésiens, ni la faute des vétérans et anciens travailleurs du CEP. Le rapport de l’Inserm dit aussi que le risque de développer certains cancers « radio-induits » augmentent bien avec l’exposition aux rayonnements ionisants. Cette exposition est aujourd’hui documentée et comme nous le montrons parfois sous-évaluée.
Est-ce que le gouvernement « central », Paris, a réagi, vous a contacté ?
Pas pour le moment. Nous leur avions soumis des questions au cours de notre enquête.
La députée Maina Sage a demandé au président de l’Assemblée nationale « une commission d’enquête parlementaire et un suivi indépendant et international des résultats ». Qu’en pensez-vous ?
Notre enquête et notre travail scientifique montrent aujourd’hui qu’au moins plus de 110 000 polynésiens, soit 90% de la population de l’époque, ont été exposés à des doses supérieures au seuil d’indemnisation de 1 mSv. Et pourrait donc y prétendre si jamais il développait un cancer sur la liste de la loi Morin.
Nous n’avons pas pu calculer les doses pour tous les essais pendant les 8 ans de la période de 1966 à 1974. Je ne vois pas comment une nouvelle étude pourrait être une mauvaise chose, mais je pense que la population polynésienne attend des réponses rapides de la part tant des pouvoirs publics que des experts.
Qu’espérez-vous aujourd’hui de votre enquête ? Au-delà d’une prise de conscience, quelle décision, quel acte fort devrait prendre l’État pour que, comme dit le député Moetai Brotherson, « le peuple polynésien puisse avoir confiance » dans sa parole ?
Comme nous le disons à la fin de notre livre, c’est désormais à la société civile de se saisir de ce travail, mais aussi aux élus, plus particulièrement en Polynésie. L’intégralité de notre travail a été fait dans le but de rendre visible des choses qui ne l’étaient pas. Je pense que toute action dans le sens d’une grande transparence des conséquences sanitaires et environnementales des essais en Polynésie serait une bonne chose. A commencer par la dé-classification de nouveaux documents : tous n’ont pas été rendus publics.