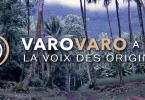Présent dans les territoires ultramarins depuis sa création, le Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement (Cirad) veut aller encore plus loin. Après l’élaboration d’une première feuille de route Outre-mer, l’organisme de recherche souhaite renforcer ses équipes à Mayotte, intensifier ses recherches dans le Pacifique et poursuit son implantation à La Réunion avec la construction d’une grande plateforme agroalimentaire à Saint-Pierre.
Jean-Marc Thevenin, ingénieur agronome, chargé de mission Outre-mer revient sur le travail des 350 chercheurs, techniciens et personnels du Cirad dans les territoires ultramarins et détaille les projets à venir.

M.D : Pouvez-vous me résumer la mission du Cirad ?
Jean-Marc Thevenin : Le Cirad, Centre de coopération internationale en recherche agronomique pour le développement est un organisme qui produit et transmet de la connaissance scientifique au service du développement agricole et de l’innovation. Nous travaillons autour de grandes thématiques comme la sécurité alimentaire, le changement climatique, la gestion de ressources naturelles ou la réduction des inégalités. Ce qui est essentiel pour nous c’est de travailler aux côtés des structures locales et nationales. Le rôle du Cirad est de produire des connaissances qui mèneront ensuite à l’action et à la prise de décision.
Le Cirad est, depuis toujours, présent dans les Outre-mer. Pourquoi cette implantation historique dans les territoires ultramarins ?
Le Cirad collabore avec une centaine de pays et nous sommes bien entendu très présents dans les Outre-mer. Cette implantation remonte à la création du Cirad, lorsque l’organisme est né il y a 40 ans de la fusion de neuf instituts de recherche structurés autour des filières tropicales qui avaient historiquement des activités dans les Outre-mer.
Les chercheurs et chercheuses travaillent sur le terrain avec les producteurs et sont au contact direct des différents acteurs des filières. Combien sont-ils et comment travaillent-ils ?
Dans les Outre-mer, le Cirad compte 350 chercheurs, techniciens et personnels d’appuis, ce qui représente 20 % de nos forces et de nos ressources propres. Nous sommes surtout présents dans les départements ultramarins mais nous souhaitons intensifier nos recherches dans le Pacifique. Pour le moment, deux chercheurs du Cirad sont basés en Nouvelle-Calédonie et un en Polynésie.
Ces territoires sont des terrains d’expérimentations et de recherche passionnants pour nos chercheurs, qui travaillent toujours en partenariat avec les acteurs locaux et les populations. Aucun chercheur du Cirad ne travaille seul dans son coin, la collaboration est au cœur de notre mission. La plupart du temps, on embarque d’autres instituts ou organismes de développement dans les projets. Mais on mène aussi des actions avec le privé ou avec des organismes de formation. Le plus important c’est qu’on co-developpe.

En février dernier, le Cirad a présenté au Salon international de l’agriculture sa première feuille de route Outre-mer pour 2024-2028. L’objectif est de multiplier les projets dans ces territoires ?
C’est en effet la première fois qu’on formalise une feuille de route Outre-mer, elle a été rédigée de manière participative avec nos ministères de tutelle, nos partenaires de terrain et les structures locales comme les chambres d’agriculture ou les organismes de recherche implantés dans ces territoires.
L’objectif de cette feuille de route est de mieux dialoguer avec les tutelles. Ce document permet aussi d’expliquer ce que l’on fait dans les Outre-mer, à la fois en interne auprès de nos différentes équipes, mais aussi en externe, pour renforcer notre visibilité.
Que contient-elle ?
Cette feuille de route a été créée pour répondre aux défis spécifiques de chaque territoire mais aussi aux défis transversaux, qui concernent plusieurs régions ultramarines. Nous avons défini trois thématiques prioritaires qui correspondent aux enjeux des Outre-mer : l’adaptation au changement climatique ; l’autonomie et la souveraineté alimentaire ; la transition agroécologique en mettant l’accent sur la santé des plantes, des animaux et des écosystèmes.
Pouvez-vous nous donner des exemples de projet dans ce sens ?
L’adaptation aux changements globaux est un enjeu crucial pour les Outre-mer. En Guyane, la station de Paracou étudie le changement du système naturel de la forêt amazonienne. Les chercheurs s’intéressent à la biodiversité et la croissance des forêts ; à la séquestration du carbone, essentiel avec le changement climatique ou encore à l’impact du changement d’utilisation des terres.
En 2023, nous avons par exemple livré des données inédites sur les stocks de carbone présents dans les sols ultramarins. En partenariat avec l’Inrae (Institut de recherche national pour l’agriculture, l’alimentation et l’environnement) et l’IRD (Institut de recherche pour le développement), l’étude « 4 pour 1000 » Outre-mer a permis de quantifier ces stocks et de montrer que les territoires ultramarins jouent un rôle important dans le stockage du carbone malgré leurs faibles superficies.
Parmi les priorités affichées, il y a le développement de la recherche sur les agents pathogènes et nuisibles. La Guyane est-elle en première ligne car sa biodiversité est un terrain propice au développement de maladies émergentes ?
Tous les territoires ultramarins, qu’ils soient des îles ou un continent comme la Guyane, ont un climat chaud et humide qui favorise l’émergence des maladies et des ravageurs. L’isolement fait qu’ils se développent ensuite très rapidement. C’est pour ça qu’il est important de mettre en place des programmes de surveillance sanitaire dans les élevages et dans les productions végétales. C’est un sujet sur lequel le Cirad travaille depuis des années mais que l’on a formalisé dans cette feuille de route pour poursuivre les recherches dans ce sens.

Comment travaillez-vous sur la souveraineté alimentaire ?
Quand on parle de souveraineté alimentaire, on parle de mobilisation de la diversité végétale. Ce qui est important c’est d’avoir des méthodes innovantes pour transformer les produits végétaux cultivés sur place et ainsi avoir une meilleure conservation ou une meilleure qualité nutritionnelle de ces aliments.
En 2021, un de nos collègues a livré une étude sur les freins et les leviers à l’autosuffisance alimentaire, il propose des recommandations pour aller vers l’autosuffisance alimentaire.
À La Réunion, nous menons en ce moment un grand projet de création d’une plateforme agroalimentaire à Saint-Pierre. Ce centre sera un site de recherche et d’expérimentation où des équipements techniques de références seront à disposition pour tester la transformation de fruits, racines et tubercules produits localement. Son ouverture est prévue en 2027.
Le troisième axe de votre feuille de route met en avant l’approche « One health », qui signifie « une seule santé ». Qu’y a-t-il derrière ce concept ?
L’approche « One health » tient compte des liens qu’il existe entre la santé humaine, la santé animale et la santé environnementale. Ces deux derniers sont déterminants de la sécurité alimentaire dans les territoires ultramarins. Pour améliorer la santé il faut nécessairement une meilleure compréhension des écosystèmes et de leurs déséquilibres. De nombreux facteurs aggravent les risques sanitaires et complexifient les questions de recherche en santé : les mobilités humaines et animales, l’intensification agricole ou l’expansion territoriale des productions, l’utilisation de produits phytosanitaires et vétérinaires, le changement climatique, les phénomènes naturels extrêmes…
Comment l’agroécologie est une réponse à cela ?
Grâce à l’agroécologie (l’ensemble des méthodes de production agricole respectueuses de l’environnement, NDLR) on élabore et on construit des systèmes de culture durables, le jardin Mahorais en est un exemple. Ce sont des systèmes agroforestiers multistrates et multiproductions. Le Cirad mène par exemple le projet « Jéjé forêt » à Mayotte, pour mieux connaître la diversité et les performances de ce jardin mahorais.
En 2012, le Cirad a créé des RITA, des réseaux d’innovation et de transfert agricole. Quels rôles vont jouer ces structures dans la mise en application de votre feuille de route Outre-mer ?
Lorsque nous avons créé ces RITA, nous avions constaté que les résultats de nos recherches n’étaient pas suffisamment pris en compte sur le terrain. Il y avait un fossé entre la recherche et la production, on observait un vrai problème de transfert des connaissances. Nous avons ainsi créé ces réseaux pour que les structures en place travaillent ensemble afin d’identifier les problèmes auxquels étaient confrontés les agriculteurs. Ainsi, les RITA regroupent des organismes de recherche, d’expérimentation, des instituts techniques, l’enseignement agricole, des organismes de développement, des organisations de producteurs, des organismes à vocation sanitaire, etc.. Depuis 2012, les 150 structures permettent de mieux répondre aux besoins locaux.

Comment le Cirad a-t-il accompagné les Mahorais après le passage du cyclone dévastateur Chido, le 14 décembre 2024 ?
On a été sollicité dès le lendemain du passage de Chido par des producteurs et par les autorités locales qui avaient besoin de conseils : « Comment tailler les arbres décapités ? Comment réintroduire rapidement du matériel végétal sans risque sanitaire pour reconstituer les plantations ? Quelles précautions prendre pour les cheptels ? » sont autant de questions auxquelles nous avons répondu. On s’est mobilisé dans l’urgence grâce à nos chercheurs sur place et on faisait du conseil à distance. On a très vite mis en place un dossier partagé pour que nos partenaires Mahorais inscrivent toutes leurs questions et en interne, tous les membres du Cirad de métropole, des Outre-mer et d’ailleurs y répondaient selon leurs compétences et leurs domaines de recherche.
Nous travaillons actuellement sur un plan pour renforcer les équipes sur place. Il y a de notre côté une volonté d’accompagner la reconstruction de l’agriculture mahoraise après le passage du cyclone Chido. À ce titre, un plan a été proposé à nos ministères de tutelle et aux acteurs locaux pour augmenter nos moyens dans ce territoire.
A lire aussi : INTERVIEW. François Houllier, président de l’Ifremer : « Les Outre-mer sont des sentinelles du changement climatique »