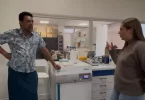Dans les territoires ultramarins, la géothermie n’est utilisée que sur la côte ouest de la Guadeloupe. Afin d’accélérer le déploiement de cette source d’énergie locale, le gouvernement a demandé une étude exhaustive et pratique de l’état actuel du potentiel en Guadeloupe, en Martinique, à La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre et Miquelon. Le rapport rendu public par le BRGM révèle des perspectives de développement non négligeables.
Confrontés à des défis particulièrement aigus vis-à-vis des changements climatiques et des besoins énergétiques, les territoires ultramarins disposent également d’atouts remarquables et spécifiques, qui leur permettent d’envisager un chemin de transition propre à chacun. Pour un grand nombre d’entre eux, la chaleur du sous-sol fait partie de ces atouts qui permettraient d’atteindre l’objectif fixé par le gouvernement d’une autonomie énergétique à horizon 2050.
A la suite de l’adoption de la Loi n°2023-175 relative à l’accélération de la production d’énergies renouvelables, le gouvernement a souhaité voir dressé l’état actuel des potentialités géothermiques dans les « Zones Non Interconnectées » de la Guadeloupe, la Martinique, La Réunion, Mayotte et Saint-Pierre-et-Miquelon.
Les zones non interconnectées (ZNI) sont les territoires français non reliés au réseau électrique métropolitain continental. Cette dénomination inclut la Corse, et de nombreux territoires insulaires ultramarins, notamment ceux concernés par la présente étude.
Ce travail mené par le BRGM, l’un des principaux acteurs du développement de la géothermie sur ces territoires, est désormais achevé. Le rapport aujourd’hui rendu public établit ainsi un bilan de l’exploration géothermique et des exploitations existantes sur ces territoires, et présente surtout les perspectives de développement et des recommandations en la matière.
Lire aussi : Le Gouvernement étend à l'Outre-mer son plan d'accélération de la géothermie
La Guadeloupe : le visage d’une expérience de géothermie électrogène déjà réussie, et encore en devenir
La Guadeloupe présente non seulement la seule production ultramarine existante d’électricité géothermique sur le site de Bouillante, mais également de fortes potentialités additionnelles en la matière, en particulier sur ce site. Sa centrale mise en service en 1986 par EDF, d’une capacité de production de 15 MWe actuellement - et très prochainement de 25 MWe - génère aujourd’hui jusqu’à 110 GWh/an à un tarif compétitif, ce qui représente déjà 5% à 6% de la consommation annuelle d’électricité de l’île.
Lire aussi : Guadeloupe : L'hôpital de Capesterre-Belle-Eau vise l'autonomie énergétique grâce à la géothermie
Et l’avenir de la géothermie y est très prometteur car plus de 50 MWe supplémentaires devraient s’ajouter dans la décennie à venir, ce qui permettrait à l’île d’atteindre près de 30% de ses besoins annuels d’électricité. En outre, d’autres zones situées autour de la Soufrière pourraient s’avérer être intéressantes dans une optique géothermique.
La Martinique, La Réunion, et Mayotte : des potentiels encore inexploités
La Martinique, Mayotte et La Réunion présentent également un potentiel sans doute important, qui mérite un effort accru de caractérisation, en particulier via des forages d’exploration pour le BRGM. Pour les deux premières, plusieurs sites d’implantation de forages profonds ont déjà été proposés ; s’agissant de La Réunion, malgré une histoire d’exploration remontant aux années 80, les zones d’intérêt avéré restent aujourd’hui à confirmer.
Il est ainsi grand temps de combler le nombre insuffisant de forages profonds réalisés pour valider les résultats des travaux d’exploration plaide le BRGM. La géothermie profonde implique une part d’incertitude : quand bien même la température du sous-sol est indubitable dans le cas d’îles volcaniques, la perméabilité des réservoirs et les débits d’eau des forages, et par là même le potentiel géothermique exploitable, sont difficilement prédictibles. Pour permettre le développement de forages, il est recommandé, en priorité, de procéder à des simplifications administratives des montages de projets et de mieux couvrir l’inévitable risque financier afférent. Il est aussi indispensable de prendre en compte, très en amont des projets de géothermie, toutes les contraintes sociétales, économiques et environnementales, et de maîtriser les risques naturels et industriels.
La géothermie, un usage multi-fonctions
Les usages possibles de la ressource géothermique sont nombreux : utilisée pour produire de l’électricité lorsque la température est très élevée – elle a alors l’avantage d’être une énergie de base – elle peut l’être de manière plus directe et notamment comme source de froid, de thermalisme, de séchage, etc., en fonction du besoin. L’ambition du gouvernement de faire des Outre-mer une avant-garde en matière de transition énergétique par le développement des énergies renouvelables remet au centre du jeu l’expertise du BRGM, en lien avec tous les partenaires et acteurs concernés conclut l'organisme.
Damien Chaillot