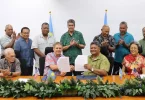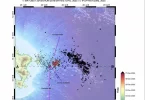Fille d’un père guyanais et d’une mère originaire de Compiègne, dans l’Oise, Alice Mathieu-Dubois est la première femme noire reçue docteur en médecine en France, en 1887. Bien à l’avance sur son temps, ce fut également la première femme à diriger des établissements de santé, principalement dans le domaine des affections nerveuses et des toxicomanies. Itinéraire d’une personnalité d’exception.
À Compiègne, où Alice Mathieu-Dubois voit le jour en avril 1861, une rue portera bientôt son nom, comme c’est déjà le cas en Crépy-en-Valois (Oise). Curieusement, en Guyane où est né son père, aucune voie ou établissement ne lui sont dédiés. Une lacune qui fait écho à celle de l’institution médicale française. Dans la biographie que lui a consacrée la psychiatre Pierrette Caire Dieu dans les Carnets d’histoire de la médecine (édités par la Société française d’histoire de la médecine), celle-ci déplore qu’Alice Mathieu-Dubois « fait partie des invisibles, ce qu’illustre le cadre réservé à sa photo, resté vide, dans le Répertoire photo-biographique du corps médical ».
« Alice est aussi restée dans l’ombre de son mari, Paul Sollier (1861-1933), bien qu’ayant dirigé avec lui deux établissements renommés » (la Villa Montsouris à Paris, et le Sanatorium de Boulogne, ndlr), ajoute l’autrice. Fidèle collaboratrice de son époux depuis leur mariage en 1886, Alice Mathieu-Dubois n’a jamais été associée aux publications de ce dernier, pourtant devenu célèbre. De la médecin, il ne reste comme trace écrite que sa thèse, n’ayant rédigé ni articles, ni de mémoires ou d’autobiographie.
Son parcours est pourtant remarquable. C’est sans doute grâce à son père dentiste qu’elle s’oriente vers la médecine, se destinant à reprendre son cabinet. Sa thèse de doctorat s’intitulera d’ailleurs L’état de la dentition chez les enfants idiots et arriérés : contribution à l’étude des dégénérescences dans l’espèce humaine. Alice Mathieu-Dubois est d’autant plus méritante que dans les années 1880, il existe beaucoup de résistance de la part des médecins et des hôpitaux à voir des femmes intégrer cette profession. Sans compter qu’elle est métisse. « Pour Alice, femme à la peau foncée – ce qui lui vaut d’être appelée Bamboula par ses camarades – l’épreuve est sans doute assez rude », écrit Pierrette Caire Dieu.

Qu’à cela ne tienne. Après ses études de médecine commencées en 1881, Alice Mathieu-Dubois soutient sa thèse en 1887, et obtient la mention Très honorable, devenant la quatrième femme à obtenir cette distinction. Pour la presse de l’époque, l’événement a un parfum particulier. « La femme-médecin n’est déjà plus un objet de curiosité. Ce qui est plus rare c’est la doctoresse nègre. Une de ces dernières, Mme Sollier, vient de passer avec succès sa thèse pour la médecine » (La Justice, 31 octobre 1887). « En dépit de sa couleur, elle est française de naissance. Son père, M. Dubois, dentiste à Compiègne, est un nègre originaire de nos possessions de la Guyane ; sa mère, une blanche, est française aussi » (Le Radical, 3 novembre 1887).
Après la naissance de leurs deux enfants, Alice (dorénavant épouse Sollier) et son mari Paul vont se consacrer à la psychiatrie, avant de se spécialiser dans le traitement des maladies nerveuses et des toxicomanies, respectivement à la Villa Montsouris de 1889 à 1897, et au Sanatorium de Boulogne sur-Seine, de 1897 à 1921. Ces deux établissements bénéficient d’une excellente réputation. Celui de Boulogne représente même « un modèle de la psychothérapie naissante », selon Pierrette Caire Dieu. Dans son édition du 6 août 1900, le journal La Fronde félicite « la doctoresse Sollier qui est en France la seule femme à la tête – ayant son diplôme – d’un établissement médical ». Car de fait, c’est Alice qui est aux commandes du sanatorium, son mari étant très occupé par ses publications et divers congrès.
Paul Sollier décède en 1933. Alice continue d’exercer et de diriger la clinique neurologique de Saint-Cloud, où le sanatorium de Boulogne a été transféré en juin 1921, jusqu’en 1934. Cette année-là et la suivante, elle travaille au sanatorium de Rueil-Malmaison. Par la suite sa santé se met à décliner. Elle finit ses jours chez sa fille et son gendre rue d’Alésia à Paris, où elle décède en janvier 1942, à l’âge de 80 ans. Elle est inhumée à Compiègne, sa ville de naissance, dans le caveau familial.
« En occupant dès 1889 des fonctions de direction dans des établissements de santé et assumant ce rôle tout au long de sa carrière, Alice Sollier est une véritable pionnière : elle est de très loin la première femme médecin ayant eu des responsabilités institutionnelles dans un établissement spécialisé dans les affections nerveuses et mentales. Rappelons que ce n’est qu’en 1920 que Constance Pascal (1877-1937) devint la première médecin chef d’asile public d’aliénés, et en 1930, que Thérèse Fontaine (1895-1987) fut la première femme à être nommée médecin des hôpitaux de Paris », conclut la psychiatre Pierrette Caire Dieu dans sa biographie d’Alice Mathieu-Dubois.
PM