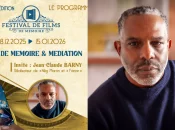Si les autorités ont pu préparer « efficacement » l’arrivée d’un tsunami aux Marquises dans la nuit de mardi à mercredi, c’est qu’elles disposaient, près de huit heures avant « l’impact » de prévisions d’horaire et de taille de vague pour chaque île et baie de l’archipel. Un travail assuré par le Laboratoire de géophysique (LDG) de Tahiti, qui, en tant que centre polynésien de prévention des tsunamis, récolte et analyse les données régionales, modélise l’arrivée des ondes sur les fonds marins de Polynésie, et fournit les bases scientifiques aux décisions de la cellule de crise. Les précisions de son directeur Stéphane Quéma, avec notre partenaire Radio 1 Tahiti.
Quelques minutes après la secousse enregistrée au Kamtchatka, dans l’extrême-est de la Russie, les premières alertes étaient déjà transmises au Haut-Commissariat. Plusieurs instituts spécialisés dans le monde, notamment aux États-Unis, ont détecté la secousse -une des plus puissantes enregistrées ces dernières décennies- et diffusé des alertes automatiques et des informations.
Mais les premières analyses utilisées par les autorités sont bien locales, et proviennent du Laboratoire de géophysique de Tahiti (LDG) et son Centre polynésien de prévention des tsunamis. Une des plus anciennes structures spécialisées dans les raz-de-marée en France, mise en place depuis plus de 60 ans et aujourd’hui rattachée administrativement, comme le reste de la surveillance sismique française, au Commissariat à l’énergie atomique.
« Une succession rapide de marées »
Ce sont donc les données de ce laboratoire, connecté au vaste réseau de sismographes, marégraphes et bouées scientifiques de haute mer de la région, qui ont permis aux autorités de l’État de diffuser les premières mises en garde. Et les représentants du laboratoire sont logiquement intégrés à la cellule de crise lancée dans l’après-midi au Haut-commissariat.
Orsec, plans de sauvegarde communaux, interdictions de navigation, sirènes d’alerte ou évacuation… C’est sur la base des informations du « LGP » qu’ont été prises, au fur et à mesure de l’approche de cette onde voyageant à plus de 800 kilomètres par heure, les décisions sur la gestion de l’évènement. Et qu’ont été communiquées, tout au long de la soirée, les horaires et tailles prévisionnels du tsunami qui menaçait les Marquises.
Un phénomène complexe à modéliser comme le rappelle le directeur du centre, Stéphane Quéma. Très loin d’une simple vague, il s’agit « d’une succession très rapide de marées, avec une élévation du niveau de la mer et un fort retrait quand ça se retire ». Une « oscillation » qui dure : « À partir de nos modélisations, on sait que le phénomène va continuer à perdurer dans le temps et atteindre des hauteurs qui nécessitent encore de continuer la vigilance. »
Quatre mètres par « mesure de précaution »
Tout au long de la soirée, les modélisations sont « remoulinées », réactualisées à l’aune des dernières données disponibles. C’est ainsi qu’aux environs de 23 heures mardi, et alors que les tailles annoncées étaient jusque-là comprises entre 1 mètre et 2m20 sur les îles les plus touchées, les communiqués officiels alertent sur un phénomène pouvant atteindre les 4 mètres de hauteur à Nuku Hiva.
« On reçoit des informations au fur et à mesure des différents capteurs, au fur et à mesure que le séisme propage ses ondes. Du coup, ça nous donne régulièrement différents paramètres par rapport à la faille sismique qui a bougé. Quand, à un moment dans la nuit, on a rejoué nos modélisations, on a vu que sur la baie de Taipivai on avait un phénomène de plus forte ampleur que ce qu’on avait estimé au départ », indique Stéphane Quéma. « Par mesure de précaution, on a préféré prévenir ».
Les premiers relevés de marégraphes ont estimé la hausse du niveau d’eau à 1m50 à Taiohae, en cohérence avec les premières fourchettes de prévision du laboratoire. Les données de la baie de Taipivai ne sont pas encore connues.
Un phénomène amplifié aux Marquises
Certains pourraient s’étonner que ces baies, orientées à l’Est et au Sud de Nuku Hiva, fassent partie des plus à risque face à une onde qui arrive du Nord-Ouest, la direction de la péninsule du Kamtchatka. Mais contrairement aux croyances, ce ne sont pas seulement les côtes directement exposées qui peuvent être touchées : « Vis-à-vis de la taille de nos îles, il n’y a pas de directivité particulière, le tsunami touche toutes les côtes », reprend le directeur du laboratoire. « Ce qui va le plus impacter, ça va être le relief sous-marin. C’est le phénomène qu’on a pu observer aux Marquises, qui disposent d’un plancher océanique assez important, ce qui amplifie l’effet du tsunami sur cet archipel ».
Un plancher océanique qui est aussi la cause des différences d’exposition entre les archipels. « On pourrait penser que les Tuamotu seraient plus concernés, mais l’impact du tsunami, on l’a encore observé aujourd’hui, est très faible sur ces atolls », explique Stéphane Quéma, à qui cette nuit d’alerte et d’onde va donner du travail. Les données de marégraphes et sismographes vont être analysées dans le détail et servir, entre autres, à améliorer les modèles de prédiction du laboratoire pour de futurs évènements.
Radio 1 Tahiti