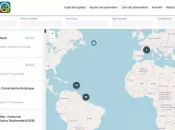Le Vanuatu, une nation insulaire du Pacifique, a été le plus en pointe dans les efforts déployés en vue de faire établir par la Cour internationale de justice (CIJ), dans un avis qu'elle rendra mercredi, un cadre juridique mondial pour la lutte contre le changement climatique.
A la veille de l'annonce de cette décision de première importance de la CIJ, l'AFP s'est entretenue avec le ministre du Changement climatique de cet archipel, Ralph Regenvanu, 54 ans, qui a ouvert en décembre les audiences de la plus haute juridiction de l'ONU, dont le siège se trouve à La Haye.
Que signifie cette affaire pour le Vanuatu et pour le monde?
Les dirigeants du Vanuatu "ont clairement montré que le changement climatique constituait la plus grande menace pour l'avenir des peuples du Pacifique". "Nous parlons du changement climatique, de ce qui va priver nos enfants de leur avenir". "Pour de nombreux pays du Pacifique, c'est une question existentielle, car ils disparaîtront, (à commencer par) les pays ayant une faible altitude comme Tuvalu et Kiribati".
"Si nous ne parvenons pas à réduire les dommages que nous constatons ou à tenter de ralentir cela, nous risquons très bientôt d'avoir à faire face aux pires conséquences".
Qu'espérez-vous de cet arrêt?
"Nous espérons que la CIJ dira que lutter contre le changement climatique est une obligation légale pour les Etats. Il faut respecter les autres Etats et leur droit à l'autodétermination".
"Le colonialisme a disparu - vous savez, il est censé avoir disparu - mais là on parle d'une relique (de ce colonialisme), quand votre comportement en tant qu'Etat continue de compromettre l'avenir du peuple d'un autre pays".
"Et vous n'avez aucun droit légal de le faire en vertu du droit international. De plus, si vos actions ont déjà causé ce préjudice, il faut qu'il y ait réparation".
Quel est l'impact du changement climatique sur votre pays?
"Au Vanuatu, nous constatons que de vastes étendues de terres autrefois habitables sont devenues inaccessibles aux populations qui y vivaient depuis longtemps".
"On observe également des cyclones tropicaux plus fréquents et plus intenses, qui constituent l'événement météorologique naturel le plus destructeur que nous connaissions au Vanuatu".
"La saison des cyclones s'allonge, nous assistons à davantage précipitations extrêmes, qui provoquent des inondations, des glissements de terrain, etc".
"Et l'impact sur l'économie est également important pour le gouvernement. Nous constatons d'importants dégâts auxquels l'Etat doit répondre".
"Une grande partie de notre PIB est consacrée à la reconstruction, au rétablissement et à la préparation (aux catastrophes naturelles). Nous avons besoin d'aide pour construire des infrastructures publiques robustes, afin d'éviter de continuer à dépenser de l'argent pour la reconstruction".
Que ressentez-vous à la veille de la décision?
"Je suis optimiste. Je pense que nous allons obtenir un avis favorable, fondé sur les précédents avis rendus par le Tribunal international du droit de la mer et sur celui de la Cour interaméricaine des droits de l'homme".
"Nous croisons donc les doigts mais nous avons bon espoir que ce sera un résultat positif".
"Et je pense que cela changera également la donne dans le débat climatique que nous connaissons".
"Nous traversons cette situation depuis 30 ans, vous savez, donc cela va changer. Cela va modifier le discours et c'est ce dont nous avons besoin".
Quelles seront selon vous les conséquences de cette décision?
"Je pense que l'avis consultatif sera très puissant chez les Etats et pourra être utilisé par les personnes qui intentent des poursuites contre leur gouvernement".
"Tous les tribunaux pourront s'en servir. Qu'il s'agisse d'un tribunal au niveau de la municipalité ou d'un tribunal au niveau de l'Etat, ils pourront recourir à cette nouvelle décision pour forcer les gouvernements à rendre des comptes et à agir davantage".
"Mais je pense aussi que, dans des pays comme le Vanuatu, (...) nous pourrons nous appuyer sur cela pour défendre nos arguments".
"Une clarté juridique sera fournie sur de nombreux points sur lesquels nous débattons depuis si longtemps".
Cinq questions clés à suivre dans l'avis de la CIJ sur le climat La Cour internationale de justice (CIJ), plus haute juridiction de l'ONU, s'apprête à rendre mercredi son tout premier avis consultatif sur le changement climatique, considéré par beaucoup comme un moment important du droit international. L'avis, attendu à 15H00 à Paris (13H00 GMT), devrait se dérouler sur plusieurs centaines de pages clarifiant les obligations des nations en matière de prévention du changement climatique ainsi que les conséquences pour les pollueurs qui ne s'y sont pas conformés. Voici cinq points majeurs à trancher dans l'avis. |
Avec AFP