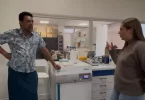Dans les communautés autochtones d’Outre-mer, les femmes jouent un rôle central dans la transmission de la culture et des connaissances. Ces mères, grands-mères, filles ou sœurs mettent à profit leurs savoirs traditionnels pour faire face au changement climatique. À travers le projet « De la mère à la terre en Outre-Mer », la documentariste et fondatrice de l’association En terre indigène, Anne Pastor, veut mettre en lumière ces femmes et leurs pratiques.
Dans le cadre de la journée mondiale des populations autochtones, le 9 août, Anne Pastor documentariste et journaliste revient sur les projets de l’association En terre indigène, créée en 2017 pour valoriser les peuples autochtones.
Vous avez créé l’association En terre indigène pour porter la voix des peuples autochtones. Manquent-ils de visibilité ?
Oui et non, ils ont beaucoup gagné en visibilité ces dernières années. Nous parlons de 570 millions de personnes réparties dans 90 pays. Je suis documentariste sur France Inter, à l’origine de la série « Voyages en Terre indigènes », j’ai produit une soixantaine de documentaires depuis 2011. J’ai observé une évolution dans la visibilité des peuples autochtones. En 2011, c’était une niche, seuls les spécialistes s’y intéressaient. Aujourd’hui, pour plusieurs raisons et notamment grâce aux réseaux sociaux, les peuples autochtones font entendre plus que jamais leur voix.

Dans notre travail, vous vous attachez à mettre en avant les femmes autochtones, pourquoi ?
En 2018, avec le soutien de la Fondation Chanel, nous avons lancé un projet pour mettre en avant ces femmes sur les questions liées à l’éducation et aux droits. Des femmes dont l’engagement et les actions sont des laboratoires d’idées pour demain, que ce soit sur la question des droits, de la justice, de l’écologie, de l’éducation ou de la culture.
J’ai créé la plateforme documentaire « La voix des femmes autochtones » et publié le livre éponyme aux éditions Akinomé. J’ai collaboré avec des photographes de ces populations dans les différents pays et territoires pour produire des portraits sonores. Nous avons, à cette occasion, rencontrer plusieurs femmes d’Outre-mer.
Vous préparez un nouveau projet sur l’écologie et les femmes de Polynésie, de Guyane, de La Réunion et de Mayotte. Quel est-il ?
Ce projet, intitulé « De la mère à la terre en Outre-mer », a débuté en avril et se déroulera sur trois ans de travail. Dans les Outre-mer, les femmes des communautés locales sont les gardiennes des savoirs écologiques et elles utilisent leurs connaissances traditionnelles pour faire face aux changements climatiques, à l’échelle locale ou communautaire. Ces savoirs peuvent aller de la culture en abattis (version traditionnelle de l’agriculture sur brûlis, ndlr) en Guyane au tressage des feuilles de Pandanus comme alternative au plastique en Polynésie ou en Nouvelle-Calédonie. Ces techniques peuvent aussi concerner la médecine traditionnelle à base de plantes. Je pense aussi aux femmes kanak qui élèvent des petites larves pour soigner les mangroves. Nous allons mettre en lumière 14 savoirs, pour certains en voie de disparition, qui sont rattachés à une culture spécifique.

Est-il essentiel selon vous de documenter ces pratiques pour qu’elles soient transmises au fil des générations ?
Ce qui m’intéresse, c’est de mettre en avant ces savoirs universels pour construire un monde plus durable. Ce que propose une femme kanak peut être utilisé par une femme européenne ou asiatique. Elles sont 238 millions de femmes autochtones dans le monde, elles se répartissent dans 90 pays qui représentent 80 % de la biodiversité mondiale. Les mettre en lumière permet de montrer l’importance de leur présence dans les rencontres internationales ou dans les rendez-vous pour le climat.
Pourquoi votre travail est-il centré autour des femmes ?
Je m’intéresse aux peuples autochtones en général, aux femmes comme aux hommes. Mais dans ces pays, les femmes sont souvent en charge des ressources, de la transmission de la culture et de la langue. Elles se retrouvent en première ligne face aux conséquences du changement climatique et elles doivent trouver des alternatives.
Ce projet autour des savoirs écologiques détenus par les femmes sera aussi ouvert à celles qui résident dans les territoires d’Outre-mer et qui ne sont pas autochtones au sens strict du terme. À La Réunion ou à Mayotte, par exemple, on ne peut pas parler d’autochtonie mais nous allons malgré tout rencontrer des femmes originaires de ces territoires.
Les outils numériques permettent-ils d’ouvrir les auditeurs sur le monde et notamment sur des peuples parfois peu considérés ?
Les outils numériques sont un des éléments mais il y a aussi un important volet pédagogique, avec des interventions, des conférences, des ateliers de parole.
Nous travaillons étroitement avec les associations locales. Ce qui nous intéresse c’est de toucher les femmes et que nos films, lorsqu’on les visionne ensemble, entraînent un débat et une discussion. Notre plateforme a pour vocation de sensibiliser les gens, certes, mais aujourd’hui notre objectif reste de construire et de réfléchir avec les populations autochtones.

Quelle est la place des femmes au sein de ces communautés ?
La place des femmes dépend de la culture de chaque pays. On ne peut pas généraliser l’autochtonie mais il est important de dire que lorsqu’on est une femme et autochtone, c’est la double peine, selon Hindou Oumarou Ibrahim, militante peul du Tchad. Elles doivent se battre pour gagner leur place et pour être reconnues. Une nouvelle génération de femmes autochtones, instruites, intelligentes et plus visibles, porte cette voix.
Vous avez aussi porté un projet avec le Conseil des femmes de Polynésie et le ministère des Outre-Mer. Quel est-il ?
La Polynésie est un des territoires qui dénombre, en termes de ratio, le plus de violences faites aux femmes et de féminicides. Le taux de violence intrafamiliale y est deux fois plus élevé qu’en métropole. Ce projet, mené avec le Conseil des femmes en Polynésie, visait à créer une boîte à outils pour mieux accompagner les femmes violentées dans leur parcours de reconstruction. Nous avions porté un projet similaire au Rwanda, en développant ce kit pédagogique à destination des victimes de violences sexuelles extrêmes. Le travail que nous avons réalisé en Polynésie (enregistrement des témoignages et réalisation de fiches sur les droits des femmes, ndlr) servira aux associations sur place qui lutte contre ces violences.
Propos recueillis par Marion Durand.