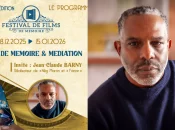Préfacé par Jean-Marc Ayrault, président de la Fondation Jean-Jaurès, avec un avant-propos de l’écrivain martiniquais Patrick Chamoiseau, un rapport intitulé « Du local à l’international. Les Outre-mer face aux défis économiques, sociaux et environnementaux », vient d’être publié par l’Observatoire des Outre-mer de la Fondation. Cette première étude de cet observatoire aborde sans tabous les nombreux enjeux auxquels les territoires ultramarins sont confrontés : inégalités structurelles, crise écologique et définition des politiques publiques, entre autres, et tente d’esquisser des solutions. Ce rapport collectif, rédigé par une dizaine de chercheurs, a été dirigé par Jeanne Belanyi, directrice de l’Observatoire des Outre-mer de la Fondation Jean-Jaurès, et Carine David, professeure de droit public à l’université d’Aix-Marseille.
Dans sa préface, le président de la Fondation Jean-Marc Ayrault rappelle ce que les ressortissants des Outre-mer ont apporté à la République. Pour autant, « les territoires ultramarins nous interpellent sur le risque, concret, d’une invisibilisation des inégalités encore à l’œuvre », prévient-il. « L’impératif d’égalité effective entre tous les citoyens apparaît Outre-mer comme une promesse toujours différée et remisée depuis la mise en place de la départementalisation, ce qui épuise peu à peu un récit républicain déjà mis à mal par les traumatismes du passé », ajoute l’ancien premier ministre. Le romancier Patrick Chamoiseau, quant à lui, insiste sur les problèmes socio-économiques, écologiques et existentiels de ces territoires, évoquant une « fragilité organique », « un désastre consenti sous un beau paysage », et souligne l’urgence d’une renaissance.
La vie chère en Outre-mer est notamment au cœur des précarités. Le rapport revient sur une étude de l’Institut national de la statistique et des études économiques (Insee) de 2022 qui calculait que, « comparés avec la France hexagonale, les prix de l’alimentation étaient plus élevés de 30% à Mayotte, de 28% à La Réunion, de 40% en Martinique ou encore de 42% en Guadeloupe malgré le « bouclier qualité prix », un dispositif de régulation des prix des produits de première nécessité ». La pauvreté associée à ces précarités renforce les inégalités dans les territoires ultramarins et entre ceux-ci et l’Hexagone. La cherté de la vie accentue ce phénomène, augmentant les demandes d’aides sociales. Identifier les causes de ces disparités est donc crucial pour les enrayer et garantir une vie digne et équitable aux habitants des Outre-mer.
Le défi de l’environnement
Autre problématique d’importance, l’environnement. Le rapport mentionne notamment « une prédisposition des territoires ultramarins à l’injustice environnementale, non compensée par des politiques publiques volontaristes », une vulnérabilité exacerbée aux conséquences du changement climatique, ainsi qu’une dépendance aux produits phytosanitaires ayant des conséquences graves sur la santé et l’environnement. Les auteurs dénoncent par exemple l’utilisation prolongée du chlordécone par dérogation aux Antilles, alors qu’il était interdit en France hexagonale : « un ‘scandale sanitaire ‘, sous la forme ‘d’une atteinte environnementale dont les conséquences humaines, économiques et sociales affectent et affecteront pour de longues années la vie quotidienne des habitants’ de Martinique et de Guadeloupe ».
Malgré ses impacts catastrophiques sur l'environnement et la santé humaine, le scandale du chlordécone semble ignoré par les autorités publiques. Face à la forte endémicité des produits phytosanitaires et à la richesse de la biodiversité dans les Outre-mer, les autorités locales ultramarines pourraient adopter une vigilance accrue concernant l'utilisation excessive de ces substances, recommande la Fondation Jean Jaurès. Néanmoins, déplore-t-elle, « les choix qui y sont faits semblent des fractales de ceux pris sur les plans national, régional et mondial ».
Les Outre-mer dans l’Indopacifique et leurs bassins océaniques
Autre thématique, la place des Outre-mer dans la politique indopacifique de la France, analysée par le Martiniquais Fred Constant, professeur des universités en science politique et ancien ambassadeur. L’ex-diplomate constate un changement de paradigme, où la France s’affirme dorénavant, mais pas assez, comme une nation « archipélagique » et mondiale : « ce sont les territoires d’Outre-mer qui fondent aujourd’hui la légitimité de la France dans les différents bassins océaniques où elle déploie sa politique extérieure, singulièrement dans la zone indopacifique ». Cela ne va pas sans quelques écueils : crise en Nouvelle-Calédonie, passif nucléaire non soldé en Polynésie, et colère contre l’État pour sa non réactivité après le passage du cyclone Chido à Mayotte, entre autres.
Pour l’ex-diplomate, il s’agit de refonder la relation transocéanique de la République avec les Outre-mer pour libérer leur potentiel stratégique. Dans cette optique, il est essentiel d'intensifier le dialogue avec leurs élus afin de définir des orientations transpartisanes capables de répondre aux attentes des populations locales. « Chaque Outre-mer appelle des solutions spécifiques, déclinées en idées, en projets et en budgets », plaide l’auteur. Par ailleurs, la dimension internationale mérite d'être davantage approfondie et développée. Après plus de vingt-cinq ans de coopération régionale, des pistes d'amélioration subsistent pour renforcer l'intégration de chaque territoire dans son bassin océanique, tout en reconfigurant leur relation avec l'État. Cela permettrait à ce dernier de valoriser ces territoires, tant pour eux-mêmes que pour la France dans son ensemble.
Territorialisation et état des lieux « dépassionné »
« Rapporté à l’espace indopacifique, l’enjeu est donc bien de convertir chacune de ces collectivités en extrêmes stratégiques, c’est-à-dire potentiellement en autant d’éléments précieux d’une stratégie globale, à préserver et à traiter en conséquence », poursuit Fred Constant. Ainsi, la France bénéficierait d'une diplomatie à la fois multimodale et « multiscalaire », davantage concertée et mieux coordonnée avec ses collectivités d'Outre-mer, dans le double objectif de servir leurs intérêts et de renforcer sa politique d'influence. Certaines initiatives ont déjà été lancées en ce sens et pourraient être généralisées, préconise l’auteur. Une telle approche permettrait à la politique extérieure nationale de s'enraciner davantage dans les territoires, tout en offrant aux élus locaux une meilleure compréhension des contraintes de l'État.
En conclusion, le rapport relève les « extraordinaires » diversités des Outre-mer et recommande une territorialisation et un état des lieux « dépassionné » des réalités locales, que ce soit par exemple pour le régime de l’octroi de mer, la justice environnementale, l’accès à l’eau potable ou la gestion des déchets. Les auteurs s’accordent sur « la nécessité d’octroyer aux collectivités locales la compétence pour établir et mettre en œuvre des politiques publiques adaptées aux réalités locales, à l’image de la lutte contre les échouages de sargasses, ce qui implique une action coordonnée des différentes collectivités », et de répondre aux aspirations des territoires ultramarins pour une plus grande intégration dans leur environnement régional et international.
PM