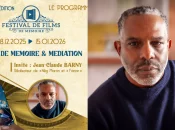Les basses saturées couvrent les éclats de voix. Sous un abri de palmes tressées, une table de fortune aligne noix de coco, gobelets en plastique et drapeaux Kanak. À Saint-Louis, bastion indépendantiste à l'est de Nouméa, on a bravé l'interdiction de rassemblement pour commémorer l'anniversaire des émeutes du 13 mai 2024.
Dans l'air flotte l'odeur âcre des feux de brousse. Le long de l'asphalte encore mouillé par l’averse, des femmes discutent pieds nus. Au-dessus d'elles, le drapeau kanak claque dans le vent, dans le silence des montagnes et les klaxons de soutien.
À quelques pas, les notes de Makukuti Kanaky, l'hymne officieux des indépendantistes, résonnent à nouveau. Comme un écho aux semaines de violences suscitées par une réforme contestée du corps électoral local votée à Paris, qui ont marqué il y a un an le Caillou.
Le printemps de colère avait laissé place à un long cycle de tensions. Saint-Louis en a payé un lourd tribut. Trois « enfants » de la tribu, voyous incontrôlables pour certains, martyrs pour d'autres, ont perdu la vie dans des affrontements avec les forces de l'ordre. A l'été, Saint-Louis fut coupé du monde, placée sous blocus après une série de caillassages et de violents « car-jackings » sur la route traversant la tribu, unique lien entre Nouméa et l'extrême sud de la Nouvelle-Calédonie.
Ses 1 200 habitants devaient franchir à pied les barrages de gendarmerie, chargés de sac et de provisions. Les gendarmes, qui ont essuyé plus de 400 tirs, parlaient du « lieu le plus dangereux de Nouvelle-Calédonie », les chefs coutumiers dénonçaient un « blocus colonial ».
Tournoi de foot annulé
La route a depuis rouvert, mais les stigmates restent visibles. En ce 13 mai, des débris jonchent les fossés, vestiges d'affrontements dans la nuit rapidement réprimés. Trois escadrons de gendarmes, appuyés par deux blindés Centaure, surveillent toujours l'axe nuit et jour.
La situation est « normalisée » mais l'état d'alerte demeure, précise le général Nicolas Matthéos, commandant de la gendarmerie de Nouvelle-Calédonie. Pour le moment, hors de question de « dégrader » ce dispositif qui rassure les habitants des communes du sud.
Saint-Louis vit avec le souvenir des troubles de 2024. Émile, ancien président de la Frégate, le club de football local, a tenté d'organiser un tournoi en décembre. Personne n'est venu, « c'était trop frais pour les jeunes » à peine deux mois après la mort de deux d'entre eux.
A la différence du reste de Nouméa, quadrillé par les forces de l'ordre et où rien ne rappelait ce premier anniversaire, impossible à Saint-Louis, haut-lieu du nationalisme kanak, de ne pas commémorer le « soulèvement ». Même s'ils ne sont que quelques dizaines à être venus.
Roger Noraro commente la scène d'un œil tranquille. Figure du syndicalisme, il vit à Nouméa, mais revient souvent à Saint-Louis. « On ne fait pas d'omelette sans casser des œufs », glisse-t-il sans ciller, en évoquant les trois morts. Puis il cite Jean-Marie Tjibaou : « Tant qu'il y aura un Kanak sur Terre, il revendiquera son indépendance ».
Incertitude politique
Un peu plus loin, Hélène, 36 ans, brandit son drapeau aux abords de la route. Les nombreux coups de klaxons -« et pas seulement de kanak »- la rassérènent. « Un an que le peuple s'est réveillé », lance cette ancienne responsable de caisse, qui a quitté son emploi juste avant les émeutes.
« J'avais compris que travailler et lutter en même temps n'était pas possible », lance-t-elle avant de dénoncer « l'entêtement » de l’intergroupe non-indépendantiste Les Loyalistes-Le Rassemblement, qui ont rejeté la semaine dernière un projet d'accord politique présenté par le ministre des Outre-mer, Manuel Valls. Ce projet visait une forme de souveraineté partagée sans rompre le lien avec la France.
Depuis, l'archipel est retombé dans l'incertitude politique, sans pour autant entamer l'aspiration intacte de nombre de Kanak à l'indépendance. « La souveraineté pleine et entière », répète comme un mantra un homme d'une quarantaine d'années, regard dur, qui fume une cigarette en silence. Il finit par lâcher : « Qu'est-ce qu'ils ne comprennent pas ? C'est le tarmac et l'avion s'ils ne sont pas contents ! »
Ailleurs dans le Grand Nouméa, le premier anniversaire de ces émeutes, qui suscitait de fortes craintes chez certains habitants et a été marqué par le déploiement de 2 600 policiers et gendarmes, a été calme, selon le haut-commissariat. Seules quelques entraves à la circulation et quatre arrestations ont été recensées.
Avec AFP