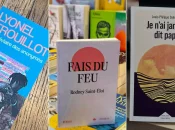Alexandre Juster, ethnologue et spécialiste du Pacifique Sud, participe cette semaine à La Mer en tournée, un événement itinérant proposé par le ministère de la Transition écologique, de la Biodiversité, de la Forêt, de la Mer et de la Pêche qui s’inscrit dans le cadre de l’Année de la Mer 2025. Il donnera vendredi 21 février à la Cité des Sciences et de l’Industrie à Paris une conférence intitulée « La perception et la gestion durable de la mer en Polynésie française ». Outremers360 l’a rencontré.
Sur quoi portera votre conférence ?
Destiné au grand public, je vais tâcher de revenir sur l’importance culturelle et historique de l’Océan pour les Polynésiens. On dit souvent que la moitié de l’espace maritime français se trouve dans les eaux polynésiennes -et que par ailleurs 97% de la ZEE se situe en Outre-mer- mais on oublie que derrière ces chiffres, il y a des femmes, des hommes, des échanges et des pratiques séculaires qui rythment la vie des habitants de Polynésie française.
Derrière la stratégie maritime nationale, où les Outre-mer et donc la Polynésie française occupent une place dont l’importance varie selon les décisions politiques et budgétaires, il faut écouter, étudier, réfléchir et prendre en considération ce que les habitants disent et ressentent.
C’est ce que la Nouvelle-Zélande a fait en 2017, en reconnaissant une personnalité juridique au fleuve Whanganui. Pour les Maoris, qui partagent de nombreux marqueurs culturels avec la Polynésie française, ce fleuve est un être vivant. Quand Wellington a intégré dans la législation nationale la connexion qui existe entre les Maori et la nature, elle a mis en exergue que la protection de la nature doit s'appuyer sur la culture locale et que la tradition orale et la législation écrite peuvent se conjuguer.
En Polynésie française, les pratiques et les échanges étaient intrinsèquement liés à la protection de la nature, et donc de l’océan.
Justement, quelles sont ces pratiques et ces échanges ?
Les sociétés polynésiennes vivaient tout autant de l’élément marin que terrestre. Par une forte hiérarchisation, les espaces et les ressources étaient scrupuleusement gérés, distribués, mis en valeur afin que les habitants puissent se nourrir et que les chefs en tirent du prestige.
L’archéologie démontre par ailleurs que les intérieurs des îles étaient peuplés. On y bâti des tarodières, mais aussi des marae, temples lithiques à ciel ouvert, qui étaient des espaces pour des cérémonies religieuses, sociales ou encore familiales.
Ayant développé des pirogues de différentes tailles et des techniques de pêche diverses, le lagon et la haute mer étaient également utilisés pour la ressource marine.
Et qu’en était-il des échanges ?
Les habitants, insulaires, sont bien sûr arrivés par la mer. Le peuplement n’était le fait de dérives accidentelles ou d’errance sur les flots mais était bien le produit d’un projet social commun. Les échanges avec l’île d’origine perduraient. Ainsi, on se rendait sur des marae internationaux, celui de Taputapuatea à Raiatea par exemple, pour y effectuer des cérémonies.
La distance n’était pas un frein : par exemple, les Tahitiens s’y rendaient, tout comme les Maoris de Nouvelle-Zélande. Les premiers habitaient à 300 km à l’est de Taputapuatea, les seconds à plus de 4 000km au sud-est. Et cela sans sextant !
Pour beaucoup, dans l’Occident, la mer est une barrière, une frontière. En Océanie, c’est un moyen d’échange, de communication. Dans l’Hexagone, la mer sépare les hommes. Dans le Pacifique, elle les relie.
La navigation traditionnelle polynésienne n’a jamais été aussi moderne. Aujourd’hui, on ne compte plus les initiatives locales de construction de pirogues doubles, les voyages sans instrument de navigation moderne, en utilisant uniquement les techniques anciennes et les rencontres de ces pirogues dans tous les archipels du Pacifique. C’est notamment le cas de la Tahiti Voyaging Society et de la pirogue Faafaite.
La connexion entre la mer et les Hommes se manifeste en Polynésie dans les langues, dans le vocabulaire polynésien, dans les récits issus de la littérature orale, dans les gestes et les techniques. Je reviendrai dans ma conférence sur toutes ces facettes.
Je parlerai également du malentendu culturel qu’il a pu exister, et qui existe parfois encore entre l’occident et la Polynésie. Lors des premiers contacts, puis pendant l’époque coloniale, Paris est passé complètement à côté de la dimension maritime polynésienne. James Cook ou Samuel Wallis ont abordé Tahiti alors qu’ils recherchaient un continent tandis des philosophes ont cru découvrir un paradis terrestre. Il y a bien sûr d’autres exemples.
En quoi la perception et la gestion de la mer en Polynésie peut-elle à l’avenir inspirer le Monde ?
Elle l’inspire déjà ! Les catamarans sont directement inspirés des pirogues doubles polynésiennes.
La pratique du rāhui, cette interdiction temporaire de prélèvement d’une ressource marine ou terrestre, décidée par un chef pour laisser le temps à cette de se reconstituer est une formidable manière d’intégrer une pratique culturelle aux enjeux actuels de préservation des ressources et de développement durable.
Comme autre inspiration que Paris pourrait, et même devrait, suivre, il y a la réglementation prise localement par le gouvernement polynésien en 2006 qui protège toutes les espèces de requins. En Polynésie française, sur 5 millions de kilomètres carrés, tous les requins sont protégés. Il y est interdit de les capturer, de les transporter, de les mutiler, de les tuer, de les détenir ou d’en faire commerce.
Comme la Nouvelle-Zélande l’a donc fait pour des fleuves et même des montagnes, l’Hexagone ferait bien d’intégrer au niveau national cette législation issue d’une pratique culturelle locale. Paris devrait même porter cet exemple polynésien au niveau européen et mondial.
On tue chaque année 100 millions de requins dans le monde, alors qu’ils sont extrêmement essentiels à l’océan. Ils sont menacés d’extinction alors qu’ils sont des prédateurs au sommet de la chaîne alimentaire et qu’ils jouent, à ce titre, un rôle primordial dans la santé de la mer. Ils sont une véritable clé de voûte pour la vie marine et donc terrestre.
Ils occupent une place éminente dans la culture polynésienne. L’esprit d’un dieu, d’un ancêtre divinisé ou d’une déité familiale pouvait se manifester sous l’apparence d’un requin. Cet animal, ô combien magnifique, protégeait la famille. Alors qu’ils sont aujourd’hui vulnérables et menacés dans le Monde, prenons exemple sur les Polynésiens. Chérissons-les et respectons la mer, considérée à l’époque comme un temple, un marae.
Les Outre-mer français ne peuvent uniquement servir à la géopolitique, à la recherche marine, médicale ou spatiale. Les cultures et les initiatives locales et modernes doivent également rejaillir sur les citoyens, où qu’ils vivent.
Le 21 février, à 10h30 et 14h30, conférence, « La perception et la gestion durable de la mer en Polynésie française », Alexandre Juster. Cité des Sciences et de l’Industrie, Parc de la Villette, Paris. Entrée libre et gratuite.