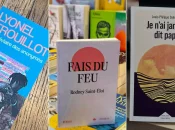Avec ses 11 millions de km² d’espace maritime, la France possède un atout stratégique majeur, pourtant encore sous-exploité. Afin de renforcer la structuration de la filière maritime en Outre-mer, une « Feuille de route Économie Bleue » a été définie, par la direction générale des outre-mer (DGOM) et la direction générale des affaires maritimes, de la pêche et de l'aquaculture (DGAMPA).Son objectif : transformer les défis en opportunités de développement durable, valoriser les filières maritimes et renforcer la coopération entre les territoires.
À l’occasion de sa publication prochaine, Outremers360 a interviewé Nathalie Mercier-Perrin, présidente du Cluster Maritime Français. Directrice du développement économique chez Naval Group durant vingt-trois ans, Nathalie Mercier-Perrin possède une expertise approfondie des enjeux maritimes. Elle siège également dans plusieurs conseils d'administration, dont celui de l'École nationale supérieure maritime. Elle nous livre, ici, son analyse sur les enjeux et perspectives de cette nouvelle stratégie maritime, notamment en matière d’innovation, d’emploi et de transition écologique.
Une nouvelle stratégie maritime pour la France
La DGOM et la DGAMPA ont défini pour 2025 la feuille de route pour l’économie bleue, en concertation avec les acteurs locaux et nationaux, le Cluster Maritime Français ainsi que les 8 Clusters Maritimes d’Outre-mer ayant pleinement participé à cet exercice. L’objectif est de renforcer l’attractivité des métiers maritimes, structurer des projets d’envergure et valoriser les ressources naturelles. Parmi les initiatives retenues, se profile un programme de mentorat afin de permettre aux professionnels d’accompagner les jeunes et les personnes en reconversion dans la découverte des métiers maritimes. En parallèle, la formation initiale et continue sera renforcée en collaboration avec l’Éducation nationale, notamment en s’appuyant sur l’ouverture de classes spécialisées dans les lycées professionnels : « une solution plus rapide et efficace que la création de nouveaux établissements. », précise Nathalie Mercier-Perrin.
D’autres projets stratégiques sont en cours, comme le développement du tourisme durable à Saint-Martin et Saint-Barthélemy, la promotion des énergies marines renouvelables à Saint-Pierre-et-Miquelon, la lutte contre la pêche illégale en Guyane et le soutien à l’industrie navale, essentielle pour la réparation et la mise aux normes des infrastructures. L’aquaculture, levier clé pour l’alimentation et l’innovation, bénéficiera également d’un accompagnement pour renforcer son essor. Le nautisme, notamment dans les Antilles et en Polynésie, fait aussi partie des axes prioritaires. Enfin, afin d’assurer le suivi et l’efficacité de ces actions, un comité de pilotage annuel veillera à la mise en œuvre de projets concrets sur les trois prochaines années.
La gestion des sargasses, transformer une contrainte en opportunité économique
Pour Nathalie Mercier-Perrin, un enjeu majeur concerne la gestion des sargasses en Guadeloupe et en Martinique : « Ce qui m’intéresse particulièrement, c’est la valorisation de cette algue, idéalement avant qu’elle n’atteigne les côtes. En effet, une fois échouée, son exploitation devient beaucoup plus complexe. Il existe déjà des initiatives de valorisation, notamment en Guadeloupe, où l'on fabrique des lunettes, des briques et même de l’énergie à partir de la sargasse. Cependant, étant donné son caractère saisonnier, il semble pertinent de développer des systèmes multisources en combinant, par exemple, la sargasse avec la bagasse ou d'autres biomasses locales pour assurer une production d’énergie plus stable. Par ailleurs, certaines pratiques consistent à broyer la sargasse en mer pour qu’elle coule au fond des océans. Des experts suggèrent même qu’en la compactant et en l’immergeant dans les grands fonds marins, elle pourrait participer à la capture du carbone et ainsi contribuer aux objectifs environnementaux globaux. »

Année de la Mer : renforcer la dynamique maritime en outre-mer
En 2025, la France célèbre l'année de la Mer et souligne ainsi le rôle stratégique des territoires ultramarins. Cette initiative prend une dimension particulière pour l’outre-mer, avec une volonté affirmée de dynamiser l’économie bleue sur l’ensemble de ces territoires. L’un des axes majeurs est le renforcement des clusters maritimes ultramarins. Si certains territoires, comme Saint-Pierre-et-Miquelon, la Guadeloupe, la Martinique, la Guyane, La Réunion, Mayotte, la Polynésie et la Nouvelle-Calédonie, disposent déjà de clusters dynamiques, d’autres, à l’image de Wallis-et-Futuna, sont en cours de structuration.
Plusieurs actions verront le jour : la labellisation d’événements maritimes, une forte représentation aux Assises de la mer à La Rochelle les 4 et 5 novembre prochains et un plan de communication ambitieux visant à mieux intégrer ces territoires dans l’écosystème maritime national et international. L’enjeu est également économique : la création d’une bourse à l’emploi maritime commune, le soutien aux startups ultramarines et le développement d’un observatoire de l’économie bleue pour affiner les stratégies locales.
Chaque mois un territoire est mis en lumière, amorçant ainsi une dynamique durable pour renforcer l’intégration des territoires ultramarins dans la politique maritime française et assurer une meilleure prise en compte de ces territoires dans les grandes décisions économiques et environnementales : « L'importance de ces 11 millions de kilomètres carrés se mesure aussi sous l'angle géopolitique, car nous nous situons stratégiquement entre les États-Unis et la Chine. » souligne Nathalie Mercier-Perrin.
Le développement de l’activité portuaire en Outre-mer
Le développement de l’activité portuaire en outre-mer s’inscrit dans une dynamique d’adaptation face aux défis du changement climatique afin d’anticiper la submersion marine et accompagner la transition énergétique avec des infrastructures adaptées aux nouveaux carburants décarbonés. Des études de vulnérabilité sont en cours pour évaluer les risques et les intégrer dans les plans stratégiques 2024-2029 des grands ports maritimes de la Réunion, de la Guadeloupe et de la Martinique.
Par ailleurs, une réflexion est menée sur l’évolution des ports face aux nouvelles exigences économiques et environnementales, notamment en matière de foncier et d’accueil des porte-conteneurs de nouvelle génération. Il s’agit désormais d’accélérer la formation et l’attractivité des métiers portuaires pour soutenir la croissance du secteur dans ces territoires.
C’est dans cette optique que Nathalie Mercier-Perrin plaide pour concilier industrie navale et tourisme de croisière qui selon elle : « doivent être envisagés comme complémentaires plutôt que opposés. Des solutions existent pour concilier développement et écologie, comme l’électrification des ports, la création de plateformes offshore pour l’accueil des navires ou l’utilisation de nouvelles technologies moins polluantes, à l’image du ferry hybride GNL de Brittany Ferries. »
En effet, le tourisme maritime génère une économie locale significative : « Une régulation trop stricte ou une fiscalité excessive risquerait de détourner les flux vers d’autres pays. Il est donc essentiel d’adopter une approche pragmatique, alliant transition écologique et préservation des activités économiques et sociales liées au maritime. »

Mobiliser le secteur privé
Les banques, qui recherchent une visibilité à 40 ans, jouent un rôle clé dans le financement de l’économie bleue : « L’intégration du secteur privé passe par l’élaboration de plans stratégiques construits avec les fédérations professionnelles et les acteurs financiers. En recueillant leur vision à long terme et leurs priorités d’investissement, il est possible d’offrir une lecture claire du développement des filières de l’économie bleue. » précise Nathalie Mercier-Perrin. En effet, un cadre structuré, adossé aux besoins des filières maritimes (aquaculture, construction navale, énergies marines renouvelables, etc.), permet de rassurer les investisseurs et d’accélérer les financements.
L’État reste un soutien via les garanties bancaires et l’amorçage, mais l’objectif est d’impliquer davantage le secteur privé pour financer des projets d’ampleur. Selon Nathalie Mercier-Perrin, « la force du collectif joue un rôle clé : en mobilisant les acteurs du secteur maritime français – construction navale, pêche, énergies marines renouvelables (EMR) – et en fédérant les syndicats professionnels autour du Cluster Maritime Français, nous montrons que l’économie maritime est la colonne vertébrale de l’économie française. »
EG