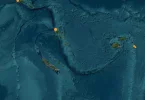Au lendemain du 2ème référendum d’indépendance en Nouvelle-Calédonie, qui a eu pour issue une réduction notable de l’écart entre le « oui » et le « non » à la pleine souveraineté et pour principal enseignement une fracture profonde entre les deux camps, Ferdinand Mélin-Soucramanien, expert sur la question calédonienne, publie une réflexion sur le rôle de l’État, dévolu à l’application stricto sensu de l’Accord de Nouméa, et celui du Gouvernement, qui « exprime une volonté politique », celle de « permettre à cette question d’être résolue en suivant cette voie pacifique propre à la Nouvelle-Calédonie ».
Ce dimanche 4 octobre s’est déroulé en Nouvelle-Calédonie un deuxième référendum. Les résultats sont connus : une participation exceptionnelle, supérieure à 85%, une progression sensible du Oui à la reconnaissance de la pleine souveraineté et donc à l’indépendance avec 46, 74 des voix et, corrélativement, un tassement du Non qui a recueilli 53, 26 %. L’écart entre les tenants du Oui et du Non s’est donc resserré depuis la première consultation de 2018 où le Oui avait rassemblé 43, 60 % des suffrages, tandis que le Non en recueillait 56, 40 %. En valeur absolue, l’écart semble encore significatif, mais il ne faut pas perdre de vue que, compte tenu de l’étroitesse du corps électoral, cet écart ne représente en réalité que 10 000 votants.
Dans ce contexte, l’Accord de Nouméa prévoit qu’un troisième référendum pourrait être organisé. En effet, son point 5 indique que : « Si la réponse des électeurs à ces propositions est négative, le tiers des membres du congrès pourra provoquer l’organisation d’une nouvelle consultation qui interviendra dans la deuxième année suivant la première consultation. Si la réponse est à nouveau négative, une nouvelle consultation pourra être organisée selon la même procédure et dans les mêmes délais… ». Une question identique pourrait donc à nouveau être posée à un corps électoral qui devrait peu assez évoluer, courant 2022, c’est-à-dire l’année même où les dispositions constitutionnelles transitoires issues de l’Accord de Nouméa cesseront de produire leurs effets et, également, l’année où aura lieu l’élection nationale à la Présidence de la République.
C’est dire si Jean-Marie Tjibaou parlait d’or lorsqu’il soulignait que : « le jour le plus important, ce n’est pas celui du référendum, c’est le lendemain ». Aujourd’hui, nous y sommes ! Au moins dans leurs grandes lignes, les positions apparemment antagonistes des uns et des autres sont connues : les indépendantistes réclament la pleine souveraineté de la Nouvelle-Calédonie et la reconnaissance intégrale des droits du peuple premier du pays : le peuple Kanak. Les non-indépendantistes, quant à eux, revendiquent le maintien du lien constitutionnel avec la République française, donc une forme de pérennisation améliorée du statut actuel qui reconnait pourtant déjà une très grande autonomie à la Nouvelle-Calédonie.
Pratiquement, les premiers, pariant sur la progression du Oui, paraissent compter sur l’organisation d’un troisième référendum pour trancher la question, alors que les seconds semblent vouloir l’éviter. Dans leurs prises de position publiques, il existe donc une divergence sur les moyens de parvenir à résoudre cette équation difficile. De plus, quel que puisse être le résultat d’un troisième référendum, la seule chose dont on peut être certain est que le résultat sera très serré et, par conséquent, que l’équation n’aura pas été résolue, les deux camps étant renvoyés face à face. Cependant, des motifs d’espoir existent bel et bien puisqu’en dépit de cette confrontation entre deux prétentions opposées, il existe une réelle convergence sur le point d’arrivée. Tous conviennent désormais que celui-ci est celui inscrit dans l’Accord de Nouméa, à savoir parvenir à traduire dans les faits un « destin commun ».
Nouvelle-Calédonie : Le FLNKS « ira au troisième référendum » pour l’indépendance
Désormais, en Nouvelle-Calédonie, nul ne poursuit plus le sombre dessein de « chasser » l’autre. Chacun perçoit bien que cette terre, originellement peuplée par les Kanaks, a vocation à rassembler d’autres populations en raison de l’histoire commune qu’elle partage avec la France et avec le monde océanien qui l’entoure. L’enjeu est crucial. Pour la Nouvelle-Calédonie, d’abord, qui aspire légitimement à une forme de sécurité juridique et politique sans laquelle, ni le développement économique et social, ni l’épanouissement individuel et collectif, ne seront possibles sur ce territoire. Pour la France, ensuite, qui tient là une occasion unique de réussir, enfin, serait-on tenté de dire, une décolonisation en réinventant son lien avec une ancienne colonie.
Ce qui se joue en Nouvelle-Calédonie ces jours-ci est donc de la plus haute importance pour la France, sa souveraineté, son territoire, sa conception de l’indivisibilité de la République, son rôle géopolitique, etc. Le président de la République, M. Emmanuel Macron, l’a parfaitement compris en faisant une intervention solennelle dès les résultats du deuxième référendum connus. Il l’a parfaitement compris également en déléguant sur place le ministre des outre-mer, M. Sébastien Lecornu, pour une mission d’une durée exceptionnellement longue : trois semaines. Le caractère crucial de l’enjeu paraît donc avoir été pleinement perçu.
Néanmoins, des voix s’élèvent encore pour dénoncer la vacuité de l’action de l’État dans ce processus. C’est sur ce point qu’une ambiguïté constitutionnelle mérite d’être levée : dans notre droit, dans la Constitution de la Vème République, l’État ne se confond pas avec le Gouvernement. Que l’État, signataire de l’Accord de Nouméa, conformément à la tradition républicaine, ait appliqué loyalement cet accord politique en organisant dans des conditions de parfaite neutralité le premier, puis le deuxième référendum, et en se préparant à organiser le cas échéant un troisième et dernier référendum : quoi de plus normal ? C’est son rôle, ni plus, ni moins.
L’État apparaît comme une entité abstraite et, en termes juridiques, une personne morale, détachée de la personne physique des gouvernants. Le progrès qui a marqué l’évolution des sociétés modernes a, en effet, consisté à institutionnaliser le pouvoir politique, c’est-à-dire à le dissocier progressivement de la personne de ceux qui commandent pour le confier à l’État. Certes, c’est de l’État que les gouvernants reçoivent leurs compétences, c’est en son nom qu’ils les exercent. Mais le pouvoir est attaché à leur fonction, non à leur être. Le temps de « l’État c’est moi ! », selon la formule apocryphe prêtée à Louis XIV, est définitivement révolu.
Ainsi l’État, symbole de la communauté nationale et titulaire du pouvoir politique, dont les gouvernants ne sont que les dépositaires provisoires et les agents d’exercice, est-il nécessairement érigé en personne morale de droit public, seule solution susceptible d’assurer sa continuité et d’en faire un centre de décisions. Il paraît donc naturel que lorsque la parole de l’État est engagée dans le respect d’un accord politique celle-ci soit scrupuleusement respectée par ce qu’on appelle parfois l’appareil d’État, c’est-à-dire en l’occurrence, l’administration, le Haut-commissaire représentant l’État en Nouvelle-Calédonie, etc. sans que soit exprimée une quelconque volonté politique.
En revanche, le Gouvernement, lui, c’est tout autre chose. On sait que, dans l’équilibre des pouvoirs propre à la Vème République, on peut s’autoriser à parler de « gouvernement présidentiel » dans la mesure où le Gouvernement tire sa légitimité autant de la majorité parlementaire au sein de l’Assemblée Nationale que de la volonté du Président de la République auquel l’article 8 de la Constitution confère le pouvoir de nommer le Premier ministre. Le Gouvernement est donc l’incarnation démocratique d’une double majorité, à la fois présidentielle et parlementaire. Dans ces conditions, rien de plus naturel à ce que le Gouvernement exprime une volonté politique puisque les représentants de la Nation lui ont confié ce mandat.
C’est ce que le Président de la République, M. Emmanuel Macron, a commencé à faire lors de son intervention du 4 octobre 2020, d’une part, en soulignant l’importance de l’enjeu, qui conduit à devoir « appréhender les conséquences concrètes de tous les scénarios » ; et, d’autre part, en posant clairement les termes du débat : troisième référendum ou « nouveau projet » ? C’est sans doute ce que s’apprête à faire de manière plus détaillée et au terme d’une concertation locale le ministre des outre-mer, M. Sébastien Lecornu, dont le communiqué de presse souligne bien qu’il se rend pour plusieurs semaines en Nouvelle-Calédonie « … à la demande du Président de la République et du Premier ministre ».
Tout laisse donc à penser que le « gouvernement présidentiel », ici le Président de la République et le Premier ministre, représentés par le ministre des outre-mer, va dévoiler entièrement sa volonté politique et ainsi permettre à cette question d’être résolue en suivant cette voie pacifique propre à la Nouvelle-Calédonie. Le moment, ne nous y trompons pas, est historique. Le « portage » au plus haut niveau, par le Président de la République et le Premier ministre en est un premier indice. Reste à savoir maintenant quelle va être précisément l’option politique portée par le Gouvernement. Le Président a déjà commencé à soulever un pan du voile en indiquant que les électeurs ayant « majoritairement confirmé leur souhait de maintenir la Nouvelle-Calédonie dans la France », il accueillait « cette marque de confiance dans la République avec un profond sentiment de reconnaissance ». La suite reste à écrire…
Ferdinand Mélin-Soucramanien
Professeur de droit à l’université de Bordeaux
Co-auteur de Réflexions sur l’avenir institutionnel de la Nouvelle-Calédonie, La documentation française, 2014
Président de L’Association des Juristes en Droit des Outre-Mer (L’AJDOM)