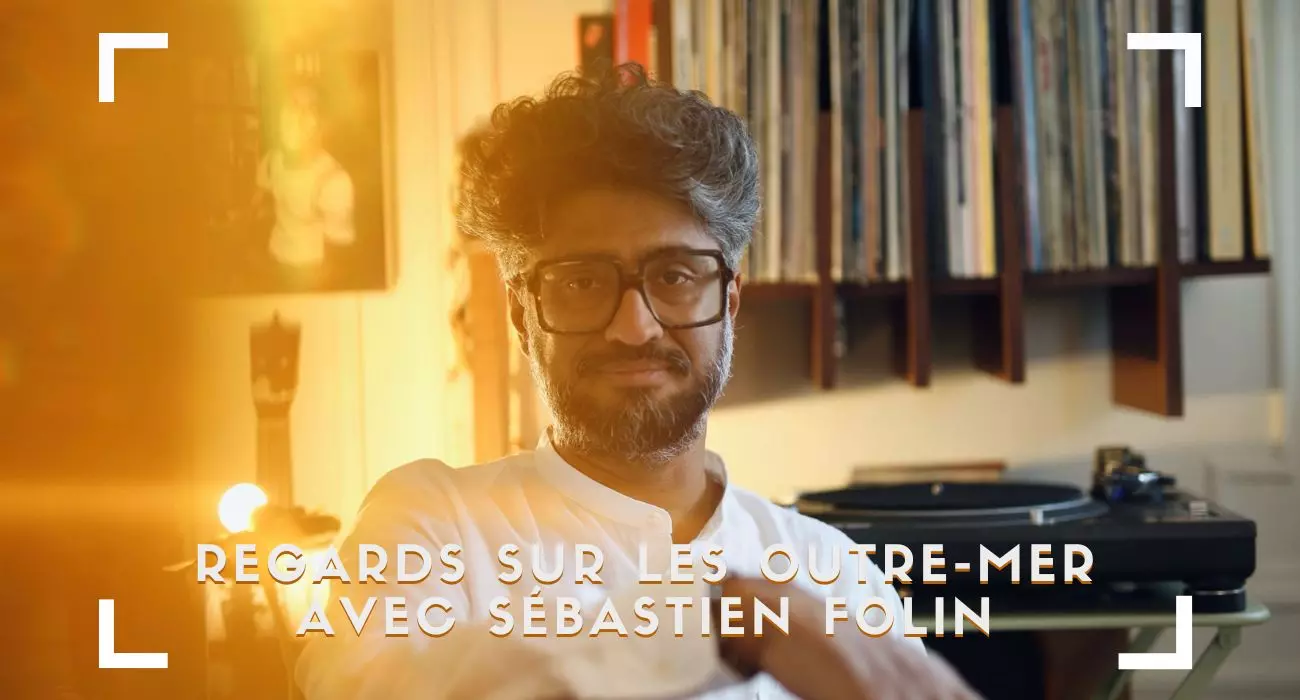Tout le monde connaît Sébastien Folin, animateur sur TF1, France Télévisions et TV5 Monde. Mais derrière cette image populaire se cache un producteur engagé, à la tête de La Belle Télé, sa société de production fondée en 2009, où il défend un autre regard sur le monde. Depuis plus de quinze ans, Sébastien Folin construit une œuvre exigeante et accessible, au croisement de l’intime et du social, du local et du mondial. Il revendique son approche du métier : changer les regards sur les Outre-mer, faire émerger d’autres récits, et contribuer à faire de La Réunion un hub cinématographique international. Pour Outremers 360, il se confie sur son parcours, sa vision du métier et ce qui l’anime : créer, résister, transmettre et déplacer les perspectives.

Un parcours toujours en mouvement
À 55 ans, Sébastien Folin incarne une trajectoire singulière, marquée par la curiosité, la liberté, et l’engagement. Né à Madagascar, il grandit à La Réunion, où il découvre très tôt l’univers des médias. À 15 ans, il fait ses débuts à la radio : « J’ai appris sur le tas. J’ai touché à tout, parce qu’il fallait. » À l’époque, l’accès à la technique est un luxe, mais il trouve toujours un micro, une caméra, un studio. Rien ne l’arrête.
En 2000, il débarque à Paris. Le grand public le découvre sur TF1, où il présente la météo, puis Vidéo Gag. En parallèle, il anime Acoustic sur TV5MONDE pendant treize ans (2005–2018), une émission musicale dans laquelle il reçoit plus de 500 artistes venus du monde entier. Il a également été présent sur la chaîne France Ô dans des émissions culturelles.
Mais derrière ce parcours aux multiples casquettes, il y a une matrice plus profonde : « Avec le recul, on comprend qu’être issu d’un territoire d’Outre-mer, marqué par une histoire coloniale, par l’esclavage, par l’oppression culturelle, forge une forme de créativité singulière. La contrainte engendre l’innovation. De ma naissance à Madagascar, de ma vie entière passée à La Réunion. Ce sont des histoires personnelles, bien sûr, mais aussi profondément collectives. Et on le voit : les populations ultramarines, et plus largement, toutes les populations opprimées dans le monde, développent une incroyable capacité à rebondir, à inventer, à se réinventer. » Avec les années, il approfondit ce lien : « Je me suis intéressé à l’histoire de mon île, à celle de Madagascar aussi, car bien que je sois né là-bas, c’est à La Réunion que j’ai grandi, que je me suis construit. C’est mon ancrage. Et en creusant ces histoires, je comprends mieux aujourd’hui combien elles infusent dans ma manière d’être, de créer, de faire les choses. »
De TF1 à France Télévisions : changement de cap
En 2009, Sébastien Folin prend un virage déterminant. Alors qu’il aurait pu poursuivre une carrière confortable, il choisit de quitter TF1 pour animer un programme scientifique sur France Télévisions : « Inconsciemment, je sentais que je perdais ma liberté. Le confort s’installait, et avec lui une forme de routine. Or j’avais besoin de mouvement, de création. En 2009, je prends donc une décision importante, mais réfléchie. Je n’ai pas claqué la porte sur un coup de tête. Ce n’était pas un caprice. Mais j’avais fait le tour. J’avais présenté la météo pendant huit ans, j’avais adoré ça, c’était un exercice formidable, mais j’étais arrivé au bout. »
L’environnement évolue aussi : les chaînes changent, les réseaux sociaux émergent, le paysage audiovisuel bascule dans une nouvelle ère. Lui, pressent que c’est le bon moment pour bifurquer. « A l’époque, la télé était en pleine transition, les réseaux sociaux émergeaient… J’avais connu la télé avant la bascule numérique. Il y avait encore une vraie exposition, une vraie intensité. Mais je pressentais que ce monde-là allait changer. »
La Belle Télé : une vision artisanale et incarnée de la production audiovisuelle
Dans le même temps, il fonde La Belle Télé avec son ami Olivier Drouot, une société de production qui deviendra le prolongement naturel de son besoin de raconter autrement. Comme il le dit lui-même : « Je suis parti (de TF1) avec méthode. J’ai monté ma boîte de production, j’ai sécurisé les choses, je ne me suis pas lancé dans le vide. J’ai anticipé, posé les bases. Ce choix, c’était à la fois une quête de sens et une manière de produire autrement. »
Dès lors, le professionnel et le citoyen se rejoignent. Avec La Belle Télé, Sébastien Folin défend une vision artisanale, presque militante, de la production audiovisuelle. Une démarche fondée sur l’humain, le sensible, le réel : « On oublie souvent, à force de parler de programmes, que derrière, il y a des gens, des incarnations. Aujourd’hui, on est dans une ère très marquée par le storytelling, mais paradoxalement, elle devient de plus en plus désincarnée. On parle beaucoup de chiffres, de process… alors qu’on est censés appartenir à une industrie créative. » Cette tension entre contenu et format, entre exigence et accessibilité, traverse toute sa production.
Avec son associé, il explore des thématiques fortes, mémoire, identité, luttes sociales, récits invisibles, en les articulant à des formes narratives ouvertes et populaires : « Notre travail, c’est justement de prendre ces sujets et de chercher comment les rendre accessibles au plus grand nombre. Ce n’est pas dans une posture condescendante où l’on simplifierait les choses. C’est plutôt l’idée d’utiliser les codes du divertissement pour faire passer des idées, parfois complexes, sans les diluer. »
Pour illustrer sa pensée, il cite Imagine de John Lennon, qu’il décrit comme étant « une chanson politique enrobée dans du miel ». Une forme douce, mais un fond percutant. « C’est exactement ce que j’essaie de faire : proposer des contenus qui, en apparence, sont légers, fluides, attrayants, mais qui transportent, en filigrane, des idées fortes. »
Des projets comme Vacarme en Haute Mer (2012), un documentaire pionnier sur la pollution sonore et son impact sur les mammifères marins, Bootyful de Rokhaya Diallo qui interroge l’engouement internationale pour les fesses des femmes, Cosmic Trip de Christophe Conte et Gaëtan Chataigner, Les Serge ou Ziskakan, une révolution créole, et plus récemment A la poursuite du Rougail Saucisses témoignent de cette ambition : parler du réel avec intensité, sans pesanteur, et toujours en construisant des récits à plusieurs couches.
Ce qu’il cherche avant tout, c’est le moment du débat, ce point de bascule où une œuvre suscite plus de questions que de réponses. « J’adore ce moment après un film, une série ou un documentaire, où les discussions commencent. Chacun a vu quelque chose de différent. Et quand ça arrive, c’est que le travail a été bien fait. » Ce plaisir du dialogue, de la nuance, de la contradiction, reste son moteur. « C’est ça qui me passionne : déclencher la discussion, le débat, parfois même la contradiction. C’est ce que j’aime en tant que spectateur… et ce que j’espère provoquer chez ceux qui regardent nos programmes. »
La Belle Télé totalise 700 heures de programmes au compteur à ce jour


Les futurs rendez-vous de La Belle télé
Plusieurs projets ambitieux sont actuellement en développement, témoignant d’une ligne éditoriale engagée et éclectique. Parmi eux, Meurtre à Gavarnie, écrit par Adeline Laffitte et Zlise Thibaut, coproduit avec Écrans du Monde (filiale audiovisuelle du groupe Sud Ouest) et développé avec France Télévisions, dont le tournage est prévu pour septembre 2026 dans les Pyrénées. À La Rochelle, lors des Rencontres Francophones, Pieds Rouges de Céline Primard – lauréate de la bourse Beaumarchais 2024 – a attiré l’attention avec son intrigue poignante située à Saint-Pierre-et-Miquelon : un thriller à la tonalité écologique sur fond de disparitions en mer et de résistances féminines face à la prédation économique.
De son côté, le long métrage Pur et Dur, inspiré du parcours de Kamel Guemari à Marseille, est en cours de coécriture avec Fred Journet et en co-production avec Laurence Lascary (L’Autre Côté du Périph’) et Gilles Masson (GAD Fiction). Sofiane Zermani est pressenti pour incarner le rôle principal. Sébastien Folin assurera la réalisation.
Autre projet en gestation : Solo per Abonnati, une série imaginée par Salvatore Alloca et développée avec Lucy de Crescenzo, productrice et distributrice de cinéma italienne. Cette comédie sociale explore les ressorts économiques et intimes d’une femme contrainte de se tourner vers OnlyFans pour boucler ses fins de mois, et surtout sauver sa famille en pleine décomposition. Enfin, une série pour le pôle Outre-mer de France Télévisions, développée avec Sylvie Gengoul et Hélène Saillon, amorce également son processus de création.
La Réunion, hub cinématographique de l’océan Indien
Pour Sébastien Folin, La Réunion a tous les atouts pour devenir un hub cinématographique d’envergure internationale : « Nous sommes ici au cœur de l’océan Indien, à proximité de toute l’Afrique de l’Est et de l’Afrique australe, des régions qui connaissent actuellement un fort développement dans les domaines du cinéma et de l’audiovisuel. Face à nous se trouve le premier marché mondial du cinéma : l’Inde. La Chine n’est pas loin non plus, et l’Océanie est toute proche. Dans ce contexte, il est temps de décentrer les regards, de repenser les dynamiques. »
La dynamique locale est bien réelle. La Région a maintenu ses budgets audiovisuels, même face aux coupes de l’État, et des talents émergent. Mais pour que le territoire prenne toute sa place, il faut aller plus loin : « Il ne suffit plus de prendre des scénaristes réunionnais comme consultants pour ajouter de la couleur locale. Il faut leur confier les clés, leur permettre d’écrire et de réaliser leurs propres récits. » La vision est claire : permettre l’émergence d’un cinéma réunionnais, à la fois enraciné et universel.
Sébastien Folin défend une approche « glocale » : des récits ancrés, portés par des auteurs qui connaissent leur culture, leur territoire, leur langue, mais capables de toucher le monde entier : « Le local, ce n’est pas un frein. C’est une force. Ce n’est pas juste une couleur de fond. C’est une culture, un regard, une manière de raconter. » Ses exemples : Eugène Palzy, Lucien Jean-Baptiste et la jeune génération, Nelson Foix en Guadeloupe avec Zion et Grégory Lucilly à La Réunion avec Marmaille : « Un regard extérieur n’aurait jamais pu capter ce plan saisissant dans Zion de Nelson Foix, où le héros traverse un quartier populaire et soudain, l’horizon se retrouve barré par un paquebot. Ce plan est hallucinant, d’un niveau visuel comparable à une vue aérienne du pont de Brooklyn. Ce plan, bouleversant et spectaculaire, n’aurait pas pu exister sans cette différence de regard. Ce n’est pas un repérage de décor qui l’a amené, c’est le regard quotidien du réalisateur. Il le voyait chaque matin, à chaque passage, et il savait qu’il le filmerait un jour. Ce n’est pas le fruit du hasard ou d’un coup d’œil opportuniste. C’est pareil pour Grégory Lucilly avec Marmaille : ce regard enraciné dans le territoire, c’est ce qui nous fait monter en compétence localement, à La Réunion comme ailleurs. »
L’authenticité d’un ancrage local peut devenir un puissant vecteur d’universalité. Il s’agit de changer de perspective, de déplacer les regards, et de faire émerger d’autres récits à travers une approche qui allie vision globale et enracinement territorial : « Moi, ce qui m’intéresse, c’est raconter des histoires vraies, enracinées, qui élèvent, qui déplacent le regard, qui changent les perspectives. Parce que le cinéma, la fiction, c’est aussi un outil formidable pour faire bouger les lignes. Faire du glocal. »

Le territoire n’est plus la limite
Mais les choses ne vont pas de soi. Les obstacles, il les connaît pour y avoir été confronté : « Il y a des injustices profondes. La première, c’est notre position géographique. La deuxième, c’est que pour se réaliser, on est souvent obligé de quitter son île. Et la troisième, c’est que même une fois partis, même diplômés, même brillants, il reste très difficile de trouver un emploi, ou de revenir chez soi pour y apporter ses compétences. »
Mais la technologie permet de contourner ces difficultés : « Aujourd’hui, on peut faire énormément de choses sans quitter son territoire. Les jeunes créateurs réunionnais que je vois sur les réseaux me bluffent. Ils sont drôles, inventifs, originaux. Ils utilisent leur langue, leur culture, leur réalité. Et surtout, ils créent avec ce qu’ils ont : un téléphone, une idée, un peu de temps. »
Il le rappelle : l’accès à la connaissance n’a jamais été aussi ouvert. : « Il n’y a plus besoin d’avoir une caméra à pellicule ou de faire une école à Paris. Vous voulez apprendre ? Il y a YouTube. Des cours, des masterclass, des tutos… Tout est là, accessible, souvent gratuitement. » Ce qui compte, c’est l’envie, la curiosité, la capacité à oser. « Oser faire. Oser rater. Oser publier. Aujourd’hui, avec les réseaux, vous pouvez toucher le monde entier depuis votre chambre. » Comme un message adressé à la nouvelle génération de réalisateurs ultramarins, il lance : « Vous avez du talent. Vous avez les outils. Prenez-les. Faites. Créez. Racontez. Et surtout, restez fiers de qui vous êtes et d’où vous venez. Parce que c’est ça, votre vraie richesse. »
Et pour appuyer ses mots, il partage un souvenir personnel : « Quand j’avais 15 ans et que je voulais faire de la radio, il fallait que mes cousins à Paris m’envoient des cassettes enregistrées avec les voix des animateurs que j’admirais. Aujourd’hui, tout est là. En un clic. » Le talent et l’audace feront le reste !
EG