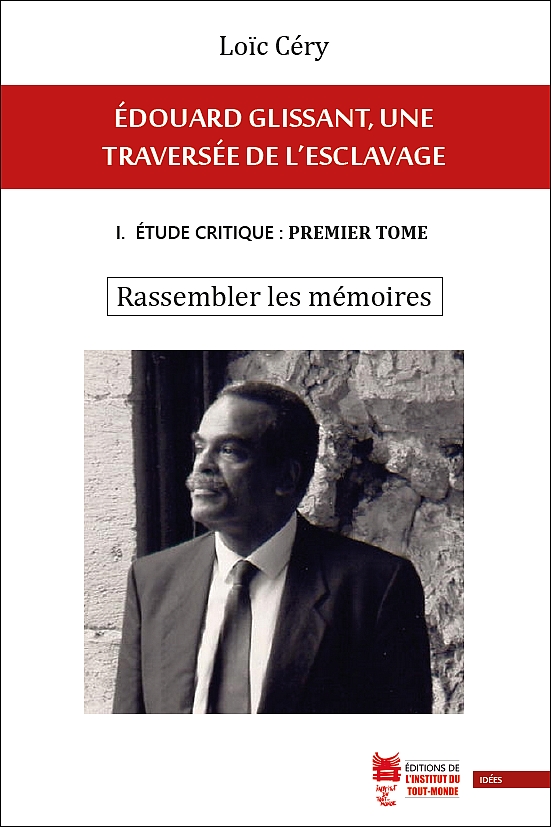Considéré comme un exégète de la pensée d’Edouard Glissant, le chercheur Martiniquais Loïc Céry vient de publier aux éditions de l’Institut Tout-Monde une étude critique en deux tomes « Rassembler les mémoires » et « Renverser les gouffres » qui sera suivie d’une anthologie commentée de l’ensemble des textes consacrés aux questions de l’histoire et des mémoires par l’auteur martiniquais – père-fondateur du concept Tout-Monde – décédé en 2011, regroupé sous le titre générique « Edouard Glissant, une traversée de l’esclavage ». Des ouvrages de référence à mettre entre toutes les mains en cette période de résurgence de la « mémoire active » et de « choc de représentation de l’histoire avec le présent ». Entretien exclusif diffusé en deux parties.
Vous êtes certes considéré comme un exégète de la pensée d’Edouard Glissant mais pourquoi avoir choisi aujourd’hui de publier cette étude critique et cette anthologie commentée de l’ensemble des textes consacrés par l’auteur martiniquais aux questions liées à l’histoire et aux mémoires de l’esclavage ?
Je crois que la réponse réside singulièrement dans l’actualité que nous vivons actuellement, dans le monde entier. Car lorsque j’avais jugé utile de proposer cette étude critique qui vient d’être publiée en deux tomes, et qui sera suivie de près par l’anthologie commentée qui la complète (et qui, elle, paraîtra vers septembre ou octobre), je ne me doutais pas, je vous l’avoue, que le moment même de ces publications coïnciderait avec une telle actualité. Il aura fallu l’assassinat en direct d’un homme à Minneapolis, filmé et diffusé sur les écrans partout dans le monde, pour que brutalement, et dans des proportions massives, les mémoires vives et douloureuses du passé esclavagiste reviennent sur le devant de la scène, certes indirectement mais avec vigueur. Ce n’est pas la première fois que ces problématiques resurgissent ainsi, à partir d’un fait aussi odieux, mais je crois que le moment actuel est en grande partie inédit, par l’entrecroisement de questions historiques et de réalités liées au vécu des personnes – et ce choc de représentation de l’histoire avec le présent, c’est justement cela, la mémoire active. Quand elle déferle, rien ne peut plus l’arrêter.
Le tabou de l’histoire de l’esclavage
En amont, il m’était apparu ce qui est encore plus manifeste aujourd’hui : ce qui nous manque terriblement dans ces débats, ce sont des repères sûrs, provenant de l’articulation d’une réelle pensée – je veux dire, une pensée susceptible de nous fournir justement ces points de repères qui nous permettent, à notre tour, de réfléchir selon des perspectives suffisantes, et des perspectives qui ne soient pas faussées. Et sans en faire un « maître à penser » (car il n’a jamais recherché cette position et aurait été outré qu’on la lui attribue), je crois fondamentalement qu’Édouard Glissant nous a laissé cette pensée dense qui à la fois nous permet de poser correctement les questions, et d’envisager leurs différents aspects, selon des méthodologies croisées. Or on le voit bien : depuis plusieurs semaines, les débats menés sur ce terrain sont particulièrement contradictoires – ce qui en soi est plutôt bon signe – mais ils révèlent de surcroît des inconvénients majeurs : une méconnaissance considérable de l’histoire de l’esclavage colonial, une tentation apparemment irrépressible de se livrer à toutes sortes de mélanges et surtout, reconnaissons-le, mille et une stratégies pour défendre un discours normé où l’on voudrait surtout ne toucher à rien, ne rien remettre en cause et finalement ne rien dire ni suggérer parce que cela porterait préjudice à je ne sais quelle vision fixiste de l’histoire de France et de l’Occident. C’est ce qui s’appelle, je crois, un tabou.
Et c’est parce que ces débats sont si « gênants » et qu’ils sont susceptibles de déranger chacun d’entre nous dans ses certitudes ou de nous livrer au flot de passions mal maîtrisées, que le recours à une pensée dense comme celle que Glissant a su articuler dans ces champs, me paraît indispensable en France et dans le monde. Mais alors même que l’audience de son œuvre n’a cessé de s’accroître ces dernières années (c’était déjà le cas avant la mort de l’écrivain en 2011, mais ça l’est plus encore aujourd’hui), la force visionnaire de tout ce qu’il a écrit sur l’esclavage, son histoire et ses mémoires n’est pas encore suffisamment apparue. Il faut l’attribuer à l’exigence même de tous ces écrits et au fait qu’ils ne cherchent pas l’établissement d’une suite de « recettes » arbitraires, de celles qu’on aime à pratiquer aujourd’hui – car nous sommes devenus, bon an mal an, très friands des courtes vues dont nous sommes tout autant prisonniers, car personne n’y trouve vraiment son fait.
Par cette étude critique, je me suis attaché avant tout à faire apparaître l’ampleur de cette pensée de l’esclavage conçue dans ses différentes dimensions, sur plus de cinquante ans de production intellectuelle. Je crois vraiment que chez aucun écrivain, n’est représenté ce qui chez Glissant apparaît à la fois comme pensée de l’histoire, pensée philosophique, anthropologique et politique des questions liées à la traite et à l’esclavage colonial, alors qu’en parallèle, le même écrivain a pu mener ce qu’il nomme dans Le Discours antillais la nécessaire « exploration créatrice » de la question dans tous les genres littéraires (roman, poésie, théâtre). J’ai voulu analyser les différents aspects de cette ampleur totalement inédite, et montrer surtout combien cette réflexion et ce travail de représentation s’adressent à chacun de nous, dans la nécessité et même l’urgence où nous nous trouvons, de repenser ces questions.
Le crime contre l’humanité a ceci de spécifique : il touche (soit par la nature du génocide, soit par la déshumanisation dont ont pu procéder les autres cas, comme l’esclavage par excellence) à l’humanité de tout un chacun.
En quoi le « Rassemblement des mémoires » et « l’impétuosité de la connaissance » prônés, selon vous, par Glissant sont des pensées déterminantes et inédites de l’histoire et des mémoires issues de la traite et de l’esclavage ?
Déjà parce qu’en énonçant simplement ces deux aspects, je me suis surtout efforcé de les présenter conformément à ce que Glissant y met (et d’en faire en somme la nécessaire pédagogie), car ce sont là des notions assez exigeantes en soi et à propos desquelles on pourrait commettre bien des contresens (et on ne s’en prive pas, généralement).
Ainsi, quand Glissant parle d’un « rassemblement des mémoires », il ne s’agit pas, contrairement à ce que l’on pourrait penser, de cette vision lénifiante que certains ont voulu tirer, par paresse intellectuelle le plus souvent, de ses derniers écrits, notamment Mémoires des esclavages – qui représente en 2007 la version augmentée du rapport qui avait été demandé à l’écrivain par le président Jacques Chirac pour l’établissement d’un centre national pour l’histoire et les mémoires de l’esclavage (on ne parlait pas encore de la Fondation, celle qui désormais existe en France après bien des atermoiements). Car le moment de cet essai (qui survient d’ailleurs dans un contexte de controverses comparable au nôtre, puisque c’est celui des vives polémiques suscitées par les débats oiseux et simplistes sur la « repentance » et l’identité nationale, sous le quinquennat de Nicolas Sarkozy) représente en somme la dernière phase d’une pensée de l’histoire déjà ancienne et qui a connu différents moments d’évolution.
Pour le dire vite, Mémoires des esclavages énonce, avec un certain nombre d’essais tardifs, ce qu’il est convenu d’appeler une éthique mémorielle, fondée sur un nouveau rapport à l’histoire (car à l’instar de Ricœur, Glissant s’est efforcé de penser conjointement les deux instances, histoire et mémoire, sans pour autant y entretenir la moindre confusion). Cette éthique de la mémoire s’appuie sur tout un raisonnement qui ne dresse aucune injonction sur la nécessité de se rassembler pour se rassembler. Il s’agit en fait du dernier stade d’une dialectique particulièrement subtile que je m’en voudrais de résumer outrageusement, pour y avoir consacré plusieurs chapitres. Mais en ne perdant pas de vue que tout ceci implique des exposés très vastes, si on voulait synthétiser, il s’agit pour Glissant de proposer un processus en trois étapes, que j’ai tenté d’approcher ainsi dans le livre : mesurer, recouvrer, rassembler. Mesurer tout d’abord combien cette histoire est encore en grande partie oblitérée, selon de nombreux aspects. Recouvrer cette histoire notamment au gré d’une refonte des méthodes d’approche du passé. Rassembler les mémoires issues de cette réappropriation, en reconnaissant l’interdépendance des approches.
Le crime contre l’humanité a ceci de spécifique : il touche (soit par la nature du génocide, soit par la déshumanisation dont ont pu procéder les autres cas, comme l’esclavage par excellence) à l’humanité de tout un chacun. Ce qui a été nié durant des siècles à une partie de l’humanité réduite en servitude ne saurait concerner que seuls ceux qui s’en sentent les descendants directs : il s’agit d’un crime dont la mémoire doit importer à tout un chacun. À condition que l’on consente à cette sorte d’universalité du crime contre l’humanité que constitue l’esclavage, l’idéal d’un partage des mémoires, qui demeure un objectif autant qu’un effort singulier, doit permettre de dire l’histoire dans une lucidité commune. Aucun œcuménisme préconçu ne préside à cet objectif, qui fixe un but à atteindre au gré d’un processus éthique de la mémoire, lui-même lié à la notion de Relation.
Une connaissance sans cesse exigeante au centre de la démarche mémorielle
Cette seule idée de « rassemblement des mémoires » présuppose une pensée de l’histoire tout à fait originale, mais aussi une conception très spécifique de la mémoire, une logique en effet très subtile et qui a sa rigueur. Il en va de même pour le primat de la connaissance (et son « impétuosité ») que Glissant reconnaît au centre de la reformulation de l’histoire et de la construction lucide de la mémoire qui y est attachée. On croit souvent que Glissant, à l’instar de quelques autres écrivains qu’on dit improprement « postcoloniaux » qui, dans le rapport qu’ils instaurent entre la littérature et l’histoire, tendent à disqualifier cette dernière au profit d’un conception démiurgique de l’écrivain. À vrai dire, il n’en est rien en ce qui concerne Édouard Glissant, et ceux qui le croient succombent au démon des confusions. Car même si tout au long de sa réflexion, il témoigne d’un rapport parfois âpre avec l’histoire (lui contestant surtout le discours de scientificité que certains veulent bien lui accoler), il fait surtout preuve d’une volonté de réforme des méthodologies de sa pratique et de son écriture. Il vise en fait une redéfinition épistémologique de l’histoire en tant que discipline, mais jamais ne disqualifie l’historien au profit de l’écrivain, censé voir ce que l’historien ne voit pas. Mais plus généralement, Glissant met au centre de la démarche mémorielle, une connaissance sans cesse exigeante, parce qu’elle est le rempart aux discours préconçus.
Comment ces pensées peuvent-elles faire œuvre utile et s’articuler dans le débat et la controverse sur le racisme et les mémoires qui agitent la société française et même le monde ?
Je crois que c’est justement en énonçant toute la subtilité de cette pensée qu’on se rend compte à quel point elle est à même de nous préserver de bien des ornières dans lesquelles nous sommes enferrés aujourd’hui. Vous voyez bien ce qu’il peut en être quand on parle de « rassemblement des mémoires » comme d’un objectif dynamique à construire : il s’agit du plus juste et du plus efficace antidote à la guerre des mémoires dont a parlé Benjamin Stora, et que d’autres nomment « concurrence mémorielle ».
Car être dans la connaissance, dans le dialogue et la construction commune, c’est combattre activement tous les renfermements communautaires. Ce qu’on dénonce souvent de manière pavlovienne aujourd’hui sous le vocable de communautarisme, naît avant tout de la conviction que l’on a de n’être pas reconnu dans la dignité de son histoire, de son parcours et de son identité d’origine. Alors avant même de parler d’idéal républicain, reste à se montrer lucide devant ce sentiment de non-reconnaissance, et travailler à combler les manques. Et ce n’est pas verser dans la complaisance, au contraire : c’est chercher, toujours dans l’exigence, ce que Glissant nomme les « lieux-communs » dans des histoires bouleversées.
C’est surtout considérer, comme il l’a fait au regard de la France et du monde, qu’un corps social ne peut être sain tant que l’histoire n’a pas été dite dans son entièreté. Et l’histoire de l’esclavage a ceci de spécifique, qu’elle a pu vouer ceux qui s’en sentent les descendants directs, à de très intimes sentiments de honte et de désespérance, aujourd’hui décuplés par le constat d’injustices persistantes : c’est cet ensemble qui fonde un traumatisme. En France, certains dénis portés à l’endroit d’un racisme individuel ou groupusculaire sont aujourd’hui ressentis à juste titre comme insupportables, et ne sont plus acceptés par ceux qui auparavant s’étaient résignés à les subir dans le silence. Et c’est ce déni (alors même que le racisme est un délit pénal), et c’est en particulier cette complaisance perçue à propos d’un racisme dans des corps régaliens, qui fait certains parler d’un problème systémique. Sans attribuer pourtant à la France l’identité absurde d’un pays qui serait par nature raciste, adopter le regard de Glissant sur cette question revient aussi à réaliser que ce racisme-là ne vient pas de nulle part, n’est pas ex nihilo. Il a une histoire, il est fondé sur des représentations anciennes et des assignations tenaces.
L’histoire de l’esclavage imprègne l’inconscient collectif
La fréquentation des textes de Glissant nous apprend à comprendre les structures qui motivent des comportements de cet ordre et dont les persistances s’enkystent dans le réel. Comme vous le savez, l’écrivain partageait son temps entre Paris, New York et la Martinique. Il a pu ainsi vérifier les divergences, mais aussi les continuités de certains phénomènes, qu’il analyse parce qu’ils sont liés au passé de l’esclavage, comme des transversalités agissantes. Pour la France, cette histoire n’est pas seulement d’« outre-mer », elle imprègne l’inconscient collectif. Et c’est en ce sens que Glissant prend en compte le passé de l’esclavage dans ses dimensions de transversalité inter-nationale et qu’il en définit les aires dans une vision extensive intéressant les rives de l’Atlantique (traite transatlantique), les pays de l’océan Indien (la traite « transindienne »), sans oublier les traites arabo-musulmanes séculaires qu’il est l’un des rares penseurs à prendre en compte dans son œuvre dans le même mouvement que celui de l’esclavage colonial.
Par ce regard qui mesure l’étendue de l’esclavage dans le temps et dans l’espace, Glissant permet de penser le phénomène comme étant au cœur des structurations mêmes de l’histoire moderne, le ramenant des marges où il était maintenu, au centre des mouvements de l’histoire. Ce faisant, il permet plus que tout autre, de penser l’historicité à la fois complexe et puissante des phénomènes de racisme, de relégation de l’homme noir, et de racialisation des rapports humains – tant de paradigmes qui ont nourri sur la planète les rapports sociaux, les rapports entre nations, l’économie mondiale et qui ont également conditionné ou entravé les interculturalités.
Comprendre ces rouages, atteindre à leur propos une conscience historique élargie, c’est finalement être à même de pouvoir en combattre les fixités, les persistances, et de travailler individuellement et collectivement à l’émergence de nouveaux modèles. C’est dire si je considère que la pensée de l’histoire qui est celle de Glissant et toute son œuvre sont aujourd’hui susceptibles de nous encourager à ces mutations qui nous attendent. J’aimerais y revenir tout à l’heure, si vous le permettez.
Aujourd’hui, certains veulent déboulonner des statues, débaptiser certaines rues ou supprimer des pans de certains manuels scolaires. Qu’aurait pensé, selon vous, Edouard Glissant de ces initiatives ou revendications ?
Si je me fonde sur l’œuvre du penseur et sur le tempérament de l’homme lui-même, je dirais qu’il aurait avant tout « accueilli » cette suite d’événements dans leur précipitation et leur multiplication, mais sans se précipiter pour en juger de manière péremptoire, condamner ou louer, comme trop de commentateurs de l’heure y sont conduits. La lecture de Glissant nous apprend à ne pas être prisonnier de l’événement, et à l’aborder non seulement avec le recul nécessaire, mais aussi selon tous les angles, toutes les approches adéquates. Je pense aussi qu’il aurait eu à cœur de distinguer parmi tous ces événements accélérés, les spécificités irréductibles à un mouvement indistinct. Ainsi, il aurait été certainement très attentif au fait que, même si on l’a déjà perdu de vue puisque tout cela a été si rapide, tout a commencé en somme en Martinique le 22 mai dernier avec le déboulonnage de la statue de Schœlcher devant l’ancien palais de justice de Fort-de-France. Que n’a-t-on entendu alors, de réactions effarouchées ou pire, de leçons données ex cathedra à une jeunesse martiniquaise insoumise… Je crois qu’il aurait surtout écouté ce que ces jeunes avaient à dire, avant de les vouer aux gémonies comme on l’a fait, en les rejetant dans les ténèbres de l’ignorance et de l’obscurantisme. Conformément à ce qu’il en a écrit dans Le Discours antillais, il y aurait vu le rejet non pas de Schœlcher en tant que tel, mais du schœlchérisme, qui a consisté en une écriture tronquée et idéologique de l’abolition de 1848, mais qui a également fourni un support idéologique durable à l’assimilationnisme.
Tout ceci, que Glissant avait vu dans ses écrits, ressurgit aujourd’hui avec l’acuité que l’on sait, et débouche sur un mouvement mondial de contestation des figures imposées par un récit unilatéral de l’histoire. Quand il publie Le Discours antillais en 1981, on est aux Antilles en plein débat concernant le choix des dates de commémoration de l’abolition de l’esclavage. Trente-sept ans après le choix en 1983 de la date du 22 mai en Martinique, comment ne pas comprendre la profonde contradiction qui s’est alors fait jour entre la célébration de la révolte des esclaves qui devait précipiter la promulgation de l’acte d’abolition, avec l’omniprésence dans l’espace public martiniquais, d’une figure présentée comme celle du « libérateur » providentiel et liée à une écriture unidimensionnelle de l’histoire ? Il me semble que ne pas voir cette contradiction, c’est encore rester sourd à ce qui se fait entendre avec vigueur, de la volonté de réappropriation légitime d’une histoire qui n’a pas encore été écrite, ou alors qu’on commence juste à écrire.
L’histoire de l’esclavage n’est pas monolithique
Lorsqu’il parlait du passé esclavagiste en Martinique, Édouard Glissant avait toujours été frappé des réflexes convenus, tenant en ce genre de répliques : « Il faut tourner la page, il est inutile de ressasser le passé », etc. (toutes sortes de réactions qui témoignent justement du tabou). Or, comment tourner une page qui n’a pas été écrite et encore moins lue ? Comment considérer qu’on ressasse quoi que ce soit quand la question a longtemps fait l’objet d’un interdit, d’un tabou ? Alors certes, Glissant n’aurait certainement pas vu dans les déboulonnages systématiques et le fait de rebaptiser tous azimuts certains lieux, une position souhaitable ou suffisante. S’il en aurait très certainement compris les motifs, il aurait à coup sûr insisté sur la nécessité d’ajouter à tout cela de la connaissance avant tout, selon le primat dont j’ai parlé tout à l’heure. Les initiatives précipitées et de courtes vues sont contradictoires avec la mise en avant de la connaissance sur laquelle il insiste. Car il s’agit d’accueillir le mouvement actuel comme quelque chose de nécessaire, sans être obnubilé par ses dangers (pourtant réels), en rappelant que l’histoire ne saurait représenter une idole devant laquelle on devrait s’agenouiller.
Il ne s’agit pas d’épurer l’histoire, il ne s’agit ni d’excuser, ni de condamner nous dit Glissant : il s’agit de savoir, et de tout savoir.
L’histoire n’a jamais été écrite dans l’« objectivité » qu’on lui alloue, et il est parfois inquiétant d’entendre aujourd’hui si souvent l’injonction qu’il y aurait à « ne pas réécrire l’histoire ». Que font les historiens chaque jour, sinon écrire et réécrire sans cesse l’histoire, au gré de l’élargissement des connaissances ? Que font-ils, sinon se départir de certaines conditions anciennes de cette écriture où des modèles ont pu être édifiés unilatéralement et une lecture des événements imposée ? L’histoire dépend aussi de son contexte d’établissement, et sans nourrir à son endroit une suspicion constante, il faut savoir aussi être conscient de cette relativité. Et ce, particulièrement en matière d’histoire de l’esclavage, un domaine qui n’est pas monolithique et qui est lui aussi traversé par des lectures idéologiques, et en particulier une phraséologie de minoration qui confine parfois au révisionnisme. Ainsi, quand pendant longtemps on a voulu minorer la portée et la nature de l’édit royal de 1685, du Code noir, on est incontestablement en présence de tentatives idéologiques qui se parent de scientificité comme argument d’autorité.
À vrai dire, Édouard Glissant est toujours demeuré admiratif et reconnaissant envers l’historien et philosophe Louis Sala-Molins, pour avoir su mettre en perspective avec suffisamment de force et de rigueur, ce que ce Code noir représentait comme « monstruosité juridique » dans l’histoire du droit. Ceux qui lui ont reproché cet éclairage ou y ont vu un jugement arbitraire, sont les mêmes qui continuent encore aujourd’hui à asseoir cette vision spécieuse entre toutes, selon laquelle cette codification du traitement des esclaves relevait d’une protection royale en quelque sorte. Une protection, envers des hommes, des femmes et des enfants ravalés au stade de « bien meubles » ? Une protection, pour un texte qui légifère la domination, la soumission, l’exploitation ? C’est pour avoir été sous l’empire de ce type d’insulte portée à la mémoire de gens qui n’avaient pas la parole et sur lesquels on légiférait à Versailles comme sur un cheptel, qu’aujourd’hui, tout explose. Et là encore, c’est le recours à une pensée dans le plein sens du terme, qui peut nous permettre d’envisager tout cela selon un processus indispensable, d’une substitution de la connaissance à une interprétation tronquée de l’histoire et au règne des passions.
Déboulonner, débaptiser, reboulonner, rebaptiser : tout cela s’éloigne néanmoins de la démarche constructive que propose Glissant, en montrant que l’essentiel est de parvenir à « conjoindre les mémoires »
Conjoindre les mémoires
Il ne s’agit pas d’épurer l’histoire, il ne s’agit ni d’excuser, ni de condamner nous dit Glissant : il s’agit de savoir, et de tout savoir. 1685, c’est le Code noir, mais c’est aussi l’édit de Fontainebleau, par lequel le pouvoir royal révoque l’édit de Nantes qui protégeait les Protestants depuis Henri IV. S’agit-il pour autant aujourd’hui pour tous les Protestants de France, de déboulonner les statues de Colbert ou d’exiger que l’on débaptise les établissements scolaires qui portent son nom ? Les récriminations seraient pourtant légitimes : la révocation de l’édit de Nantes a causé l’exil de centaines de milliers de Protestants français, et légitimé de nouvelles persécutions religieuses. Mais la chose serait pour le moins simpliste et surtout dangereuse s’il s’agissait de ratifier là une vision de l’histoire totalement expurgée de ses figures gênantes – car bien peu résisteraient à cette sorte de purge mémorielle qui en soi est une ineptie. En revanche, que l’on repense avec soin aux contextes dans lesquels on a choisi d’identifier la France à certaines grandes figures tout en minorant leurs parts d’ombre, et où on a choisi de les célébrer ouvertement et indistinctement dans l’espace public, là est la voie où on se rapprocherait de ce que suggère Glissant avec son primat de la connaissance. ll s’agirait alors de redonner de la perspective à tout cela, sans céder à une conception purement revendicative de la mémoire, qui ne doit pas, disait-il, « raviver les revendications ou les réclamations avant toutes choses ». Et dès lors que la connaissance aura été remise au centre du jeu, on pourra alors se poser la question des noms accolés aux lieux de l’espace public car après tout, rien ne saurait être immuable en la matière.
Déboulonner, débaptiser, reboulonner, rebaptiser : tout cela s’éloigne néanmoins de la démarche constructive que propose Glissant, en montrant que l’essentiel est de parvenir à « conjoindre les mémoires ». En l’espèce, cela impliquerait pour ce qui nous occupe aujourd’hui, d’ouvrir des dialogues où chacun se sente non pas mis en accusation ou renvoyé vers son silence, mais engagé dans la construction de nouveaux modèles. Cela permettrait également d’éviter de perpétuer les jeux de rôles, dans un mouvement stérile d’opposition : ceux qui déboulonnent sont à leur tour dénoncés comme sapant l’unité de la nation et qualifiés de « séparatistes ». Pour sortir de ce piège, mieux vaut, plutôt que de continuer à se faire plaisir soi-même en revêtant les habits commodes mais élimés du rebelle et du légitimiste, de nouer Relation, et de profiter de ce moment de tension et de remise en cause, pour conjoindre les approches de l’histoire dans une nouvelle intelligibilité. Ceux qui persistent à penser que le Code noir n’était après tout qu’un texte humaniste apprendraient qu’il n’en fut rien et qu’il fut le socle le plus durable de perpétuation d’une barbarie ; ceux qui pensent que réclamer suffit à édifier apprendraient que le processus d’une lecture commune de l’histoire exige d’autres efforts. Et il ne faut pas voir dans ce que je vous dis là l’image d’un Glissant qui serait une sorte de « centriste » sur ces questions. Je conçois ses positions plutôt comme révolutionnaires, mais il me faudrait du temps pour l’expliquer. J’ai dit tout à l’heure qu’il accueillait l’événement, avant de limiter son jugement. L’un de ses romans les plus fameux, Tout-monde, commence par l’image de la statue de Joséphine de Beauharnais sur la Savane de Fort-de-France décapitée en 1991 par un groupe de nationalistes martiniquais. Glissant tente de comprendre ce que signifie le geste, quelle revendication il porte, à quelle postulat il se rattache. En aucun cas il ne cherche à délégitimer, à disqualifier ou à caricaturer le geste militant, mais à le comprendre quand il est mû par le sentiment d’une incomplétude, d’un hiatus comme c’était le cas en 1991.
Je crois qu’il aurait par exemple su remarquer que c’est à l’initiative de militants que l’attention des pouvoirs publics avait été attirée sur le fait qu’en Martinique, le drapeau aux quatre serpents, emblème colonialiste de l’Ancien Régime pris pour pavillon des navires négriers, était encore arboré sur certains bâtiments publics, sur les casernes de gendarmerie et jusque sur les uniformes des gendarmes voici encore deux ans de cela (et il trônait encore non loin de la Place des Antilles à Paris, dans le métro). Et le fait que cette dénonciation ait débouché sur une décision prise par le préfet sur recommandation du président, de supprimer cet emblème du territoire martiniquais en 2018, est assez exemplaire de ce que Glissant souhaitait d’une interlocution mémorielle constructive, une mémoire du passé qui évite de se nécroser dans des antagonismes indépassables. (à suivre…)
Recueilli Par E.B.
Loïc Céry est directeur du Centre International d’Etudes Edouard Glissant (CIEEG) et de la revue Les cahiers du Tout-Monde à l’Institut Tout-Monde fondé par Edouard Glissant en 2006. Il est par ailleurs fondateur de la revue « La nouvelle anabase ».