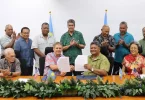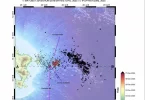La première parade culturelle de la Fête de l’abondance a rassemblé, malgré le ciel menaçant, plus de 6 000 personnes sur le front de mer de Papeete, en comptant les 1 500 danseurs et chanteurs impliqués dans le défilé. Un succès, pour les associations et groupes de danse organisateurs, comme le pour le gouvernement, bien décidé à graver cette date censée « dépasser les clivages politiques » dans le calendrier. Reportage sur place de notre partenaire Radio 1 Tahiti.
Des chars, fleuris ou animés, des danseurs par centaine, après des discours, des chants, et avant des concerts et un feu d’artifice, du rythme tout au long de l’après-midi et jusqu’au soir, beaucoup d’applaudissements…
Grande première ou pas, la célébration officielle de Matari’i i ni’a a offert des images familières au public qui s’était déplacé sur le front de mer de Papeete. Et il était nombreux : plus de 6 000 personnes d’après la Police nationale, en comptant les quelque 1 500 danseurs, chanteurs et techniciens impliqués dans l'événement. Ni plus ni moins que ce que prévoyait le gouvernement, qui avait promis de « mettre le paquet » pour inscrire ce premier 20 novembre férié dans le calendrier.
« Pas une fête politique, mais une fête culturelle »
Au micro ou devant les caméras, officiels et responsables administratifs le répètent : Matari’i i ni’a, ça n’est ni le carnaval, ni la fête de l’autonomie (29 juin). Beaucoup pourtant, côté public, se disent ravis de retrouver l’ambiance du Hiva vaevae longtemps associé au 29-juin, et dont le dernier défilé datait de 2019.
Mais cette fête de l’Abondance, « c’est différent », insiste Moetai Brotherson. « Ce qui change, c’est avant tout la signification du jour. Matari’i i ni’a, ça n’est pas une fête politique, mais une fête culturelle », une « célébration du temps » qui « fait partie de nous ». Reste qu’à part quelques élus locaux, les responsables autonomistes n’étaient pas nombreux à se faire voir à la tribune officielle, fréquentée entre autres, par le gouvernement au grand complet, mais aussi le Haut-commissaire Alexandre Rochatte, le président calédonien Alcide Ponga ou le contre-amiral Guillaume Pinget.
Du côté des organisateurs, on espère que les frictions politiques autour du changement de jour férié seront bientôt oubliées. « Ici, il n’y a pas de débat, lance Moana’ura Tehei’ura, coordinateur de la parade avec la Maison de la culture et toute une équipe de responsables associatifs. Ceux qui sont venus, sont venus avec toutes les couleurs politiques, on est de ce pays, c’est ça la force du peuple polynésien. Toutes ces considérations politiques, c’est comme si on s’asseyait sur l’intelligence de nos ancêtres, que l’on célèbre aujourd’hui. Leur héritage, c’est ce que nous avons essayé de transmettre à tous les enfants qui étaient présents ».
« Pas de concurrence » avec le Heiva
Au micro, lors du discours d’ouverture, Moetai Brotherson a pris soin de remercier Eliane Tevahitua qui demandait la sacralisation de Matari’i i ni’a dans le calendrier depuis de longues années avant son arrivée dans l’exécutif, et qui avait lancé la réflexion, dès 2023, en compagnie d’experts néo-zélandais, puisque Aotearoa a été le premier pays du Pacifique à ré-instituer le Matari’i (Matariki).
L’ancienne vice-présidente, qui ne s’est pas fait voir à la tribune, rêvait de pousser plus loin la logique de « réappropriation du temps polynésien », en replaçant le centre de gravité du calendrier culturel autour de ce lever des Pléiades plutôt qu’au moment du Tiurai et du Heiva.
Lire aussi : En Polynésie, le 20 novembre devient férié tandis que le 29 juin sera travaillé
Une idée toujours d’actualité ? Du côté de la Maison de la culture, on expliquait en tout cas encore tout récemment que la fête de l’Abondance avait vocation à « devenir le plus gros et le plus bel événement de l’année, bien au-dessus du Heiva ». Ce que Moetai Brotherson conteste : « On ne peut pas mettre en concurrence le Heiva et Matari’i. Le Heiva, c’est une institution en soi, c’est une autre ambiance, c’est quelque chose de sacré. Il ne s’agit pas de faire concurrence, de faire quelque chose de différent ».
« Encore des cartouches »
Le format de ces premières célébrations -défilé et fête à Papeete, et journée culturelle à Tautira, prévue ce samedi, en plus des évènements organisés par le Musée des îles ou par certaines communes- sera-t-il conservé dans les années suivantes ? À voir, répond le président, ouvert à des améliorations.
Moana’ura Tehei’ura, chef d’orchestre du défilé -et qui remercie les 21 associations qui se sont « entièrement mobilisés » pour faire naître ces festivités, et la dizaine de chars présentés- entend bien aider à faire vivre les célébrations de Matari’i i ni’a pendant plusieurs années. « Quand on a commencé l’aventure, qu’on a discuté avec des gens comme Manouch Lehartel ou Enoch Laughlin, je voulais faire plein de choses, et ils m’ont dit : ne grille pas toutes tes cartouches, gardes en pour l’année prochaine et l’année d’après, donc on peut encore faire mieux, lance le chorégraphe. Rendez-vous en 2026 ! ».
Charlie René pour Radio 1 Tahiti
Le retour de l’abondance dans le calendrier polynésien
Le Matari’i i ni’a correspond à la levée des Pléiades : les constellations apparaissent dans le ciel polynésien et marquent le début de la saison des pluies et de l’abondance. Une saison qui correspond à l’été austral, qui court jusqu’au mois d’avril. Aux temps pré-européen, Matari’i i ni’a était un marqueur calendaire important, équivalent à l’entrée dans une nouvelle année.
Perdue avec la colonisation, des associations tahitiennes comme Haururu ont perpétué la tradition et, petit à petit, remis au goût du jour cette fête traditionnelle. En Nouvelle-Zélande, l’ancienne Première ministre Jacinda Ardern avait fait du pays le premier du Pacifique à restaurer le Matariki et le déclarer férié.
En 2024, le gouvernement indépendantiste de Moetai Brotherson déclare à son tour un jour férié pour le Matari’i, et choisi le 20 novembre. En parallèle, il supprime le jour férié correspondant à la fête de l’autonomie, le 29 juin. Il faut dire que cette date a souvent divisée, car elle correspond à l’annexion de Tahiti, précédée par la guerre franco-tahitienne.
Si la suppression du jour férié le 29 juin a suscité de vives critiques, notamment du camp autonomiste, le premier Matari’i i Ni’a du 20 novembre a, lui, fait l’unanimité.