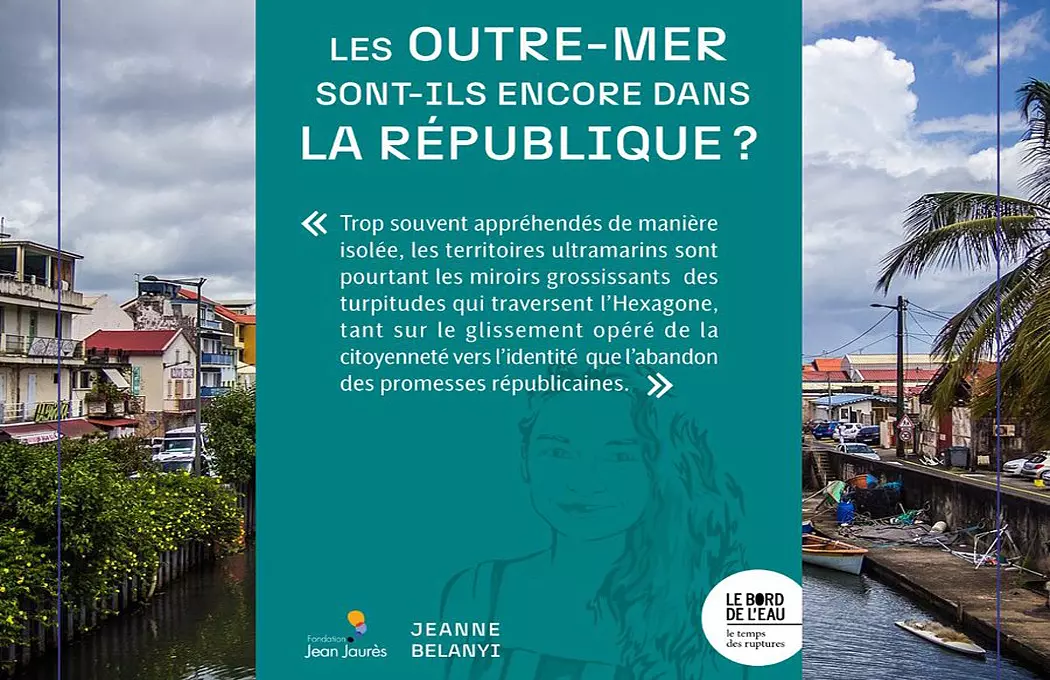Dans un ouvrage extrêmement documenté, la Réunionnaise Jeanne Belanyi, directrice de l’Observatoire des Outre-mer de la Fondation Jean-Jaurès, analyse un universalisme républicain, qui, en cherchant à assimiler et à uniformiser, a paradoxalement alimenté l'affirmation d’identités particulières. Ceci associé à des inégalités, combinées à une mémoire coloniale encore vive, qui nourrissent un cycle de contestations qui réapparaît régulièrement, sans trouver de réponses structurelles. Son ouvrage pose des questions centrales sur l’identité nationale, la place de la mémoire coloniale et la capacité de la République à tenir sa promesse d’émancipation universelle.
En 2024, les territoires d’Outre-mer ont été fréquemment exposés dans les médias à travers une vision sensationnaliste, réduits à des images de violences, de soulèvements et de catastrophes naturelles. Cette approche contribue à entretenir une vision anxiogène et marginalisante, éclipsant la complexité des enjeux qui les traversent. Les tensions sociales persistantes -qu’il s’agisse par exemple des mobilisations contre la vie chère en Martinique, des mouvements contestataires en Nouvelle-Calédonie ou des crises environnementales à Mayotte- traduisent en profondeur l’empreinte durable du passé colonial dans la société française actuelle.
Souvent caricaturée ou rejetée, la pensée postcoloniale propose pourtant une grille de lecture essentielle pour comprendre ces héritages et leurs effets contemporains. Elle met en lumière la persistance des inégalités, des formes de domination symbolique et des fractures identitaires. Loin d’être des marges, les territoires ultramarins révèlent, par leur histoire et leur actualité, les paradoxes et les tensions inhérentes à l’universalisme républicain. « Il ne s’agit donc pas de se déclarer favorable au postcolonialisme, de l’exécrer ou de le tolérer, mais de réobjectiver le mythe de la prééminence occidentale », souligne Jeanne Belanyi. Les Outre-mer, par leur histoire et leur diversité sociale, culturelle et linguistique, apparaissent dès lors comme des « laboratoires » où s’expérimentent les limites du modèle républicain.
Une République à deux vitesses
Dans son ouvrage, l’autrice souligne la fragilité d’une République à deux vitesses, où les promesses d’égalité formelle s’opposent aux réalités socio-économiques dégradées vécues Outre-mer. Le phénomène de la « vie chère » dans les territoires ultramarins illustre les profondes inégalités économiques et sociales qui les distinguent de la France hexagonale. Si le logement, la téléphonie ou les transports y sont déjà coûteux, « les écarts de prix pratiqués dans le domaine alimentaire atteignent en effet +42 % entre la Guadeloupe et la France hexagonale, +40 % pour la Martinique, +39 % pour la Guyane, +37 % pour La Réunion et +30 % pour Mayotte », rappelle-t-elle.
Au-delà de la question économique, les Outre-mer incarnent les paradoxes de l’universalisme républicain. La départementalisation, présentée en 1946 comme une rupture avec le passé colonial et une promesse d’égalité, a imposé un modèle d’assimilation souvent vécu comme une négation partielle des identités locales. Par ailleurs, « l’égalité réelle promise aux Ultramarins n’est qu’une façade à la peinture écaillée : le sous-développement économique, les taux de chômage, de pauvreté ou d’illettrisme, la paupérisation, l’éducation au rabais ne sont que le croquis inachevé d’une réalité éloignée des promesses républicaines », dénonce Jeanne Belanyi. En conséquence, les discriminations persistantes et l’écart entre les promesses et la réalité ont nourri des revendications identitaires et ravivé la question raciale en France, encore trop souvent perçue comme lointaine.
Constats alarmants
Le livre rapporte une multiplicité de constats alarmants : la vie chère et la pauvreté (« la grande pauvreté est cinq à quinze fois plus fréquente dans les territoires ultramarins »), la vétusté du système sanitaire (Mayotte premier désert médical de France), la question du chlordécone « En 2018, les résultats d’une étude destinée à objectiver l’imprégnation de la population antillaise révélaient que 92 % des Martiniquais et 95 % des Guadeloupéens présentaient des niveaux détectables de chlordécone dans le sang », l’orpaillage illégal avec ses rejets de mercure en Guyane. Et Jeanne Belanyi de poursuivre : les carences du système éducatif, les inégalités d’accès à l’école, la déscolarisation, notamment en Guyane et à Mayotte ; la question des mobilités, des infrastructures, de l’eau, des discriminations dans l’Hexagone, des salaires des originaires d’Outre-mer, qui réduisent en miette le mythe de « la méritocratie républicaine ».
« Les territoires ultramarins, tendant bien souvent à l’Hexagone le miroir grossissant de ses turpitudes, font l’expérience du même mais en pire, ces considérations atomisantes classistes s’additionnant à un passé colonial dont la plaie restée vive ne cesse de ressurgir à mesure que s’amoncèlent les difficultés dont leurs populations font l’expérience », martèle l’autrice. Ils mettent en lumière la nécessité de repenser les fondements mêmes de la République afin d’adapter ses principes à une société pluriculturelle, sans quoi la promesse de liberté, d’égalité et de fraternité restera une façade fragilisée.
Tout n’est pas négatif
Cependant tout n’est pas négatif. Malgré une apparente contradiction, les mouvements sociaux dans les territoires d'Outre-mer sont motivés à la fois par des revendications égalitaires et par la reconnaissance de leurs identités singulières. Jeanne Belanyi soutient que cette dualité reflète les débats plus larges de la société française sur l'identité et le sentiment d'appartenance. L'autrice souligne que l'indivisibilité de la République française ne signifie pas qu'elle est "une", un terme qui ne figure pas dans la Constitution. Les territoires ultramarins sont présentés comme des "laboratoires" de cette souplesse républicaine, où des arrangements institutionnels et juridiques adaptés à leurs réalités locales ont été mis en place. L’ouvrage cite plusieurs exemples, tels que le rôle des cadis à Mayotte, la reconnaissance du peuple Kanak en Nouvelle-Calédonie, et l'enseignement des langues polynésiennes, qui remettent en question l'idéal jacobin et assimilateur et montrent une adaptation de la République à sa diversité.
Au final, Jeanne Belanyi utilise la situation des territoires ultramarins pour éclairer les contradictions de la République française. Elle montre comment cette dernière a dû faire preuve de souplesse en s'adaptant aux réalités locales, tout en échouant à tenir ses promesses d'égalité. Dans une perspective postcoloniale, elle conclut entre autres qu’ « il n’est donc pas anodin que des termes tels que « néocolonialisme », « colonialité » ou « racialisation » soient mobilisés avec une acuité renouvelée dans le champ critique pour désigner non seulement la persistance de logiques de domination, d’exploitation et de hiérarchisation directement issues de la période coloniale, mais aussi les logiques économiques contemporaines. »
PM
► Jeanne Belanyi, « Les Outre-mer sont-ils encore dans la République ? » (éditions Le Bord de l’eau/Fondation Jean-Jaurès), 168 pages, 15 euros.
À lire aussi ► Il faut « refonder la relation transocéanique de la République avec les Outre-mer », préconise un rapport de la Fondation Jean Jaurès