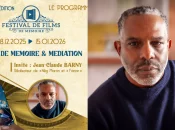Le 13 février, la Délégation sénatoriale aux Outre-mer a organisé une table ronde sur le prix des carburants dans le cadre du rapport d'information sur la lutte contre la vie chère dans les Outre-mer. Ce dernier souhaite mieux cerner ses principaux facteurs, notamment les produits du quotidien, les dépenses automobiles, le carburant ou le fret. Ses travaux se penchent sur les réalités de chaque territoire, la formation des prix, l'efficacité des boucliers qualité prix ou encore l'effectivité de la concurrence. Cette approche se veut sectorielle et ciblée, et ambitionne de dégager rapidement des propositions concrètes.
Après une première table ronde intitulée « Distributeurs automobiles et marché de l’occasion », le 13 février, une seconde était consacrée au « Prix des carburants » Outre-mer. Lors de cette réunion, modérée par la sénatrice de Saint-Barthélemy Micheline Jacques, présidente de la Délégation sénatoriale aux Outre-mer, sont intervenus entre autres Olivier Cotta, directeur général de la Société Anonyme de la Raffinerie des Antilles (SARA), Florian Cousineau, directeur Europe - DROM et gaz liquéfié de Rubis Énergie, Philippe Jean-Pierre, professeur des universités en sciences économiques à l’Université de La Réunion, ainsi que le sénateur de Guadeloupe Victorin Lurel.
En introduction, Florian Cousineau, directeur Europe - DROM et gaz liquéfié de Rubis Énergie, a rappelé que le prix des carburants en Outre-mer est réglementé et fixé par l’État et que les prix sont modifiés une fois par mois par les préfectures de chaque territoire. « Force est de constater », a-t-il ajouté, « qu’en Outre-mer les prix des carburants sont régulièrement comparables voire inférieurs à ceux de l’Hexagone ». Cependant, Florian Cousineau a tenu à attirer l’attention sur « le mur des taxes » qui arrive et qui va entraîner de manière significative et à court terme le prix des carburants à la pompe.
Le directeur général de la SARA, Olivier Cotta, a expliqué quant à lui que le modèle économique de la raffinerie des Antilles-Guyane est adossé à un mécanisme de prix administré des carburants adapté aux spécificités de ces territoires, afin de répondre à une mission de service public. « C’est un monopole de fait, mais ce n’est pas un monopole de droit. Ce système a été revu d’ailleurs à plusieurs reprises pour répondre à des crises conjoncturelles, la dernière révision datant de 2013-2014 ».
Olivier Cotta a également souligné que la SARA stocke 530 millions de litres aux Antilles-Guyane, fournissant environ 1,1 million de carburant par an. Cette activité représente près de 70 à 120 millions d’euros de taxes perçues par les collectivités locales par territoire. « La SARA ne distribue pas de carburant aux particuliers. Elle vend son carburant au même prix à tous les distributeurs qui le proposent ensuite aux clients dans leur station-service. (…) La SARA livre son carburant au même prix sur les trois départements d’Outre-mer où elle est implantée. Elle exerce son activité dans un secteur administré. Elle ne décide ni des prix, ni des marges », a-t-il précisé.
Selon Philippe Jean-Pierre, professeur des universités en sciences économiques à l’Université de La Réunion, le prix du carburant constitue l’un des symboles forts qui incarnent les crispations des sociétés ultramarines, à chaque fois qu’émerge une crise propre à ces territoires ou « propre aux enjeux internationaux qui viennent bouleverser ou opérer des tensions à la fois sur le marché des changes et les coûts des matières premières ». Il y a aussi un enjeu écologique si l’on souhaite participer aux engagements et aux mécanismes de la transition en faveur de l’action climatique, surtout dans des territoires qui sont vulnérables sur les plans environnemental et social.
Le sénateur de Guadeloupe Victorin Lurel a insisté entre autres sur le fait que les stations-service ne sont pas propriétés des gérants et qu’elles ont le statut de locataires gérants, les murs de ces stations, à part quelques-unes, appartenant aux compagnies pétrolières. « L’usine qui raffine aurait pu distribuer directement aux stations-service mais on passe par un intermédiaire qui sont les compagnies pétrolières, qui ont décidé de faire une augmentation considérable des loyers », a-t-il déploré.
Il y a ensuite le problème de l’indemnité de précarité des gérants (IPG). « Cela existe dans l’Hexagone mais ce sont les compagnies pétrolières qui payent. Pour nous ce sont les consommateurs. Je dis cela à mes collègues, c’est une concussion. C’est parfaitement illégal. (…) C’est un impôt qui n’a pas été examiné par le Parlement. À mon départ (comme ministre des Outre-mer, ndlr), on a remis ça très discrètement et personne ne le voit. Alors est-ce que cela existe toujours, est ce que c’est utile, est ce qu’il y a eu des contentieux ? » a interrogé le sénateur dans son intervention.
PM