Réunis à l’occasion du Congrès des experts-comptables 2025, Philippe Fabing de la société SAGIS, Laurent Renouf Délégué Général de la FEDOM et Ludovic Robert, Directeur Régional des Finances Publiques de La Réunion ont participé à la table ronde organisée par le Comité Outre-mer et Corse, présidé par Katy Hoarau, sur un thème brûlant d’actualité : « La vie chère, une possibilité de transformation des modèles économiques »
Dès l’ouverture, le constat a été partagé : les économies ultramarines demeurent fragiles, comme l’attestent les chiffres rappelés en introduction par Philippe Fabing de la société SAGIS. Le débat s’est alors concentré sur les projets de loi de finances et de financement de la Sécurité sociale. Une inquiétude forte s’est exprimée autour de la remise en cause des dispositifs LODEOM sociaux, pierre angulaire de la compétitivité des entreprises ultramarines. Pour Laurent Renouf, Délégué Général de la FEDOM et Katy Hoarau, qui est aussi présidente du Medef Réunion : « il n’y a pas de plan B. Le Lodeom sociale doit être maintenue en l’état ».
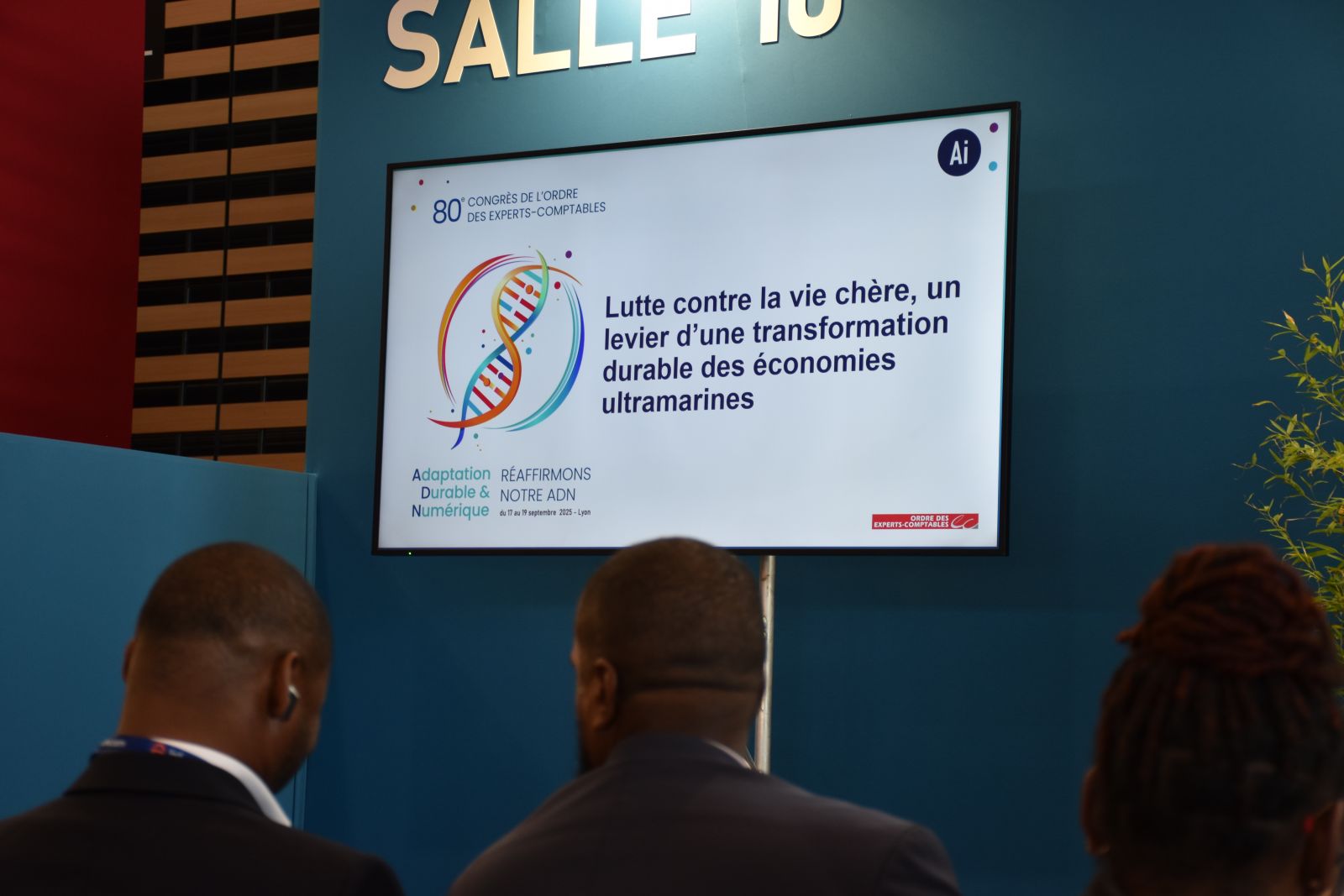
De manière unanime, les intervenants ont souligné que les arguments en faveur du maintien intégral de ces exonérations restent solides et parfaitement audibles. Supprimer ce mécanisme constituerait un risque majeur pour la survie des entreprises locales, déjà fragilisées par leur environnement structurel. « Même si le contexte budgétaire est tendu, il ne saurait justifier de sacrifier les Outre-mer », a clamé un participant dans la salle.
Les discussions ont aussi rappelé que ces dispositifs ont fait leurs preuves : la LODEOM sociale a contribué de manière concrète à une hausse du taux d’emploi dans les territoires depuis sa mise en place. Vouloir les raboter reviendrait à remettre en cause des avancées tangibles. Par ailleurs, les inquiétudes portent également sur le projet de loi de finances, qui envisage de réduire l’aide à l’investissement Outre-mer de manière brutale : 11 points d’un coup, une baisse jugée démesurée. Si une évolution est envisageable, elle devrait être graduelle et concertée. En somme, il reste encore des discussions à mener entre le gouvernement et les acteurs économiques pour trouver des solutions soutenables.

Mais au-delà de la défense des acquis, la table ronde a insisté sur la nécessité d’engager une transformation profonde des modèles économiques ultramarins. Les freins sont connus : une dépendance excessive à l’Hexagone, notamment dans les circuits d’importation, et des chaînes logistiques absurdes. L’exemple cité d’un bocal de cornichons fabriqué à Madagascar, transitant par Rungis avant de revenir à La Réunion, a marqué les esprits. Pour les experts, l’avenir passe par un ancrage renforcé des DROM dans leur bassin régional, afin de fluidifier les échanges et réduire ces incohérences coûteuses.
Le projet de loi dit “Vie chère” a également nourri les discussions. Prometteur dans son intention initiale – trouver un équilibre entre importations et production locale, instaurer une relation moins infantilisante avec l’Hexagone et plus responsabilisante pour les Outre-mer – il suscite aujourd’hui de fortes réserves. Son orientation vers une régulation centrée sur la grande distribution, ses contraintes administratives accrues et son calcul du seuil de vente à perte excluant les coûts de fret pourraient, paradoxalement, affaiblir davantage le tissu économique local. Le point positif néanmoins relevé : la nomination de deux ultramarins au sein de l’Autorité nationale de la concurrence, signe d’une meilleure prise en compte des réalités territoriales.

Autre message fort de la table ronde : les Outre-mer ne doivent pas être considérés comme un bloc homogène. Chaque territoire présente des spécificités locales, liées à son histoire, sa structure économique et surtout sa réalité démographique. Si tous partagent l’éloignement géographique vis-à-vis de l’hexagone, leurs défis diffèrent. La territorialisation des normes ne peut être efficace qu’en intégrant ces différences et en tenant compte des réalités propres à chaque île ou région.
Enfin, les intervenants ont tenu à nuancer le débat : il serait dangereux de stigmatiser la grande distribution. Si l’importation reste souvent moins chère que la production locale, beaucoup de commerçants jouent aujourd’hui le jeu en s’engageant auprès des producteurs ultramarins.
A court-terme, Ludovic Robert, DRFIP de La Réunion a insisté sur la nécessité de réduire les délais de paiements du secteur public pour un impact positif direct sur la trésorerie des entreprises en outre-mer. Cette démarche s’intègre parfaitement dans la méthode de « traitement des irritants » proposée par Katy Hoarau.

En conclusion, le message porté au Congrès est clair : le gouvernement doit mesurer les conséquences de ses choix budgétaires et réglementaires. Défendre les exonérations sociales et fiscales est essentiel car elles fonctionnent, mais cela ne suffit pas. Il faut aussi accompagner une évolution des modèles économiques vers plus d’ancrage régional, un meilleur équilibre entre importations et productions locales, une différenciation des approches selon chaque territoire et, in fine, une plus grande robustesse face aux défis mondiaux.
































