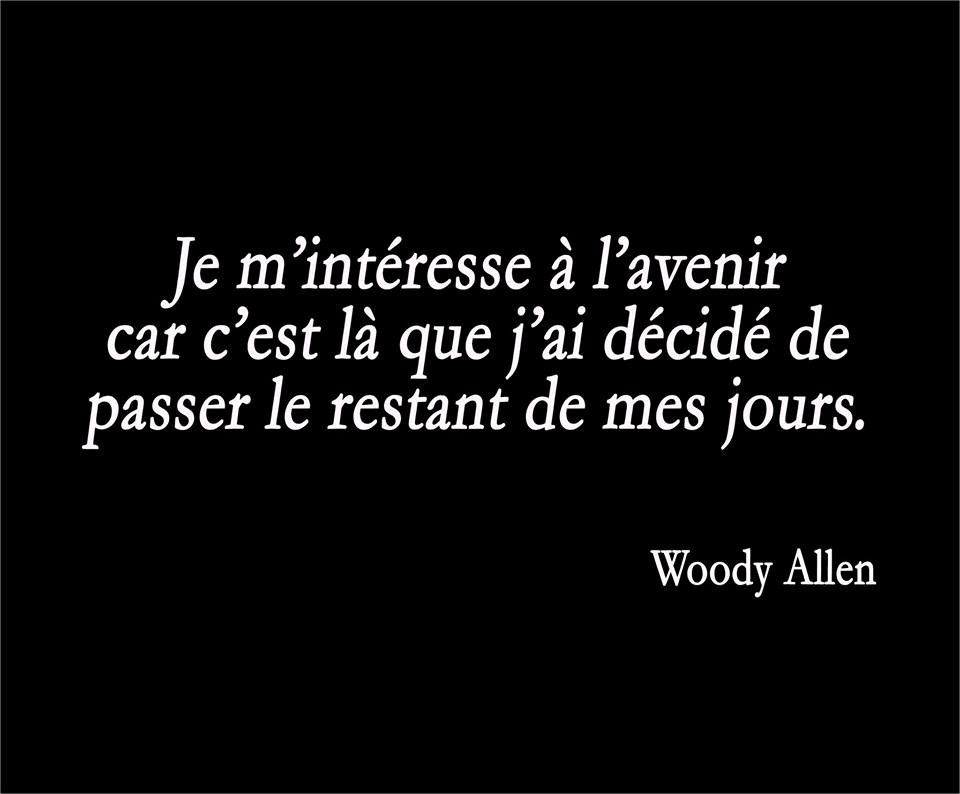Après 30 ans de service rendu au métier de journaliste, Muriel Pontarollo a décidé de se lancer dans le digital. MotsDièse, dont elle est la fondatrice, offre des formations sur le digital et ses nouveaux métiers. Entre la fin des Nouvelles de Tahiti et sa nouvelle aventure numérique, elle nous livre sa vision optimiste de la transition digitale en Polynésie et dans l’Outre-mer. Portrait.
«Un journal impertinent sur le ton mais pertinent dans le contenu de ses informations». C’est ainsi que Muriel Pontarollo décrit la ligne éditoriale des Nouvelles de Tahiti, dont elle fut la Rédactrice en Chef et plus tard Directrice des Publications (avec la Dépêche de Tahiti) de 1999 au 23 mai 2014. Ce jour là, Les Nouvelles de Tahiti ferment. Créé en 1957, il était le plus vieux quotidien de Polynésie française, mais aussi celui qui avait la réputation «de ne pas être à la botte» de la sphère dirigeante, qu’elle soit économique ou politique, autonomiste ou indépendantiste. Alors qu’ils font partie du groupe Hersant, ce dernier cède les deux quotidiens à des investisseurs locaux en 2013. Lesquels cèderont à leur tour leur part à d’autres investisseurs début 2014. C’est là que les choses se compliquent pour les Nouvelles de Tahiti. «On voulait me faire imposer, dans les deux rédactions, une ligne éditoriale qui n’était pas conforme ni à la déontologie journalistique, ni à la conscience professionnelle du journaliste». Par principe et certainement par un profond respect pour ses convictions, Muriel Pontarollo décide de prendre rupture de son contrat de travail, «je me retrouve à être contrainte à désapprendre aux journalistes leur métier, là où je leur avais transmis le sens de ce métier, du journalisme d’investigation, du journalisme honnête, du journalisme qui vérifie ses sources, du journalisme qui dit les choses». C’est le début d’une longue bataille juridique, il s’agit alors de définir s’il s’agit d’une démission simple ou d’un licenciement abusif.
Après plus d’un an de reports, au détriment de l’ancienne journaliste, le verdict tombe. «Attendu qu’en Polynésie française, et sans que le Tribunal du travail ait à se prononcer sur cette réalité juridique, un propriétaire de journal peut imposer une ligne éditoriale, sans autres possibilités pour le journaliste que de s’y soumettre ou de démissionner». La nouvelle tombe comme un couperet. «C’est un déni de toute l’histoire du statut de journaliste et de la Loi Brachard de 1935, qui fixe la protection des journalistes et le statut des journalistes et qui en fait ne s’applique pas en Polynésie française. C’est un déni de tout le combat de la liberté d’informer de la profession, depuis plusieurs décennies», le ton est ferme pour expliquer une réalité juridique complexe. En Polynésie, ni la Loi Brachard, ni la Convention collective des journalistes nationaux ne s’appliquent. Et le Code du travail polynésien est de la compétence de la Polynésie française, «globalement un copié-collé du code du travail français». Mais le-dit code ne consacre plus que les premières lignes qui décrivent ce qu’est un journaliste, «c’est à dire quelqu’un qui écrit dans un journal ». Elle rajoute, «en Polynésie, le journaliste a le statut d’une huître (…), un gratte-papier à la solde de son actionnaire». Aucune protection pour le journaliste, difficile à admettre, «la Polynésie est quand même une Collectivité au sein de la République, donc on est quand même dans des fondamentaux, des principes généraux du droit que sont la liberté d’informer et la liberté d’expression». Après 30 ans de métier, Muriel Pontarollo pose sa plume. Son dernier combat pour le journalisme sera de faire approuver cette décision par une plus haute instance juridique, «qu’on dise clairement si oui ou non, en Polynésie française, on se trouve dans une zone de non droit pour la liberté d’informer».
L’ancienne Rédactrice en chef ne met pas longtemps avant de se lancer dans un nouveau projet, une nouvelle aventure qui lui permettra de «faire bouger les lignes», comme elle se plait tant à faire. Elle a donc fondé, cette année, MotsDièse. Une initiative à la fois individuelle et collective, pour former à la transformation digitale :
D’où vient la volonté d’avoir fondé MotsDièse ?
Muriel Pontarollo : Quand j’ai quitté le groupe (ndlr, La dépêche et les Nouvelle de Tahiti), j’ai fait plusieurs formations pour me remettre à jour sur toutes mes connaissances numériques et digitales. Ce monde m’a passionné, comme cette phrase de Woody Allen, « je m’intéresse à l’avenir parce que c’est là que j’ai décidé de passer le restant de mes jours ». Je pense que ça peut faire bouger les lignes, et c’est un autre moyen de faire bouger les lignes. Et j’ai toujours voulu faire bouger les lignes. Le journalisme, c’était donner de la matière, de la conscience, du savoir, de la connaissance au lecteur. Ce nouvel outil, c’est aussi de faire bouger ces lignes et de rentrer dans la troisième révolution industrielle. Avec une grosse nouveauté, nous ne sommes plus dans une économie industrielle mais dans une économie d’innovation. On rentre dans un nouvel écosystème qui est passionnant, et obligatoire. Je pense que pour la Polynésie, vieille économie de comptoir comme on la connait et dont le modèle économique est mort, négocier cette transition numérique c’est son avenir, et c’est ce qui va faire bouger les lignes.
Pensez-vous qu’elle est consciente de cela ?
Je ne le pense pas, je le sais. Les chiffres datent de 2013, mais au niveau des usages, les polynésiens sont connectés à la planète. Tahiti est sur Internet. Le nombre de smartphones, de tablettes, d’ordinateurs vendus en quelques années. 88% des gens sont connectés. Les usages sont là au niveau de la population, avec une spécificité en Polynésie française, c’est que Facebook est entré comme l’Internet. C’est à dire que les gens qui vont sur Facebook ne vont jamais sur Google Search. On va tout chercher sur Facebook. C’est ce qui est dit dans les formations que je donne. Les polynésiens ont découvert un peu plus tard le digital mais ils ont 10 ans d’avance sur l’usage. Encore une fois parce que Facebook devient l’internet mobile. En tout cas c’est son ambition aujourd’hui. Donc oui, les usages sont là. En revanche, l’offre n’y est pas. Du côté des décideurs publics et privés, il y en a qui croient encore que Facebook est un gadget pour adolescents pour publier son plat quotidien ou que l’internet est un phénomène de mode. Le dernier chiffre remonte à 2014 : 14% des entreprises ont un site internet. Sur ces 14%, 90% sont des sites « pdf » en ligne. Je me suis demandé pourquoi? A priori, la France est en retard sur le reste du monde de 5 ans. La Polynésie en terme d’offre internet, elle a 15 ans de retard. Il y a le problème de la connexion (…) mais ça ne suffit pas à expliquer. Puisque nous sommes dans une économie de comptoir, ce nouvel écosystème qui place le client au centre de la stratégie digitale de l’entreprise prend plus de temps ici parce que c’est toute la relation client qu’il faudrait ré-expliquer. On était dans une économie de comptoir, où le client vient acheter ce qu’on lui vend, sans qu’il ait d’autre choix. Là, il faut repartir du client, redéfinir sa relation client et rebâtir sa stratégie d’entreprise vis-à-vis du client, et c’est pour ça que je dis que ce n’est pas que de la transformation digitale ce qui se passe, c’est aussi faire bouger les lignes avec une grande inversion des comportements économiques et de la relation client. Pour l’utilisateur ça change tout, et ça va aussi faire bouger ce Pays. C’est la fin du grand mépris. Mais les polynésiens sont déjà dans la transformation digitale. Ceux qu’il faut accompagner maintenant sont les dirigeants d’entreprise. Il faut comprendre ce que c’est, pour impulser une stratégie d’entreprise et mobiliser les ressources de celle-ci. Sachant que tu as une rupture relationnelle. C’est à dire que ceux qui arrivent en entreprise sont nés avec ces outils, les « digital natives ». Alors que les gens de mon âge trouvent ça plus dangereux. Donc il faut re-fédérer toutes ces entreprises autour de cette nouvelle économie. On parle « d’économie » numérique mais non, c’est toute l’économie qui est numérique. Je disais récemment (lors d’une conférence à la Chambre de Commerce, d’Industrie, des Services et des Métiers -CCISM-): c’est le passage, multiplié par cent, de la machine à écrire à l’ordinateur. Et là on est dans un système de démocratie directe par les réseaux sociaux.
On le voit bien aujourd’hui dans le Monde, les entreprises, les gouvernements, les autorités parlent directement aux utilisateurs…
Oui pour exemple, la SNCF s’est sauvée parce que c’est une des premières grosses entreprises de France à avoir initié cette transformation digitale. Et c’est ce qui l’a sauvée. C’est une des premières à avoir compris ce qu’il se passait et à s’être engagé fortement, complètement et à avoir investi pour proposer de vraies offres aux clients. Elle aurait pu ne pas le faire puisqu’elle était en situation de monopole. Mais elle a compris ce qui arrivait derrière, je parle des Blablacar et compagnie.
Est-ce que dans des petits écosystèmes comme la Polynésie, je pense aussi aux Outre-mer, la transition digitale, l’économie numérique et collaborative peuvent vraiment fonctionner ?
La vraie question c’est pourquoi ça ne fonctionnerait pas? Si ça fonctionne partout, qu’est-ce qui empêcherait que ce ne soit pas le cas en Outre-mer? Ensuite, toute cette économie collaborative et sa valorisation s’appuient sur les bases de données et leurs volumes. Ce qu’il y a de génial dans ce nouveau modèle, c’est vraiment l’innovation. Et quoi de mieux, effectivement, que ces « poti marara » (bateaux de pêche) que sont la Polynésie et les Outre-mers par rapport à de gros cargos, pour se concentrer justement sur cette innovation et apporter des solutions. Et il y a une capacité d’innovation, pour la Polynésie et La Réunion, je ne pourrais pas répondre pour les Antilles, mais je pense que c’est pareil. Etant de fait éloignés, on a cette capacité d’adaptation au milieu, à l’environnement. Et de ces capacités d’adaptation, on arrive très rapidement à l’innovation pour trouver ses propres solutions. Le rapport de l’AFD à la Polynésie française dit «trouvez vos solutions, inventez-les». Et avec ce nouveau système, on peut les inventer, on n’est plus obligés d’être dans le copié-collé du modèle de la métropole, du continent… On peut repartir de notre échelle, de notre mode de vie pour inventer nos propres solutions. On ne deviendra certainement pas le nouveau Google ou Facebook, mais nous sommes dans une nouvelle économie qui peut permettre de vivre décemment. Être milliardaire n’est pas forcément le but de tout le monde. Mais on a les moyens de construire sa Start-up, son système de fonctionnement, d’être dans le collaboratif puisqu’on est en plus dans une culture très communautaire. On peut non seulement créer son emploi mais aussi fédérer ces créations d’emplois et compétences pour avancer. On ne dépend plus du système économique ancien, où il fallait forcément rentrer dans l’administration pour exister. Maintenant nous avons la possibilité de créer du nouveau, pour la Polynésie et les autres Outre-mer. Et est-ce que les polynésiens savent créer du nouveau ? Je dis non seulement oui, parce qu’il n’y a aucune raison qu’ils ne le sachent pas. Et oui, d’autant plus que dans une île, on a plus de réactivité, de capacité d’adaptation et d’interconnexion avec son milieu et avec les gens. Ce sont des bassins d’innovation dont la France devrait un peu mieux se servir.
Est-ce qu’il y a aussi en Polynésie, un choc des générations : entre les « digital natives », la génération Y et celle qui est déjà bien ancrée dans le monde de l’entreprise ?
Alors la génération Y (20-35 ans) est encore un peu coincée au milieu du pont, ce qui est normal. C’est la génération de transition, où il y a des deux. À la fois des combats de rue parce qu’effectivement, il n’y a pas de travail. Et à la fois, toute une jeunesse qui n’a plus comme unique solution que d’entrer dans l’administration. Ceci dit, ce n’est plus trop une solution parce que l’administration est quand même pléthorique et qu’il n’y a plus de place à un moment donné. Mais, les jeunes diplômés qui arrivent sont dans des logiques de créer du nouveau. Ils cherchent, ils regardent, il y a pas mal de petites initiatives sympas qui se créent. Mais on est encore en phase de transition. Le problème fondamental de toute manière, c’est renouer avec la notion du diplôme. On a été pendant 30-40 ans dans un système clientéliste où il suffisait que l’oncle, le papa, la maman votent bien pour avoir un emploi, mais ça il faut que ça s’arrête. Aujourd’hui, il y a des parents qui poussent aux études, des jeunes qui partent faire des études. Le système éducatif ne suit pas encore, pour preuve, il n’y a pas encore une seule formation aux nouveaux métiers du digital en Polynésie française. Je propose une formation sur trois jours à la CCISM de Community Manager, mais c’est pour dire que ce métier existe. Le système éducatif est encore à la remorque. Mais les jeunes qui ont un certain niveau d’étude se sont lancés dans la création de leur propre société parce que c’est la liberté. Ça ne tient qu’à toi, tu ne peux que t’en prendre à toi, mais c’est toi qui fait.
Tous ces nouveaux métiers sont du pain béni, encore plus pour les îles, parce que tu peux les faire de n’importe où
Vous offrez donc des formations à la CCISM. Quel est concrètement le contenu d’un enseignement au digital ? Ressentez-vous un intérêt, une motivation dans le regard de ces personnes qui y assistent ?
La CCISM m’a donné l’opportunité de faire une conférence, gratuite, de deux heures et dans une salle de 14 personnes. Elle m’a rappelé deux jours avant pour me demander si je ne voulais pas faire une deuxième date parce qu’il y avait plus de 200 personnes qui voulaient venir. Au total, j’ai fait deux conférences avec 200 personnes. Des jeunes, des plus âgés, des petits commerçants à la grande entreprise, il y a un intérêt. Ce que j’essaye de faire dans mon cours c’est d’apprendre les nouveaux outils dans lesquels le contexte se situe, non pas pour dire que c’est facile et qu’on peut se faire de l’argent facilement mais apprendre comment ça se situe, apprendre à les utiliser. Je parle beaucoup de markéting digital également. J’ai aussi une partie de mon cours qui explique ce qu’est un site web et maintenant, ce qu’est un site web « mobile responsive ». On parle aussi des grandes tendances du marché, de là où sont les utilisateurs, de comment faire son site, de la stratégie à la mise en oeuvre. Là où ça rejoint le journalisme, c’est que maintenant les contenus sont important, en terme de référencement notamment sur les moteurs de recherche. Et bien entendu, nous parlons aussi de « brand content », promotion par le contenu, vidéo, rédaction web. Il faut aussi apprendre à écrire pour le web et le mobile. Le traitement de l’image et maintenant le traitement de la vidéo. Sur trois jours, nous faisons une journée plus consacrée à l’internet fixe, qui vieillit déjà puisque je refais mes slides de présentation tous les jours. Pour le deuxième jour, on passe aux réseaux sociaux, et Facebook en tête qui aujourd’hui offre des possibilités que peu de gens connaissent. Pour le troisième jour, c’est du Community management pur avec les outils, la gestion de crise, comment répondre, réagir, avec humour ou pas et aborder toutes les problématiques de référencement… Tous ces nouveaux métiers sont du pain béni, encore plus pour les îles, parce que tu peux les faire de n’importe où. C’est ce qu’il y a de génial avec ce nouvel éco-système digital, il n’a pas de frontière, pas de distance. A partir du moment où tu as une bonne connexion, tu peux travailler dans le monde entier en fait ! Et tu peux alors collaborer au sens large, avec la Russie ou l’Inde sans bouger de chez toi. Il y a 10-20 ans, ce n’était même pas envisageable. C’est le village global dans toute sa dimension planétaire. Tu peux travailler avec tout le monde, partout. C’est une vraie chance pour l’Outre-mer, parce que sa problématique d’isolement est, de fait, levée par ces outils. Même pour les groupes de musique, pour l’art, la culture,… Tout le monde a sa chance dans ce nouveau monde.

![Portrait : Muriel Pontarollo, «les Outre-mer sont des bassins d’innovation » [Exclu]](https://outremers360.com/wp-media/uploads/2015/11/Marketing-Analysis.jpg)