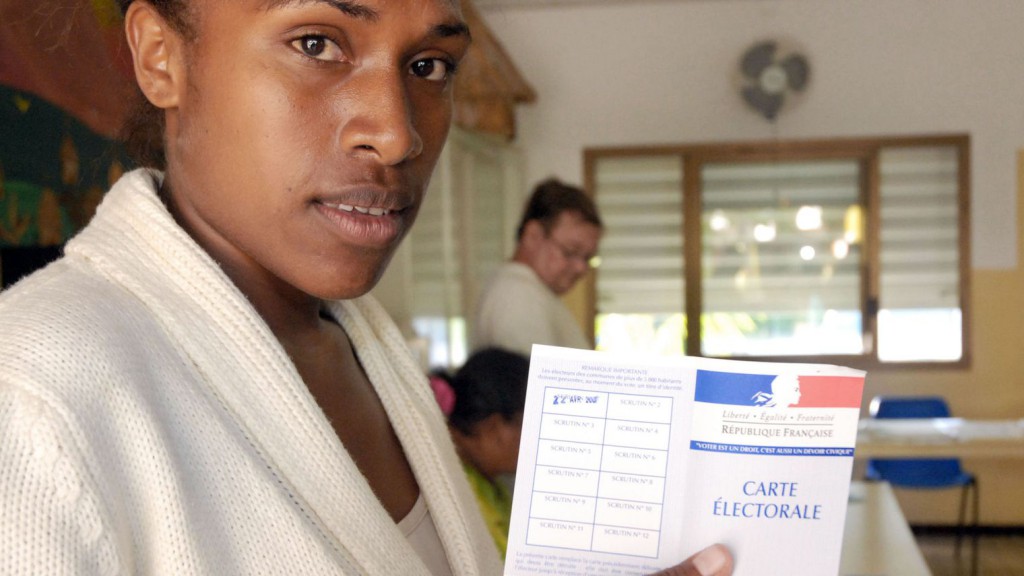Un groupe de hauts fonctionnaires soucieux du développement des Outre-mer se sont réunis au sein d’un think thank Les Alizées afin de pouvoir apporter leurs réflexions au débat public et de pourvoir aider à la transformation de l’action publique Outre-mer. Ils souhaitent ainsi servir de boîte à idées et contribuer à apporter des pistes de réflexions.
Les think tanks sont à la mode. Ils ont prospéré sur les espaces de réflexion laissés vacants par les partis politiques traditionnels. Curieusement, l’outremer a suscité assez peu de vocations alors que la « transformation publique » doit se décliner outre-mer comme ailleurs en France.
L’action publique outre-mer est riche d’objectifs, de concepts qui ne parviennent que modestement à s’incarner dans des actions concrètes ou des réussites économiques. C’est le cas de « la France, 2ème domaine maritime du monde », de « l’économie verte ou bleue » qui constituerait l’avenir des outre-mer, de « l’ouverture sur la zone géographique », de « l’égalité réelle » offerte par la Loi et l’Etat, et jusqu’au « réflexe outre-mer » qui n’a pas encore été réellement partagé par les ministères autres que celui en charge des outre-mer.
Face à ces ambitions, un chômage endémique 2,5 fois plus élevé que dans l’hexagone, une désespérance des jeunes, au chômage pour près de la moitié d’entre eux et ravagés pour certains par le crack et le pacallolo, justifient que le cœur de cible de la transformation publique outre-mer soit ce qu’il faut aussi appeler ces « spécificités » ultramarines.
Loin d’être un donneur de leçons ou une mouche du coche à l’égard de ceux qui ambitionnent légitimement de transformer la France, le think tank « Les Alyzees » se veut plutôt une boite à idées en participant, à sa place et avec d’autres, à l‘émergence dans les outre-mer d’une économie moins dépendante de l’hexagone, plus ouverte sur l’extérieur et à la concurrence, seuls leviers permettant enfin de lutter contre la vie chère. Aucun sujet ne doit être tabou. A ce titre, « Les Alyzees » proposera des pistes de réflexion voire des solutions qui pourraient être dérangeantes ou provocatrices pour certains, sans exclure l’appel à des mesures de simple bon sens :
– Les outils d’adaptation des normes existent tant au plan communautaire (article 349 du traité sur le fonctionnement de l’union européenne) que national avec les droits et pouvoirs d’adaptation, d’expérimentation et bientôt de différenciation. Qu’attend-on pour s’en saisir, pour adapter, simplifier et donner une nouvelle chance aux territoires d’outre-mer confrontés à certaines normes inadaptées aux milieux insulaires et tropicaux ?
– Face à l’afflux de migrants dans certains territoires, où les fleuves et bras de mer sont d’abord des voies de circulation avant d’être des frontières, quelle voie pour concilier le développement des populations locales et les valeurs de la République ? S’il y a un domaine de l’action publique où la différenciation peut avoir un sens, c’est bien celui-là ;
– La libération de marges de manœuvre en matière d’aides économiques saura-t-elle faire une place à un soutien effectif, dans la durée, à la construction de filières d’activité permettant de valoriser les ressources présentes sur les territoires (pêche, soleil, canne, bois, biomasse, fruits et légumes, or…) pour en faire des outils de développement, créateurs de valeur ajoutée, d’emplois et même d’exportations ? La défiscalisation d’une machine ou d’un bâtiment ne saurait suffire à soutenir une filière dont les investissements nécessitent une politique plus globale, inscrite dans une démarche contractuelle pluriannuelle ;
– La lutte contre la délinquance, contre les addictions et l’accompagnement renforcé des jeunes exclus du système scolaire sont des majeures qui remontent très fort des territoires. Comment trouver le bon équilibre entre l’envoi, tout à fait indispensable, de forces de sécurité et, en même temps, les mesures structurelles tout aussi indispensables, permettant d’agir sur la formation, initiale et professionnelle, sur l’apprentissage et le vivre ensemble ? Pourquoi ne pas organiser ou susciter davantage de formations dans le bassin géographique pour mieux répondre aux besoins ?
– Est-ce encore pertinent de revendiquer un nombre croissant de billets d’avion aidés pour se rendre en métropole alors que la concurrence, apparue depuis quelques années dans la plupart des dessertes aériennes des collectivités d’outre-mer, notamment avec les low cost, fait baisser le prix des billets d’avion et désenclave ces territoires par des liaisons supplémentaires vers les Etats-Unis, l’Asie, l’Afrique ou les Etats voisins, plus sûrement qu’une politique de distribution de billets aidés ? De surcroît, cette baisse des tarifs aériens souligne, s’il en était besoin, la contreperformance des congés bonifiés, qui fige au niveau le plus élevé les tarifs de la très haute saison, et apparaissent comme une survivance post- coloniale, qui désorganise certains services publics et ne coïncide pas toujours avec les désirs de vacances des familles actuelles ;
– Les embouteillages et la congestion urbaine, à l’entrée et à la sortie des grandes villes d’outre-mer, sont une souffrance pour les populations ultra-marines qui y perdent plusieurs heures chaque matin et chaque soir pour venir y travailler et étudier. C’est aussi un grave handicap pour l’attractivité de ces territoires, économique mais aussi sociale ou culturelle. Pendant que les importations de voitures continuent à progresser, une forte demande s’exprime de mise à niveau des infrastructures routières et, en même temps, d’un véritable réseau de transport en commun et de solutions de mobilité durable. Ces transports sont inexistants, ou très peu développés. Les attentes sont très fortes ;
– La contractualisation entre l’Etat et les grandes collectivités publiques locales, couplée avec la réforme annoncée de la fonction publique, pourrait constituer pour les collectivités d’outre-mer – dont un nombre significatif est sous le contrôle budgétaire du préfet et de la chambre régionale des comptes – une opportunité pour remettre à niveau les budgets de fonctionnement, réorganiser les services et dégager des marges de manœuvre. Cette démarche pourrait être déclinée plus largement outre-mer, en direction des communes, en tenant compte des spécificités outre-mer ;
– Comment concilier protection de l’environnement et de la biodiversité et développement des activités humaines ? c’est un des défis majeurs que doit affronter chacun des territoires ultra-marin. Face à la tentation de la mise sous cloche, saura-t-on mettre en place une stratégie équilibrée, seule susceptible de créer des emplois : protéger et préserver et, en même temps, développer et valoriser ? Une valorisation effective de la biodiversité à des fins médicamenteuses, cosmétiques ou énergétiques, soucieuse de l’environnement, est possible ;
– L’économie bleue (pêche, aquaculture, activité portuaire, énergie marine, tourisme …) – thème de nombreux discours et colloques qui mettent en exergue ses potentialités – peine à décoller alors que les fondamentaux sont là. Que manque-t-il pour faire de ce potentiel une opportunité de développement et d’emplois et un relais de croissance efficace ?
Le calendrier gouvernemental et les perspectives de réforme annoncées sont l’occasion pour le think tank d’intervenir dans le débat public.
La « différenciation », défendue au plus haut niveau de l’Etat, est déjà à l’œuvre en pratique dans les outre-mer depuis plusieurs décennies, aussi bien dans les collectivités d’outre-mer que dans les départements/régions d’outre-mer, au travers pour ces derniers, du cadre de l’article 73 de la Constitution. Avec l’inscription dans la Constitution du droit à la différenciation, il faudra sans doute considérer qu’une brèche est ouverte dans les principes qui régissent actuellement l’organisation des départements et régions d’outre-mer, notamment le principe de l’identité législative issu des lois de départementalisation. Il faut souhaiter que la « différenciation » puisse ouvrir la voie à des politiques publiques, des compétences, des moyens d’intervention et des solutions de financement ou d’organisation différents d’un territoire ultra-marin à l’autre ou entre la métropole et l’outre-mer, mais aussi selon les choix des populations et responsables locaux. Moteur d’une « transformation publique », inscrite à l’agenda gouvernemental, cette différenciation peut ainsi être le moyen de traiter différemment des situations différentes dans l’objectif d’une plus grande égalité entre les territoires ; elle doit aussi conduire à une responsabilisation accrue des acteurs locaux, par une restauration des contrôles institutionnels et un contrôle de l’action publique par les populations.
Dans ces conditions, comment peut évoluer le rôle de l’Etat outre-mer ? En se recentrant sur ses missions régaliennes et ses responsabilités essentielles de sécurité (sureté, ordre public, contrôles des mouvements migratoires, du travail dissimulé…) qui devront être assurées avec détermination et obligation de résultat, l’Etat ne devra-t-il pas aussi réexaminer son modèle de gouvernance outre-mer et passer d’un état centralisé à de nouvelles relations comportant des « services experts » dans le cadre de partenariats de projets dans lesquels les responsabilités locales seraient pleinement assumées ? Dans cette perspective, l’évolution de la fonction publique d’Etat et de ses spécificités ultra-marines constitue un enjeu de modernisation qu’on ne saurait éluder. Le passage/détachement de fonctionnaires d’Etat bien formés, d’origine ultra-marine, dans les services des collectivités territoriales pourrait constituer une piste de solution à développer.
Avec en ligne de mire le chômage et l’émancipation des jeunes, le think tank « Les Alyzees » veut contribuer par ses propositions à alimenter le débat sur la transformation de l’action publique outre-mer, à promouvoir l’égalité des chances de développement plutôt qu’une égalité formelle et à susciter de nouveaux consensus autour du tryptique responsabilisation/ développement / différenciation.
Les Alizées