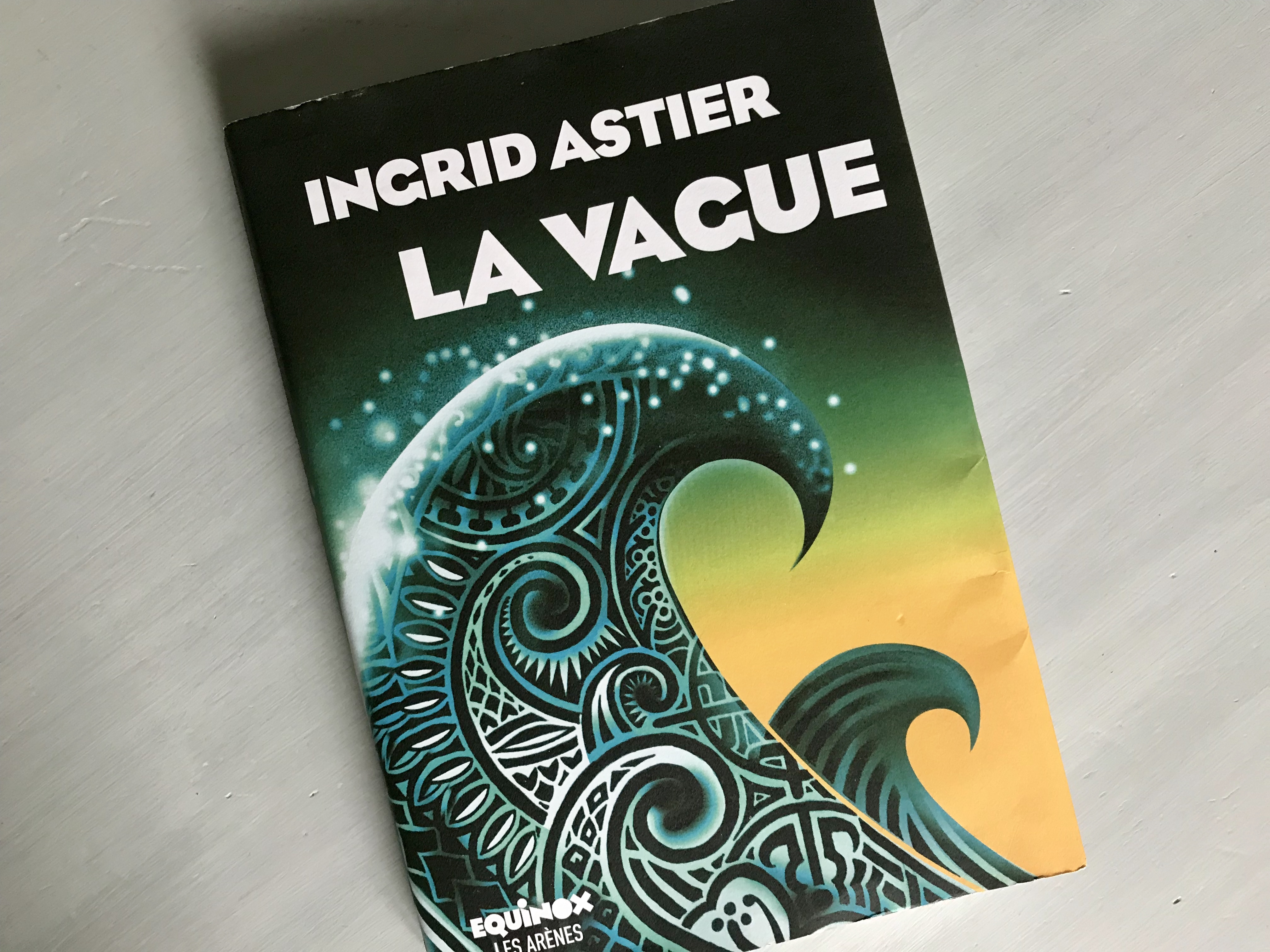Il y a, au bout du monde, aux derniers mètres d’asphalte qui ceinturent la côte ouest de Tahiti et de sa presqu’île Taiarapu, une force de la nature à la fois redoutée et admirée. Teahupo’o, le mur de crâne, « l’Everest liquide » chérie par les surfeurs tahitiens, est au cœur du roman La Vague (Éd. EquinoX) d’Ingrid Astier. Interview.
Plantons le décor. Des cimes verdoyantes, un village un peu suspendu dans le temps, des âmes qui vivent au rythme de l’onde marine venue des confins de l’Antarctique. Au PK 0, on vit au rythme de la vague de Teahupo’o qui chaque jour et selon ses humeurs, caresse ou cogne durement le récif gauche de la passe de Hava’e. Ce lieu, connu et redouté de l’élite mondiale du surf, est au cœur du roman La Vague d’Ingrid Astier. Cette vague, ce « diable en robe d’écume » face auquel l’homme doit allégeance et humilité, en est l’héroïne principale. Quasi-divinité, elle fait vivre les quelques âmes qui peuplent le bout du monde.
C’est au fil des rencontres que l’auteure a tissé son roman. Raimana Van Bastolaer, Vetea David, Baptiste Gossein, Michaël Vautor, Peva Levy ou encore, Benoît Beliaeff, autant d’illustres personnes que de moins connues qui ont nourris l’imaginaire d’Ingrid Astier pour créer les personnages qui gravitent autour de la vague. D’autres, notamment les personnages principaux, sont tout simplement nés de l’attitude, la façon d’être, la façon de vivre en Polynésie. Plonger dans La Vague, c’est être en immersion dans un Tahiti authentique, tourné vers la terre et la mer, dénué de superficialités et où l’équilibre est aussi mince et fragile que la ligne d’horizon qui sépare le ciel de l’océan.
Tout au long du roman, on rencontre des histoires, « inspirées de faits réels », on se balade dans cette partie de Tahiti qui échappe aux tours opérateurs, on essaie de se faire petit, humble et modeste face à Hiro, Moea, Birdy, Lascar et surtout, face à LA vague. « La vraie perle de Tahiti, c’est Teahupo’o ! Elle en a chaque reflet. C’est une héroïne, une vraie. Elle a tout pour elle : le cadre mirifique, la démesure et la perfection de la cambrure. Face à son déferlement, tout est balayé. Plus rien n’existe qu’elle », raconte Ingrid Astier. Pour l’heure édité chez EquinoX, le roman rejoindra également, dans le courant de l’année, la maison d’édition Au Vent des Îles. En attendant, Ingrid Astier présentera La Vague, ce samedi 16 mars au salon Livre Paris, sur le stand du Ministère des Outre-mer, de 13h30 à 14h30.
Outremers360 : Nous avons feuilleté les premiers chapitres de votre roman La Vague, et vous décrivez le petit district de Teahupo’o, l’atmosphère qui y règne, comme si vous y aviez vécu, est-ce que l’on se trompe ?
Ingrid Astier : Je n’imaginais pas parler du lointain sans l’approcher, non en termes de conquête mais en rêvant d’une façon de disparaître à ma propre culture pour m’ouvrir à celle, radicalement différente, des Polynésiens. Deux fois, j’ai eu la chance d’être invitée à Tahiti par Lire en Polynésie, en 2010 puis en 2015. En 2018, j’y suis retournée deux mois durant — uniquement pour le roman. À Teahupo’o, mais aussi à Ahe et Huahine, trois lieux qui aimantent mon imaginaire.
En arrivant à Teahupo’o, j’ai ressenti la puissance du symbolisme du PK0 — le point kilométrique zéro. La borne me rappelait sans cesse qu’il fallait repartir de zéro, me défaire de ma pensée pour ne pas passer à côté de la différence. L’exotisme renvoie l’homme à sa place. Me hantaient les mots du grand poète Henri Hiro : « Si tu étais venu chez nous, nous aurions pu t’accueillir à bras ouverts. Mais tu es venu ici chez toi… Et on ne sait comment t’accueillir chez toi. » Ces vers étaient ma boussole.
Comment vous est venue l’idée d’écrire un roman sur la vague de Teahupo’o ? Est-ce une suite logique à votre article paru dans Libé ?
L’article « Teahupo’o, l’âme tranchante », est sorti en août dernier dans Libération, en sillage de ces deux mois d’expédition humaine, artistique et littéraire à Tahiti. C’est une forme de témoignage qui révèle les coulisses du roman. Tout y est posé : le lieu (Teahupo’o), l’héroïne (la Vague), les personnages (nourris de rencontres déterminantes comme Michaël Vautor, Baptiste Gossein, Vetea ‘Poto’ David, Peva Levy, Benoît Beliaeff…).
Ce texte dans Libé se résume en une phrase : « Peut-on tomber amoureuse d’une vague ? ». Ma vie comme le roman donnent sans hésitation la réponse : oui. Quant à l’idée du roman, elle est née dès l’origine. Ce jour d’octobre 2010 où, à Papeete, j’ai ouvert le livre, Teahupo’o, la vague mythique de Tahiti, de Tim McKenna et Guillaume Dufau. Ce fut un coup de foudre. Avec Christian Robert, l’éditeur d’Au Vent des îles, nous plaisantions déjà sur ce roman à écrire. Un jour… Les rêves ont la peau dure.
Hiro, Taj, Lascar, Moea, Tuhiti, Birdy… Est-ce qu’il s’agit de personnages complètement issus de votre imagination ou des personnes que vous avez pu rencontrer et qui vous ont inspirée ?
Je pars toujours d’une émotion première (une ou plusieurs personnes existantes) qui est l’étincelle sacrée pour ensuite bâtir des personnages. Chacun retrouve ensuite sa liberté par l’apport d’imaginaire qui vient le transcender. Cette émotion première fera que le personnage sonne vrai. Ensuite, sa transmutation par l’imaginaire fera rêver. Une femme, Chantal Spitz, écrivain de Huahine, prête des traits à la vague dans sa radicalité. Son texte, Et la mer pour demeure, parle à l’inconscient de mon livre.
Birdy s’inspire du drame qu’a connu Baptiste Gossein sur la vague, et de la leçon de courage qu’il en a tirée. Cet homme m’a bouleversée. On peut être dans un fauteuil roulant et rester un géant. Hiro est un personnage plus composite, qui emprunte à tout ce que j’ai croisé de plus fort chez les Polynésiens. Il incarne l’équilibrisme redoutable entre le passé et le présent. Lascar tire sa sève de la superbe rencontre, dès 2015, avec Michaël Vautor. Il m’a appris à lire la mer. Quant à Moea, elle est une pelote inextricable d’influences et de projections. Comme Reva. Mais ne vous y trompez pas : un personnage est un trompe-l’œil. Même lorsque sa pâte profonde puise à une réalité forte, ancrée, identifiée, il révèle une part géologique de soi. Chaque roman est une plongée dans les abysses de sa propre identité.
Taj est, excusez-moi du terme, le « parfait connard », est-ce qu’on en croise beaucoup à Tahiti ?
Heureusement non. Taj pose la question du localisme en surf, renforcé par l’incivilité et l’arrogance de certains non-locaux sur les spots qui cafardent les vagues. L’idée de ce personnage est partie d’une anecdote, véritable, que Michaël m’a contée : celle d’un Américain qui débarque sur la vague en conquérant, en méprise le lieu comme les personnes, jette son mégot dans l’eau transparente avant d’aller surfer dans la gueule du monstre. La vague a lavé son orgueil. Elle lui a arraché son lycra imprimé du drapeau yankee, l’a rejeté nu sur la barrière de corail et l’a déchiqueté. Ce fut le déclencheur.
Je n’arrivais pas à faire coller un Everest liquide qui impose le respect, et l’arrogance d’un tel surfeur. Ce mépris m’a révoltée. Et j’ai pensé à cette vague justicière, renforcée par la phrase de Vautor : « Cette vague a un détecteur d’humilité ». Sur le spot, c’est elle qui fait la loi. Elle est la Belle et la Bête tout à la fois, la vie et la mort, l’envers et l’endroit d’une même réalité. Une divinité.
En même temps, comme Teahupo’o, Taj mérite qu’on ne s’arrête pas à la surface et qu’on plonge en lui. Patrick Vignoles, un philosophe, rappelle que le méchant est d’abord un « méchéant » — quelqu’un qui « tombe mal » ou qui est « mal tombé » en « tombant dans le mal ». Pour moi, Taj incarne la difficulté de jouer les surhommes et de s’enfermer dans cette identité. Comme si l’idéal dévorait l’humanité. Être un demi-dieu sur une vague est contre-nature. Qu’est-ce qu’un demi-dieu à terre, après ?
On y retrouve aussi un certain Raimana et Vetea, les « gardiens » de la vague. On devine bien évidemment qu’il s’agit de Raimana Van Bastolaer et Vetea David, vous avez pu les rencontrer ? Que vous ont-ils appris sur Teahupo’o ?
Là, j’ai gardé les noms tels quels. En hommage. Raimana et Vetea ont donné leurs lettres de noblesse à la vague. Vetea ‘Poto’ David m’a scotchée. Il incarne la frontière la plus mince entre l’homme et la divinité. Comme s’il était le gardien des portes de la mort. Pilier de la water-patrol, il a déjà sauvé 314 personnes en jet-ski. Debout à la rame sur la vague, il est impérial. Un mirage, une apparition qui tremble à l’horizon. Un chef ma’ohi ! Un sauveteur — et un guerrier. Un rugueux aussi, abrasif comme le corail si vous le heurtez.
Vetea m’a nourrie de paroles. Avec lui, j’ai pris conscience que la Mecque du surf, Teahupo’o, pouvait se transformer en grand barnum lors des compétitions si on oublie que cette vague peut tuer. Il m’a appris qu’à Teahupo’o, il faut « prévoir l’imprévu », il m’a fait comprendre la difficulté d’avoir un sponsor pour un Tahitien, même s’il est à Teahupo’o comme un baliste dans l’eau. Parce qu’il représente un marché-confetti par rapport aux États-Unis. La sagesse de cette tête brûlée m’impressionne. ‘Poto’ va dans l’œil du cyclone pour sauver des vies, là où personne n’irait, et dit des phrases d’une parfaite humilité : « Rien ne s’invente, tout s’apprend ». Vetea, c’est encore une verve intarissable — en mode cataractes, pas ruisseau…
Et puis il y a La Vague, Teahupo’o la mythique, « le diable en robe d’écume ». Vous en faites le personnage principal, incontournable, une divinité. Comment fait-on pour faire d’une onde marine un personnage à part entière ?
Il n’y a rien à faire, juste à la regarder ! La vraie perle de Tahiti, c’est Teahupo’o ! Elle en a chaque reflet. C’est une héroïne, une vraie. Elle a tout pour elle : le cadre mirifique, la démesure et la perfection de la cambrure. Face à son déferlement, tout est balayé. Plus rien n’existe qu’elle.
La Vague est une déclaration d’amour à Teahupo’o. Elle m’a délogée de chez moi, m’a projetée à des milliers de kilomètres, m’a rendue prête à tous les dangers pour l’embrasser. Je me souviens avoir dit à Michaël Vautor, avant d’aller plonger dans la vague : « Michaël, j’ai juste besoin de mes mains pour écrire. Il faut protéger mes mains, O.K. ? »
Avez-vous eu l’occasion de la surfer ?
Je ne l’ai pas surfée mais je suis rôdée à nager en conditions extrêmes (comme la Traversée de l’Oise en plein hiver, de nuit et en maillot de bain, avec la Brigade fluviale en 2013). La mort est inéluctable. Comme liberté, il nous reste de jouer avec elle. La témérité triomphe alors, un bref instant, de l’angoisse de mourir, à grand renfort d’intensité.
J’ai donc plongé dans la vague le 11 juin dernier, un jour où l’onde était grise et méchamment contrariée. Toute l’eau transmettait sa nervosité. La conscience aiguë des paroles de ‘Poto’ me protégeait : « The ocean wins ». En me réfugiant dans les failles sous-marines le temps d’une apnée, je me suis retournée pour regarder la vague dérouler. C’était sublime de beauté. « Beau à mourir » : l’expression m’a hantée.
Il y a un autre personnage qui nous intrigue : Reva. Elle semble à la fois dans le cadre spatio-temporel de votre roman mais en semble aussi détachée. Qui est-elle ? Quel est son rôle dans votre récit ?
Reva est le personnage qui semble périphérique alors qu’elle est au centre. Comme un chœur antique à elle toute seule. Elle est née du désir de ne créer un suspense qui ne repose plus sur l’action mais sur les personnages. De déplacer le centre de gravité. Mais surtout, Reva écrit des Pensées sur le mal. En Polynésie, face au « paradis » cristallisé par les cartes postales, c’est la question qui m’a hantée. Interroger la souffrance, la perversité et la mort. Jankélévitch m’accompagnait : « Il y aura toujours quelque chose d’incurable, c’est la mort, la maladie des maladies ».
Vous parlez également de l’ice, cette drogue dérivée de la méthamphétamine qui fait des ravages à Tahiti, dans la vraie vie. Est-ce que vous avez pu voir de près ses effets sur la jeunesse polynésienne ?
Oui, j’ai rencontré des personnes qui ont eu leur vie ravagée par l’ice. Cette drogue est un fléau, capable de ruiner l’équilibre fragile d’une île. C’est l’incendie dans une forêt. Ces personnes me disaient que l’ice fait tout fondre en l’être. Dans le roman, il y a un effet miroir entre les dangers de l’ice et les ravages de l’acculturation. Cet effet miroir se double d’un questionnement constant sur l’identité. Une basse profonde. La vague sert de révélateur. Elle seule sait qui se cache en chacun, et signe leur destin. L’ice sur Tahiti, c’est une catastrophe car c’est un équilibre sensible, plus fragile qu’un continent. Il y a une absorption qui n’est pas la même. La drogue, et l’ice plus particulièrement, c’est un fléau qui dévaste les familles.
Une autre chose qui nous surprend : les dialogues. Est-ce qu’en Polynésie, on parle de la même façon dont vous avez écrit les dialogues ?
Il y a un principe de base : le roman n’est jamais la réplique exacte de la réalité. Même le dialogue est une forme travaillée qui doit avoir son rythme, sa musique. On le voit avec Céline qui est un auteur qui a beaucoup travaillé sur l’oralité : c’est un énorme travail sur le langage oral pour en faire un langage de roman. Dans les dialogues, on dope un peu le côté romanesque, on injecte plus d’intensité et de réparties.

Le point kilométrique 0 et la sculpture rendant hommage à la vague de Teahupo’o ©Service du Tourisme de Polynésie
Mais en même temps, c’est vraiment ainsi que j’ai entendu parler les gens. Les dialogues s’inspirent de la façon de parler d’un Michaël Vautor qui parle avec une verve incroyable. Des expressions restent imprimées dans mon oreille. Par exemple, quand il dit : « Si tu prends mal la vague, tu te retrouves à ramasser les ma’oa ». C’est un jargon de surfeur. Comme lorsque Michaël dit toujours : « Si tu te fais râper par le reef, tu finiras en pizza quatre fromages ». C’est très visuel. Après, je ne dois pas saturer le texte de termes polynésiens parce qu’il ne faut pas que ce soit incompréhensible pour le lecteur de métropole.
Ce qui me marque également dans l’oralité en Polynésie, c’est la lenteur. Cette façon de ralentir le débit. C’est l’un des plus grands charmes. Ralentie, la langue retrouve une forme de flot. Le langage du métropolitain, c’est un langage de la cascade, de la cataracte. Ce qui est triste est de ne pas pouvoir reproduire cette lenteur qui, pour moi, est sublime.
Vous parlez beaucoup d’humilité, de modestie face à la vague. C’est une leçon qu’elle vous a apprise ?
C’est l’Everest liquide. Même quand elle fait 1 mètre 50, elle peut tuer. Mais au final, elle a tué peu de personnes car il y a très peu de gens capables de la surfer. Quand elle ne tue pas, elle peut broyer, déchiqueter le visage comme celui de la surfeuse Keala Kennelly. Il y a un moment où on ne plaisante pas avec les éléments. Teahupo’o, même à 1 mètre 50, c’est une vague massive, épaisse, pharaonique. Elle incarne la démesure. Avec les milliers de kilomètres d’élan qu’elle a depuis l’Antarctique, avec rien pour l’arrêter, elle gagne en massivité. Et cette configuration rare en fer à cheval ferme parfois l’échappatoire. Alors cette souricière n’a plus aucune porte de sortie.
Vous parlez également d’un autre lieu de Tahiti, de sa presqu’île : le Fenua Aihere. Un lieu un peu suspendu dans le temps, difficile d’accès. Avez-vous pu vous y rendre ?
Le Fenua Aihere est un peu comme la culture polynésienne : il se mérite. On ne peut s’y rendre tous les jours parce qu’à certains moments, la mer est trop tumultueuse et on ne peut y accéder. Il n’y a plus de barrière de corail et la mer envoie des vagues démontées. Ce lieu est incroyable car on y trouve des couleurs uniques : du rose corail sur la roche sombre et basaltique par exemple. Tout y est plus sauvage, sans électricité, sans téléphone. Si on s’enfonce dans la brousse, on sent que c’est l’homme qui essaie d’aller vers la nature, ce n’est plus elle qui vient à nous. Il faut se faire accepter. Je pense qu’un touriste n’imagine pas qu’existe un lieu aussi sauvage à Tahiti. Pour un écrivain, ça excite l’imaginaire. On y est, comme face à la vague, dans l’humilité parce que tout y est relié aux ancêtres, aux légendes. C’est un lieu du présent qui est en lien inextricable avec le passé. Le Fenua Aihere s’inscrit dans le temps.
Vous avez cité Chantal Spitz et Henri Hiro. D’autres auteurs polynésiens que vous connaissez et que vous recommanderez ?
Oui. Titaua Peu qui a écrit Pina. C’est un roman qui m’a dévorée. En fait, je ne dis jamais que j’ai dévoré un roman, c’est lui qui me dévore. Et Pina m’a dévorée. On dit que Pina est un livre très noir, mais ce roman est juste noir comme la vie sait l’être, minée par la violence conjugale, l’inceste et l’alcoolisme, à Tahiti ou ailleurs. Mais sur une île, ces problèmes prennent des proportions qui sont toujours plus tragiques parce que tout le monde se connaît.
J’admire sincèrement l’écrivain Titaua Peu. J’ai pu la rencontrer, et c’est une grande femme. Quant à Chantal Spitz, c’est quelqu’un que j’admire – et que j’aime. Elle a des paroles très tranchées, fortes. On dirait une divinité qui nous parle. Elle a ce rôle de chantre virulent parce qu’elle sait combien sa culture a été maltraitée. Depuis mon premier séjour en 2010, elle m’a fait prendre conscience qu’on ne pouvait parler comme ça de la Polynésie qu’en s’imprégnant des lieux, des gens et de leur langue. En allant vers leur culture avec ouverture et respect.
Aujourd’hui, vous êtes revenue sur Paris, est-ce que Tahiti vous manque ? Comptez-vous y retourner ?
Tahiti me manque tous les jours. Chaque fois que j’y retourne, j’y reste plus longtemps. Ce sont les paysages qui parlent le plus à mon tempérament. Comme les gens. C’est le seul lieu, avec le Connemara, où je n’accepte de partir qu’en songeant à la prochaine fois.
Et pourquoi pas, écrire un roman sur une autre force, une autre beauté de la nature qui s’y trouve ?
Dans La Vague, on trouve déjà le vallon de la cascade Tupe, qui est aussi un lieu au mana puissant. Règne dans le roman cet équilibre entre terre et mer. Cette vallée, presque en ligne de mire de Teahupo’o, est un jardin d’Éden sur terre. Dire que la Polynésie est un paradis est bien sûr faux, et injurieux pour ceux qui y connaissent la souffrance mais les paysages y sont d’une beauté tellement inouïe que le mal, par contraste, y semble déplacé. C’est un effet d’optique, mais puissant.
La Vague est un roman vivant : on y trouve autant l’horreur que la beauté. Réfléchir le mal est essentiel pour protéger la splendeur. La beauté n’est pas un musée…